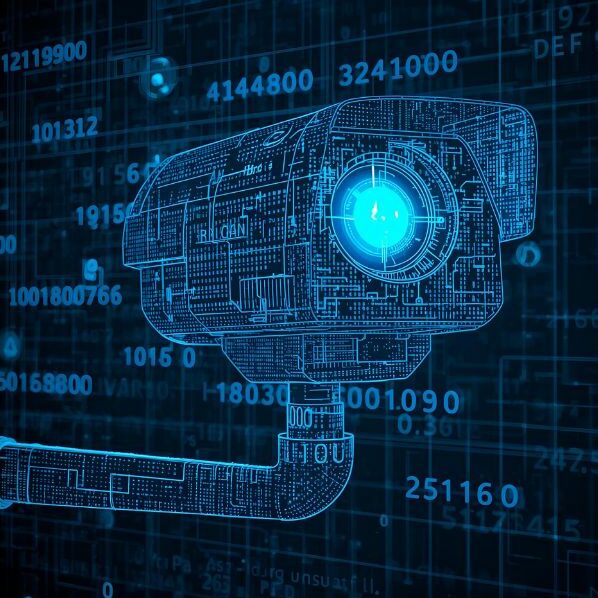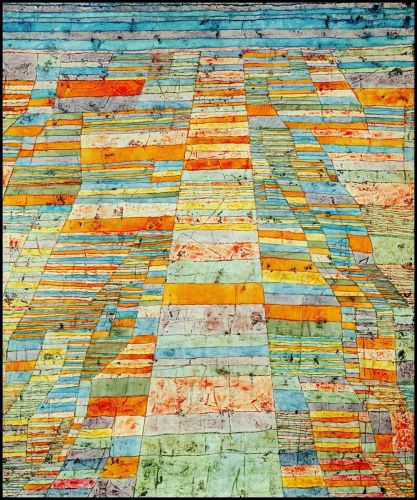Séminaire — Controverses critiques / 2018-2019
Le séminaire Controverses critiques est dirigé par Fabien Granjon (Pr. P8) dans le cadre de l’École doctorale Sciences sociales (ED 401). Il est ouvert à l’ensemble des doctorant.e.s de cette ED, ainsi qu’aux étudiants de Master. Sa vocation est de présenter-discuter 8 débats/controverses (1 par séance) qui, d’une manière ou d’une autre, mettent en jeu et en mots les rapports conflictuels qu’entretiennent les approches critiques aux autres manières de faire science (d’autres propositions sont possibles).
Le principe est de confier chaque séance à un groupe de 2 ou 3 doctorant.e.s/masterant.e.s, éventuellement accompagné.e.s d’un.e enseignant.e-chercheur.e. Chaque binôme/trinôme a pour tâche de présenter la controverse dont il a la charge, mais aussi d’en faire une lecture historiquement (mise en contexte) et subjectivement (résonance avec des intérêts de connaissance personnels) située. La présentation devra idéalement durer entre 1h et 1h30. Le reste de la séance sera réservé à un échange avec la salle.
PROGRAMME
La querelle allemande des sciences sociales
ADORNO_Sur la logique des sciences sociales
ADORNO_Sociologie et recherche empirique
POPPER_La logique des sciences sociales
HABERMAS_Contre le rationalisme positiviste
Nous sommes donc réunis aujourd’hui pour la première séance du séminaire Controverses critiques, organisé dans le cadre de l’école doctorale sciences sociales, qui sera un séminaire un peu différent de ceux que nous avons pu organiser les années précédentes dans la mesure où, cette fois, il ne s’agit pas d’un séminaire conçu autour d’invitations de collègues extérieurs, mais d’un séminaire de travail interne. Je précise qu’« Interne », ne veut pas dire « entre soi », puisque ce séminaire est largement ouvert aux collègues de Paris 8, aux doctorant.e.s et aux masterant.e.s des différents départements, mais qu’il a été envisagé comme un séminaire de travail interdisciplinaire dont les intervant.e.s sont tou.te.s membres de Paris 8, tout comme a priori, mais sans exclusive, celles et ceux qui y assisteront.
S’agissant du propos général au principe duquel j’ai pensé la tenue de ce séminaire, il se présente de manière assez simple puisqu’il s’agit de prendre en quelque sorte pour prétexte, un ensemble de controverses portant directement ou se référant obliquement, d’une manière ou d’une autre, sur/à la démarche critique de production scientifique en sciences sociales.
En l’occurrence, les controverses sur lesquelles nous allons nous appuyer seront surtout étudiées pour ce qu’elles révèlent des nécessités critiques, davantage que pour les formes pratiques qu’elles épousent. Autrement dit, nous nous intéresserons moins à la balistique et la construction pratique des débats, qu’aux contenus de ces petites et grandes affaires ou, pour le formuler encore d’une autre façon : la manière dont nous allons nous saisir de ces disputes tient moins – sauf exception – aux méthodes d’analyse caractéristiques des STS, des Sciences Studies (Pestre, Callon, CSI, etc.) et, séminalement du « programme fort » de l’université d’Edimbourg (David Bloor, Knowledge and Social Imagery, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1976) ; pas davantage à ce qui se pratique dans une moindre mesure, au sein de la sociologie pragmatique (Boltanski, Lemieux, Chateauraynaud, etc.) et des théories de la construction des problèmes publics (Cefaï, Schlesinger, Gilbert, Neveu, etc.), mais plutôt à ce qu’elles disent – ces disputes – du rapport à la critique (définition des problèmes, de leur formulation, de leur pertinence, argumentation, etc.).
Toutefois, nous n’éluderons pas pour autant, selon les cas, le caractère performatif et instituant de ces conflits (légitimation, alliances, repérage des actants, etc.), notamment quand ils tendent à provoquer « la création de nouveaux groupes d’acteurs, [à] condui[re] à la production de nouveaux savoirs, [à] modifi[er] les règles et normes » (Méadel), notamment du champ de production des savoirs scientifiques. Sous cet aspect, nombre des disputes dont nous allons parler cette année s’avèrent, de fait, portées par des acteurs qui tiennent parfois moins à maintenir un dialogue qu’à, au final, instaurer un régime conflictuel particulièrement clivant, cherchant à diviser et à instaurer un état de crise permanent.
Pour ce qui concerne la présente séance, comme vous le savez très certainement, elle est dédiée à ce qui a été présentée, à la toute fin des années 1970, à l’occasion de la sortie d’un ouvrage co-signé abusivement par Theodor W. Adorno et Karl Popper aux éditions Complexe, comme la « querelle allemande des sciences sociales » ou autrement appelée « la controverse sur le positivisme ». Popper y est en effet accusé d’être positiviste, alors qu’il s’en défend. Commentant une lettre de Alfred Schmidt en défense d’Adorno quant à son supposé mésusage de la notion de positivisme – lettre publiée dans le journal Die Zeit –, Popper précise que Schmidt décrit le positivisme comme « une tendance de pensée dans laquelle ‘‘la méthode des diverses sciences singulières est prise de manière absolue comme la seule méthode valide de connaissance ». Et de rajouter toujours concernant la plaidoirie de Schmidt, qu’elle identifie le positivisme correctement comme un excès d’importance « accordé ‘‘aux faits qu’on peut affirmer de manière certaine à partir de l’expérience sensible’’ », mais de reprocher néanmoisn à Schmidt de ne pas comprendre que le positivisme dont il se réclame est précisément une critique de la forme de positivisme que Schmidt décrit : « J’ai toujours combattu, précise-t-il pour le droit d’opérer librement à partir de théories spéculatives, contre l’étroitesse des théories ‘‘scientistes’’ de la connaissance, et particulièrement contre toutes les formes de l’empirisme sensualiste » (p. 246). La controverse réelle ne saurait toutefois se résumer à ces prétendus malentendus. Le fond de l’affaire est ailleurs et pousse Popper à accuser les chercheurs de l’École de Francfort d’être des « irrationalistes » et des « destructeurs de l’intelligence » et d’écrire qu’il ne pourrait jamais « prendre leur méthodologie (quoiqu’on entende par là) au sérieux d’un point de vue intellectuel ou académique » (p. 238).
L’ouvrage publié en 1979 en français est une traduction d’un ouvrage allemand qui collige donc différents textes de Popper et d’Adorno, reprenant notamment leurs interventions respectives lors d’une séance de travail de la Société allemande de sociologie à Tübingen en 1961. Cet ouvrage rassemble également l’échange entre Jürgen Habermas soutenant Adorno et Hans Albert défendant Popper. Ce dernier y présente 27 thèses sur la « logique des sciences sociales », ainsi qu’une formulation programmatique de la tâche desdites sciences sociales et Adorno lui répond dans un style bien à lui – que Popper dénoncera par après comme étant inutilement compliqué « trivial » et « erroné » – mais sur un ton étrangement mesuré, rappelant, entre autres choses, que « La démarche critique n’est pas seulement formelle [mais] aussi matérielle ». Et de préciser à cette occasion que « Si ses concepts veulent prétendre à la vérité, la sociologie critique se doit en même temps – et comme son projet idéel l’indique – d’être critique de la société, comme Horkheimer l’a montré dans son essai sur la théorie traditionnelle et la théorie critique » (p. 99). Il ajoute également que la sociologie qui renonce à une théorie critique de la société, « n’ose plus penser l’ensemble, parce qu’il n’y a plus d’espoir de la changer » (p. 105). Or, affirme-t-il : « Ce n’est que pour celui qui peut penser la société comme autre que celle qui existe, qu’elle devient problème selon la terminologie[-même] de Popper » (p. 104).
Pour nous parler plus avant de cette controverse du positivisme, j’ai demandé à Alexander Neumann de nous faire bénéficier de ses lumières. Vous connaissez pour la plupart Alexander, il est Professeur au sein de l’UFR Culture & communication, spécialiste de la Théorie critique et, entre autre chose, auteur de Après Habermas. La Théorie critique n’a pas dit son dernier mot, aux éditions Delga. Et je lui laisse de suite la parole…
L’Affaire Sokal
SOKAL1_Transgressing the Boundaries Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity
SOKAL2_A Physicist Experiments With Cultural Studies
SOKAL3_Les mystifications philosophiques du professeur Latour
MACHEREY_Retour sur laffaire Sokal1
MACHEREY_Retour sur laffaire Sokal2
« Si élevé que l’on juge le niveau de la stupidité humaine, on est régulièrement frappé, de façon récurrente, par le fait que les gens que l’on croyait rationnels et intelligents s’avèrent outrageusement stupides. »
Carlo M. Cipolla, Les lois fondamentales de la stupidité humaine.
Nous sommes ici réunis pour la deuxième séance du séminaire « Controverses critiques » dont le thème est l’affaire Sokal. Ladite affaire Sokal dont je ne dirai pas grand chose pour laisser l’exclusivité de la chose à Benoît Lelong, professeur à Paris 8 et spécialiste des STS, qui va nous en décortiquer les tenants et les aboutissants dans quelques minutes, est à bien des égards une sorte de parangon de la controverse académique. Canular qui a pour origine la publication, au mitan des années 1990, d’un article du Physicien Alan Sokal, dans un numéro dédié à la guerre des sciences de la revueSocial Text (une revue de la Duke University estampillée Cultural Studies), la provocation sokalienne a consisté à faire publier un document inepte, intitulé « Transgresser les frontières : vers une herméneutique transformatrice de la gravité quantique », article qui, selon son auteur, était « généreusement assaisonné de non-sens qui sonne bien et flatte les préconceptions idéologiques des éditeurs », notamment par un usage excessif de citations de penseurs de la French Theory, alors très en vogue outre-Atlantique (Derrida, Lacan, Deleuze, Guattari, Virilio, etc.),
De fait, le physicien défend, dans un pur style postmoderne, que la physique quantique auraitdes conséquencespolitiques progressistes, précise que les concepts du domaine morphogénétique pourraient constituer une théorie de pointe en gravité quantique et que la « physique pourrait, de ce fait, se constitueren « science libératrice » et permettre d’abandonner « les canons de la caste d’élites de la science dure » au profit d’une science postmoderne offrant un fondement solide à un « projet de politique progressiste ».
L’affaire ne s’arrête toutefois pas avec la révélation, par Sokal, de sa supercherie, dans la revue Lingua Franca. La chose va prendre des proportions impressionnantes et va s’enrichir d’une multitude de disputes secondaires qui vont faire, pendant des mois et même des années, les beaux jours des médias, des séminaires universitaires, des revues académiques et de quelques éditeurs. Je laisse à Benoît la charge de nous détailler la chose.
Ce qui est troublant, c’est que, depuis, des affaires « à la Sokal », il y en a eu bien d’autres, avec des retentissements moindres, certes, mais à une fréquence non négligeable. En 2015, une étude complètement bidonnée sur les « Automobilités postmodernes » et le service Autolib est par exemple publiée dans la revue Sociétés de Michel Maffesoli. Outre le fait qu’il soit fondé sur une enquête qui n’a évidemment jamais été menée, l’article est écrit dans le style spéculatif et moral de la sociologie postmoderne maffesolienne, cheval de Troie lexical qui a sans doute invité le comité de lecture à accepter un salmigondis qui faisait explicitement allégeance au sociologue français fondateur de la revue.
En 2016, Benedetta Tripodi, philosophe badiousienne chimérique, réussira pour sa part à faire publier un papier intitulé « Ontologie, neutralité et désir de (ne pas) être queer », dans un numéro de la revue américaine Badiou Studies, article supposé fournir les bases programmatiques d’un « féminisme queer badiousien » qui, dans les faits, est une longue variation abstruse sur le lexique conceptuel du philosophe maoïste français, qui a d’ailleurs très mal pris la chose.
Alors de quoi ces canulars sont-ils le nom ?
À mon sens, ils témoignent du caractère pour le moins brumeux de certains courants théoriques dont on peut faire l’hypothèse que leur objectif est moins de construire des savoirs scientifiques probants que de produire des identités autour de topiques singulières et d’ériger ainsi des communautés dont les visées sont assurément autant carriéristes que politiques. Elie During, philosophe à Paris 10, estime toutefois qu’il s’agit de ne pas de tomber dans le sophisme consistant à considérer les articles contrefaits comme des preuves de l’indigence des pensées des auteurs qu’ils visent, en l’occurrence, celles de Badiou et Maffesoli ; les papiers inciminés n’étant pas de la plume de ces deux penseurs. L’argument est entendable, mais me semble discutable dans la mesure où les « faux » en question sont tout de même des succédanés des pensées des « maîtres », qu’ils ont une visibilité dans l’espace académique et qu’ils y sont légitimés comme des propositions dignes d’intérêt.
Dans un papier justement titré « Canulars académiques, les ’’maîtres à penser’’ démasqués », Alain Sokal, Philippe Huneman, Anouk Barberousse, Arnaud Saint-Martin et Manuel Quinon, auteurs des différents canulars dont nous venons de parler défendent, je cite,« la satire, [comme] pied-de-biche à utiliser pour fracturer des coffres-forts spéculatifs ». Et d’ajouter : « Quand les auteurs ciblés non seulement se soustraient à la discussion critique, mais, en plus, font tout pour cadenasser leurs pensées, le canular reste une arme légitime et efficace pour ouvrir un débat ». Au-delà de la justification de la méthode du pastiche académique, ce que ces physicien, sociologues et philosophes défendent, c’est la nécessité de dénoncer les logiques qui permettent cette incontinence d’âneries : le public or perish, l’inflationnisme éditorial encouragé par la mise en concurrence des chercheurs, la fast science qui dégaine plus vite qu’elle ne pense, la recherche de la notoriété médiatique, le manque de vigilance épistémologique, la théorisation flemmarde des « erreurs interprétatives fécondes », le travail fastidieux de lecture et de discussion théorique remplacé par le principe d’une vaporeuse créativité spontanéiste. « L’argumentation, affirment-ils, s’éclipse au profit de l’intuition édifiante ou de l’idée provocante, fussent-elles indigentes sur le plan de leurs fondements empiriques, de leur cohérence logique et de leurs prolongements politiques ».
La pratique du canular pose de facto une question pour le moins dérangeante : si le verbiage le plus inconséquent passe sans trop de mal les barrières des comités scientifiques et éditoriaux des revues structurant l’espace éditorial des SHS, combien de stupidités de petites et moyennes portées sont embarquées dans les activités ordinaires de production/discussion des savoirs ? Approximations, mésinterprétations, déformations, empirisme naïf, théoricisme prétentieux, bavardages, réinventions de la roue ou de l’eau tiède, nominalismes outranciers, métaphorisations débridées, hipstering notionnel, voguing conceptuel, injonction au politicaly correct, « identitarisme », etc. Il est évident qu’à mesure que les sciences, notamment humaines et sociales, se développent sous le coup notamment de l’hyper-concurrence et de l’hyper-spécialisation, les occasions de « dire des conneries » vont se multipliant et dans certaines régions « épistémologiques », davantage que dans d’autres, même si personne ne semble épargné.
Force est de constater que le « bullshitisme » ou ce que Harry Frankfurt désigne comme le baratin, s’avère notamment répandu au sein de certaines Studies et ne cessent de proliférer au sein de celles, hélas, qui se voudraient critiques. Dans le domaine des SHS, les faits font donc mentir la deuxième loi fondamentale de la stupidité humaine établie par Carlo Cipolla, à savoir que « la probabilité pour que tel individu soit stupide est indépendante de toutes les autres caractéristiques de cet individu ». Ils confortent en revanche les thèses de Frankfurt qui fait remarquer, dans son savoureux petit livre, De l’art de dire des conneries, que « la prolifération contemporaine du baratin a des sources […] profondes dans les diverses formes de scepticisme qui nient toute possibilité d’accéder à une réalité objective et par conséquent de connaître la nature véritable des choses ». Là où le constructivisme égocentré fait, entre autres choses, du narcissisme des petites différences un principe de conduite scientifique, le baratin s’avère, de fait, plus présent qu’ailleurs. Et Frankfurt d’affirmer que le danger des boniments (post-structuralistes et postmodernes) tient notamment dans ses capacités bien réelles, elles, à saper « notre confiance dans la valeur désintéressés pour distinguer le vrai du faux, et même dans l’intelligibilité de la notion de recherche objective. […] Au lieu d’essayer, précise-t-il, de parvenir à une représentation exacte du monde, l’individu s’efforce de donner une représentation honnête de lui-même » (pp. 73-74).
Cette fidélité à sa propre personne, à l’idée que l’on a de soi comme mesure de toute réalité, est précisément ce que trois intellectuels étatsuniens ont utilisé comme rhétorique fondamentale pour réussir à faire publier dans le champ académique nord-américain, une fois encore, une prose indiscutablement dépourvue de sens. Plus précisément, ils ont fondé leur argumentation sur la dénonciation systématique de formes oppressives bien réelles, mais caricaturées par simplification et extrapolation et pour lesquelles ils ont proposé des modalités « de sortie » éthiquement, scientifiquement et pratiquement discutables, mais politiquement recevables depuis ce qu’ils pensent avoir repéré comme le logiciel axiologique commun aux revues auxquelles ils ont soumis leur prose, et dont l’une des caractéristiques serait d’essentialiser les formes de domination au travers de figures archétypales comme le « blanc », le « mâle », l’« hétérosexuel », etc. Ils disent par exemple avoir réutilisé des passages de Mein Kampf, mais travestis dans les termes du féminisme intersectionnel, pour écrire un papier outrancier, mais qui a pourtant bien été accepté.
En l’espèce, l’ampleur et la teneur de leur supercherie, révélée en février 2018, pourrait faire passer le canular de Sokal pour une innocente facétie de timide séminariste. Avec James Lindsay, Peter Boghossian et Helen Pluckrose (https://www.youtube.com/watch?v=kVk9a5Jcd1k), on passe clairement du canular artisanal à la démystification industrielle, puisqu’ils ont rédigé pas moins de 21 articles complètement bidons, articles qu’ils ont proposés à des revues censées être de bonne tenue. Les papiers portaient pour l’essentiel sur des sujets de prédilection des Gender et Queer Studies, mais traités de manière outrée (l’utilisation masculine du plug annal comme traitement de la transphobie ; la culture du viol chez les chiens ; le fantasme érotique comme agression sexuelle, etc.), depuis des données erronées et structurés par des raisonnements abscons. Au moment de la révélation de leur opération massive, sur les 21 papiers rédigés pendant près de deux ans, 7 avaient passé allègrement la rampe des comités de lecture, 4 papiers avaient été publiés, 3 acceptés, 7 autres étaient en cours d’examen et 6 seulement avaient été rejetés. Parmi les 7 papiers publiés/acceptés, certains ont même donné lieu à des commentaires particulièrement laudatifs quant à la charge visionnaire de tel aspect ou de tel argument.
Les trois pasticheurs admettent vouloir démontrer le peu de fiabilité de courants de recherche qu’ils appellent les « études de doléance » (« Grievance Studies »), et cette centration leur a valu d’être présentés comme des pourfendeurs « réacs » des études de genre et des détracteurs du mouvement #MeToo. Peut-être est-ce le cas, mais quelles que soient leurs motivations, ce qu’ils révèlent, indéniablement, c’est le peu de sérieux des revues auxquelles ils ont soumis leur prose.
J’aimerais donc rappeler que le meilleur moyen de maintenir la nécessité critique dans le champ de la production du savoir scientifique, tout en évitant le bluff, le battage et la fadaise est évidemment de ne rien lâcher sur les manières de faire science : l’exigence de problématisation, la mise en énigme du réel et la soumission – en même temps – à l’épreuve de ce dernier, la réfutation de la neutralité axiologique afin de mieux faire sienne l’obligation d’une réflexivité non égotiste, plaçant l’objectivité non dans un improbable en-dehors neutre du monde, mais dans l’indispensable capacité à dire ce que la vue doit au point de vue et sans penser, de surcroît, que celui-ci puisse seulement se résumer à une subjectivité nombriliste. Comme le rappelle Bourdieu, l’on est d’autant plus critique, en tant que social scientist, que l’on est en capacité de maintenir les obligations épistémologiques de la production scientifique. Si les sciences sociales peuvent être radicalement critiques, c’est nécessairement depuis ce qu’elles sont, c’est-à-dire, en premier lieu, des sciences et non un espace de jeu pour subjectivités à la recherche de profits narcissiques qu’à leur manière, les canulars dont nous venons de dire deux mots, dénoncent. Et dans la perspective d’une pratique critique de la science, cela ne veut pas dire, comme semblent le suggérer Helen Pluckrose et ses comparses, d’abandonner tout agenda politique, mais plutôt d’exercer sous la double exigence d’une science normativement fondée et pleinement consciente de cette double nature.
Benoît Lelong n’a pas souhaité que son intervention soit mise en ligne.
Ci-après une partie de la discussion qui a suivi l’exposé.
Neutralité axiologique et neutralité engagée
HEINICH1_Pour une neutralité engagée
BARCELLINI_Engagement, recherche et politique
BEITONE-MARTIN_La neutralité axiologique dans les sciences sociales
HEINICH2_Pour en finir avec lengagement
La séance d’aujourd’hui est assurée par Nail Aras, masterant. Elle porte sur la neutralité axiologique. Outre les opérations de description, d’explication et de compréhension, les sciences sociales engagées (SSE) ont également vocation à juger. Pour elles, il s’agit en effet d’« évaluer ou [de] justifier de manière normative les faits sociaux et les actes sociaux (ce qui exige de comprendre comment tout cela fait sens tant pour le chercheur que pour les acteurs, et de prendre en compte les conséquences éthiques et politiques de la réalité et de l’action) » (Caillé, Vandenberghe, 2016 : 46-47). Les SSE se développent donc en opposition au principe de neutralité axiologique tel qu’on l’entend généralement en France, c’est-à-dire comme la nécessité de maintenir à distance les jugements de fait des jugements de valeur. Ce que rejette la critique c’est la mythologie de l’objectivité, c’est-à-dire la distinction artificielle qui est faite entre le descriptif, l’explicatif et le normatif. Les pensées critiques ne rejettent évidemment pas l’objectivité, mais elles considèrent que l’objectivité est en fait une construction sociale et les concepts sur lesquels elles s’appuient mêlent donc description, analyse et jugement.
Les SSE s’opposent donc aussi aux formes critiques de démarcation absolue comme chez Louis Althusser qui fait fond sur l’« opposition radicale entre le sujet et l’objet, entre science et conscience, et [qui postule donc] au plan des sciences sociales, [la] constitution d’une scientificité objective, pure de tout jugement de valeur » (Nair, 1974 : 199). Ce que font les SSE, c’est en fait renégocier l’opposition entre distanciation et engagement. Les sciences sociales traditionnelles considèrent que le principe de neutralité axiologique est une sorte d’impératif qui interdit dans la logique démonstrative de mélanger énoncés factuels et énoncés axiologiques. La critique revendique, elle, la possibilité de mixer les deux puisqu’elle se considère comme une attitude éthique qui s’alimente d’une connaissance objective des données matérielles.
En son temps, David Hume a effectivement montré que les énoncés axiologiques ne pouvaient être déduits des énoncés factuels : si comme énoncé factuel je constate par exemple : le taux de prostitution estudiantine n’a jamais été aussi haut, ce qui est un fait social avéré, je ne peux déduire de cette seule information prouvée empiriquement, le fait qu’il faille lutter contre la prostitution estudiantine. La deuxième partie du raisonnement : il faut lutter contre la prostitution estudiantine est un jugement de valeur, on introduit une évaluation axiologique : un « il faut », qui ne se trouve pas dans les prémisses du raisonnement scientifique qui nous a amené à faire le constat de la prostitution estudiantine. On ne peut donc effectivement déduire un énoncé normatif ou prescriptif d’un raisonnement scientifique sous l’angle de la logique, mais sous l’angle de la pratique oui ! Pour Charles Taylor, dans tout raisonnement scientifique il y a ce qu’il appelle des « sécrétions de valeur » car les jugements de valeurs peuvent aussi être empiriquement fondés, peuvent être prouvés. Si je dis : « X est lâche/courageux », ceci est un fait qui peut être prouvé : X trahit ses amis, X ne s’engage pas, X n’a pas défendu Y ou Z, ce que je vous dis est prouvé empiriquement, mais il s’agit bien d’une position normative qui met en jeu des valeurs.
Jean-Marie Brohm commente ainsi le principe de neutralité axiologique comme loin d’airain de la sociologie : « La sociologie critique, si elle constate évidemment le polythéisme des valeurs, n’hésite pas pourtant à dénoncer le fiction de l’indifférence éthique ou de la neutralité axiologique. Que le sociologue doive respecter avec le maximum de scrupules l’authenticité des sources, la véracité des témoignages, l’honnêteté dans la restitution des résultats – sans les habituels ajustements et arrondissements ou, pire maquillages – l’indépendance vis-à-vis des commanditaires, la transparence des démarches et des financements [ou encore] la distance critique à l’égard de ses propres convictions, est une chose absolument indéniable. Autre chose est l’illusion que le sociologue pourrait rester apolitique, neutre, désengagé, impartial, désimpliqué » (Brohm, 2006 : 66-67).
Les SSE ont pour objet l’analyse et la compréhension des faits sociaux dont elles dégagent avec le maximum de précision scientifique les causes à la fois structurelles/objectives et dispositionnelles/subjectives, mais elles sont donc également et en même temps des sciences éthiquement fondées, des sciences fondées sur ce qu’on pourrait appeler une morale pratiquequi vise à initier ou plus modestement et plus souvent à renforcer l’action émancipatrices de sujets sociaux en lutte. Autrement dit, le débat autour de la neutralité axiologique est d’ordre épistémologique, mais aussi assez clairement politique. Et à ce titre, la neutralité n’est sans doute pas autre chose, comme le suggère Geoffroy de Lagasnerie qu’« un engagement contre l’engagement, comme une dénégation de la situation d’engagement » (de Lagasnerie, 217 : 26 – d’où la proposition de Nathalie Heinich, au principe de la controverses d’aujourd’hui, quant à la possibilité d’une « neutralité engagagée »). Comme il le fait remarquer par ailleurs : « La question des relations savoir/politique ouvre sur tout un faisceau de questionnements éthico-pratiques. La ramener à une réflexion épistémologique ou méthodologique, c’est donc la rendre inoffensive : c’est opérer un travail de distorsion et de refoulement qui permet de ne pas saisir les problèmes dans leur matérialité » (de Lagasnerie, 217 : 10).
Maximilien Rubel, commentant le matérialisme marxien affirmait pour sa part : « Au déterminisme causal qui régit les phénomènes du passé, correspond, dans la sphère des valeurs éthiques, le choix des moyens immédiats, employés en vue d’une fin lointaine, fin et moyens devant psychologiquement coïncider dans la pratique révolutionnaire qui implique la métamorphose simultanée du monde et des hommes » (Rubel in Marx, 2008 : 45). Nous y reviendrons certainement dans la discussion, mais l’une des conséquences de ce rapport défiant vis-à-vis de la neutralité axiologique est la pente en quelque sorte « naturelle » qu’ont les SSE de s’ouvrir aux luttes sociales et politiques (pas nécessairement révolutionnaires au sens où l’entendait Marx) et le fait qu’elles ont pour projet concomitant d’ouvrir ces luttes sociales à la critique théorique et aux savoirs scientifiques. Philippe Corcuff estime par exemple que les sciences sociales comme la philosophie sont en mesure, je le cite de « participer à un renouveau [d’une] critique sociale radicale et émancipatrice ». Cela suppose, ajoute-t-il, « d’admettre des complications dans les rapports classiques entre le savant et le politique, c’est-à-dire tout à la fois une autonomie de la création professionnelle d’outillages intellectuels et de savoirs, associée à des critères de rigueur dans la recherche et d’argumentation dans la discussion, et des intersections avec l’action politique ». Et d’ajouter enfin : « Et cela sans donner aux savoirs académiques ni une exclusivité, ni une position de surplomb dans la production de la critique sociale, celle-ci appartenant aussi au mouvements sociaux et aux initiatives citoyennes » (Corcuff, 2014 : 8).
À cet égard, on peut évidemment citer également Pierre Bourdieu : « Il y a dans la tête de la plupart des gens cultivés, surtout en science sociale, une dichotomie qui me paraît tout à fait funeste : la dichotomie entre scholarshipet commitment— entre ceux qui se consacrent au travail scientifique, qui est fait selon des méthodes savantes à l’intention d’autres savants, et ceux qui s’engagent et portent au dehors leur savoir. L’opposition est artificielle et, en fait, il faut être un savant autonome qui travaille selon les règles du scholarshippour pouvoir produire un savoir engagé, c’est-à-dire un scholarship with commitment. Il faut, pour être un vrai savant engagé, légitimement engagé, engager un savoir. Et ce savoir ne s’acquiert que dans le travail savant, soumis aux règles de la communauté savante » (Bourdieu, 2002). Voilà les choses à peu près posées, je laisse la parole à Nail.
La sociologie comme sport de combat
LAPEYRONNIE_Lacadémisme radical
GRANJON1_La critique est-elle indigne
RENAULT_De la sociologie critique
HEINICH_Misère de la sociologie critique
HEINICH2_Pour en finir avec lengagement
GRANJON2_Des sciences sociales vigilantes aux sciences sociales politiques
Présentation effectuée par C. B., Jonathan Deniau et Maeva Lubin (masterants)
Approches matérialistes de la communication
GRANJON1_Du matérialisme comme principium
DOUYÈRE_De la recherche en communication
HELLER_Le principium et la lutte-2
HUET_Les spectres du matérialisme
GRANJON2_Des échelles de la critique
KEUCHEYAN_Gramsci, Bourdieu et les CS
CAPRA_Communication en Amérique latine
Présentation effectuée par Christophe Magis (Mcf), Nadhem Hanin (masterant), Natalia Calderon Beltran (doctorante)
Le danger sociologique
BRONNER-GÉHIN_les prophéties autoréalisatrices
COULANGEON_La sociologie sans réductionnisme
GRANJON_Danger sociologique-quiétude négativiste
CORCUFF_Controverses dans la sociologie
RAMBAUD1_La petite critique, la grande et la révolution
CORCUFF2_Sur les difficultés du débat critique en sciences sociales
RAMBAUD2_Avancer sur le chemin d’une sociologie de la critique
La présente séance prend pour objet les controverses qui ont émergé lors de la sortie, en 2017, du livre de Gérald Bronner et Étienne Géhin, Le danger sociologique. Je vais essayer de défendre l’hypothèse que les propos de cet ouvrage et de quelques autres sont en fait le signe d’une dynamique plus général qui me semble pouvoir identifier comme celle d’un dégagismevisant à désarmer les sciences sociales et à exécuter la critique. À partir des quelques éléments de réflexion que je vais partager avec vous, j’aimerais également qu’on puisse réfléchir ensemble, à l’occasion de la période de discussion, à un paradoxe que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans le cadre de ce séminaire, à savoir la compatibilité paradoxale de certains développements critiques avec l’évolution du champ académique et des politiques individualistes/individualisantes du MESR.
Le constat à partir duquel je souhaite construire la réflexion de ce matin tient à l’intensification des attaques menées ces dernières années contre les sciences sociales et tout particulièrement contre elles qui se revendiquent critiques. Autrement dit, la critique serait soumise, aujourd’hui, à des intimidations d’ampleur et de natures assez différentes, mais visant à amoindrir le rôle qu’elles seraient susceptibles de jouer au côté des forces qui tendent à remettre en cause les ordres sociaux.
Pour décrire ce phénomène, nous serions tenté de reprendre le terme de dégagismequi désigne la volonté d’évincer totalement un pouvoir ou à tout le moins d’en éradiquer les principales forces et effets. Or force est de constater qu’il existe bel et bien des prétentions explicites à décrédibiliser les sciences sociales, voire tout bonnement les éliminer de la sphère académique, au motif qu’elles ne serviraient pas suffisamment l’innovation et la compétitivité.
26 des 86 universités japonaises ont, en juin dernier (2017), été mises en demeure, par le ministre de l’éducation Hakubun Shimomura,de se débarrasser de leurs départements de SHS. Dans la lettre de mission ministérielle il était ainsi demandé aux universités japonaises de favoriser les disciplines servant de façon plus évidente les « besoins de la société ». Il y a quelques années, en Suisse, Adrian Amstutz, conseiller national bernois du parti UDC, avait demandé que le nombre d’étudiants en sciences sociales soit tout bonnement divisé par deux, arguant que les jeunes feraient mieux de suivre un apprentissage, afin qu’il y ait un vrai retour sur investissement pour la société. Ces attaques portées aux sciences sociales depuis les appareils idéologiques du capitalisme contemporain redoublent par ailleurs d’intensité quand il s’agit de porter le fer dans la plaie critique. Le dégagisme épouse alors facilement les atours de la censure. Citons-en quelques exemples sur le mode du vrac : il y a eu, par exemple,ledéclassement, à un concours CNRS, de jeunes sociologues aux bénéfices de juristes, alors qu’ils étaient pourtant classés premiers par le jury d’admissibilité. Leurs noms ont même disparu de la liste complémentaire dressée par le jury d’admission. Une première. Lecarnet de recherche RussEurope de Jacques Sapir, hébergé sur la plateforme Hypothèses d’OpenEdition a été fermé au motif que l’auteur y aurait publié des textes partisans déconnectés du contexte académique. Citons aussi le cas de cetteinterdiction décrétée – puis retirée – par l’Université de Strasbourg concernant l’expression publique de ses enseignants-chercheurs ou celui de l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, laquelle s’est distinguée en intentant un procès ubuesqueà l’un de ses enseignants au motif de « provocation à la discrimination raciale » et ce, pour un courriel envoyé sur une liste de débat interne à l’université à l’occasion de la venue de Manuel Valls ; e-mail qui reprenait ironiquement certains propos sur les « blancos » tenus à une autre occasion par le Premier ministre. Mentionnons également les polémiques violentes et les intimidations contre les initiatrices du camp d’été décolonial non-mixte de formation à l’antiracisme politique, celles dirigées contre le collectif Mwasi qui organise Nyansapo, un festival afroféministe,ou encore celles qui ont voulu empêcher la tenue d’un colloque surl’intersectionnalité dans les recherches en éducation, lequel s’est finalement tenu à l’ESPE de Créteil. Et puis il y a eu quelques interdictions effectives :annulation d’un colloque sur l’islamophobie à l’Université Lyon 2, pourtant organisé par la Chaire Égalité, Inégalités et Discriminations, au motif de la participation à l’événement de militants luttant contre… les discriminations;interdiction de séminaires à l’Université Rennes 2 et à l’Université de Limoges auxquels était invitée la porte parole du PIR, Houria Bouteldja ; déprogrammation par ScePo Paris d’une conférence sur les rapports entre le régime russe et les activités terroristes ; interruption violente d’une conférence d’Édouard Louis et Geoffroy de Lagasnerie à l’Université de Lille 3, etc. Et la liste n’est évidemment pas exhaustive.
Une censure plus insidieuse mais tout aussi efficace tient évidemment à la réduction des budgets de recherche, les laboratoires étant de plus en plus sommés de trouver des financements à l’extérieur de l’espace académique et notamment au sein de la sphère entrepreneuriale. Pour des recherches critiques, la possibilité de décrocher des subsides conséquents, hors champ universitaire, est bien sûr assez mince. Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-de-France, a ainsi officialisé le fait que ladite région ne financerait plus les recherches sur le genre, les inégalités et les discriminations et qu’elle retirait donc ces thématiques de ses « Domaines d’intérêt majeur ».
Outre ces velléités pures et simples d’élimination par l’application de politiques « par le haut » ou « par le bas », il est aussi des formes de dégagisme qui s’incarnent dans un front de lutte symbolique interne au champ académique et dont le livre de Gérald Bronner et Étienne Géhin, Le danger sociologique(PUF, 2017) est un bon exemple et dont il est intéressant de souligner d’entrée de jeu qu’il a bénéficié d’une visibilité et d’une publicité très importantes, dont on peut faire l’hypothèse qu’elles ne sont pas seulement la conséquence d’un marketing éditorial efficient, mais qu’elles résonnent aussi avec une demande sociale propre à la période.
Un article d’Acrimed pointe en effet l’attention toute particulière qui a été apportée à cet ouvrage, y compris sur les antennes de la radio publique et de l’opportunité que cela a représenté, pour un ensemble de journalistes, de dire leur détestation de la sociologie. Bernard Lahire note que ce sont les médias qui ont organisé la sortie de cet ouvrage comme un événement, donné un peu partout la parole à Bronner et caricaturé la sociologie critique comme une simple collection d’opinions politiques déterministes, c’est-à-dire, dans leur esprit, non-scientifiques. L’un des arguments centraux de Bronner et Géhin est précisément d’avancer que les sciences sociales doivent se départir de leur gangue idéologique pour recouvrer une scientificité digne des sciences de la nature, de la cumulativité et du principe d’une stricte réfutabilité. Le refrain est d’ailleurs entonné par nombre d’autres confrères tel Jean-Louis Fabiani qui dans l’émission de FranceCulture Du grain à moudreévoque, par exemple, les velléités « prophétiques » et le « pathos social » de Pierre Bourdieu. Dans le récent ouvrage (Seuil, 2016) qu’il lui consacre, sous-titré « un structuralisme héroïque », Bourdieu est notamment dépeint, à la fin de sa vie, comme obsédé par une réflexivité autocentrée et la nécessité de montrer qu’il aurait été l’initiateur d’une révolution symboliquemajeure. Si, en l’espèce, il ne s’agit pas encore tout à fait de faire passer la critique pour une fantaisie romantique, Bronner et Géhin, eux, n’hésitent pas à faire le pas et à considérer la critique comme un héroïsme réservé aux indignés qui se voudraient davantage du côté du bien que du vrai. On connaît la réfutation que Bourdieu apporte à cet argument qui ne date pas d’aujourd’hui, tant s’en faut. La dichotomie entre scholarship et commitmentest, selon lui, inepte dans la mesure où il faut être un savant respectueux des règles du scholarshippour pouvoir produire un savoir engagé, c’est-à-dire un scholarship with commitment. Cette opposition permettrait juste à certains chercheurs de se croiredoublement savants, parce qu’ils ne font rien de leur science ajoutait-il.
C’est pourtant au nom de cette séparation factice et stérile que Bronner et Géhin entendent donner une place importante aux sciences cognitives et à la neurobiologie. Ils estiment que les neurosciences démontrent que le cerveau fait fatalement de l’individu un sujet social inventif et doté d’un puissant libre-arbitre. Cette référence aux sciences cognitives est bien dans l’esprit du temps. Le prix Nobel d’économie Richard Thaler, n’est autre que la tête de pont du courant Behavioral Economics. Les neurosciences sont aussi de plus en plus présentes en France, par exemple dans des politiques gouvernementales. Le Ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a ainsi mis en place un conseil scientifique de l’éducation nationale dont l’objet est de développer une pédagogie qui, enfin, serait fondée sur de réelles preuves scientifiques. À la tête de cette instance de consultation se trouve un professeur de psychologie cognitive expérimentale du Collège de France, Stanislas Dehaene, qui estime que l’enseignement est une science et affirme que ce qui le motive, c’est d’agir indépendamment de toute idéologie.
On l’aura compris, il s’agit donc d’opposer la science à l’idéologie, la sociologie analytique à la sociologie critique et, depuis ce grand partage, ripoliner les vieilles lune de la neutralité axiologique, de la suspension des jugements de valeur, et revigorer la détestation du principe de totalisationconsidéré par les sots comme une forme de généralisation abusive. Bronner n’a d’ailleurs de cesse de justifier son retour à un positivisme naïf au nom de la complexité d’un réel qui pourtant pourrait être finalement ramené à l’individu, ses comportements et ses calculs. Il y a là comme une évidente aporie. Or opposer les sciences cognitives aux sciences sociales au nom de leur plus grande scientificité, c’est s’interdire de penser que les capacités cognitives sont évidemment aussi le produit de la socialisation et indissociables des formes de vie sociale.
Dans un ouvrage codirigé avec Claude Rosenthal (EAC, 2008), Lahire souligne à raison que le rôle des sciences sociales est d’analyser la formation sociale et la variation des structures mentales-comportementales, et d’ancrer dans des configurations historiques ce qui apparaît aux sciences cognitives comme des réalités universelles. La contextualisation par la prise en compte à parts égales de l’histoire et des relations d’interdépendances à différents niveaux d’échelle se présente comme le travail de base des sciences sociales les plus sérieuses.Historiciser des états de fait, dénaturaliser et défétichiser les évidences, désessentialiser les différencialismes aveugles aux milieux, penser les évolutions et les transformations sociales réelles… Il ne s’agit pas de faire autre chose que cela et c’est évidemment énorme. Or c’est au nom de la scientificité et contre l’idée d’une science normativement fondée que Bronner et Géhin s’opposent justement à la prise en compte des déterminations sociales et des dynamiques collectives qu’ils considèrent comme des instances métaphysiques sans existence réelle, et ce, au profit de ce qui se passerait « dans la tête des acteurs » et au nom de l’imprédictibilité fondamentale des faits mentaux et sociaux. Parallèlement à ce qu’ils nomment le « biais d’agentivité » – syntagme qui, sous leur plume, désigne une critique de la supposée fictionnalisation de la réalité sociale par invention d’instances collectives et de structures prescriptives –, ils récusent l’idée que toute production scientifique est le précipité d’un regard qui est toujours le fruit d’un point de vue qu’il s’agit d’objectiver.
Bronner et ses comparses lancent là une énième tentative de dépolitisation et de désarmement du savoir sociologique que d’aucuns aimeraient bien éloigner de toute velléité à prendre (sa) part aux processus de transformation de la société.C’est au principe de ce genre de considérations que Bourdieu est devenu ce « mandarin rouge » haïssable, à partir du moment où, au mitan des années 1990, il a pris fait et cause pour le mouvement social et reconnu plus explicitement qu’auparavant, le lien existant entre le savant et le politique. Une des manières de se débarrasser de vérités gênantes, affirmait justement Bourdieu, est d’affirmer qu’elles ne sont pas scientifiques, mais politiques.Bronner et Géhin voudraient donc faire le ménage et reprennent à cet effet la ritournelle de la supposée nécessaire désextrémisation et décomplotisation de la pensée sociologique qui, dans une perspective critique, aurait notamment le tort, depuis ce qu’ils considèrent comme un « populisme de la résistance », d’essayer de saisir les phénomènes de domination. Comme le rappelle Lahire, les dominations et les inégalités sont néanmoins des faits qui s’observent, se mesurent, s’objectivent et ne sont pas seulement des constructions théoriques hors sol. Le problème que pose la critique à Bronner et Géhin est qu’elle dénaturalise, démystifie, qu’elle défétichise et par là, dérange les intérêts de ceux qui ont précisément intérêt à maintenir sous cape un certain nombre de faits et en particulier ceux qui tendraient à expliciter le caractère construit de leurs positions dominantes, si ce n’est en certains cas de leurs privilèges. Dans les pages du Point, Alain Touraine affirme ainsi que la sociologie critique ne serait « qu’une sorte de pseudo-marxisme qui réduit tout à l’inégalité ».
Cette argumentation rentre par ailleurs en résonnance forte avec les propos tenus par certains médiacrates et hommes politiques quant au « sociologisme » et à la « culture de l’excuse » qui traverseraient les sciences sociales. Dans cette variante, le dégagisme à l’encontre de la critique est justifié par les supposés discours de déresponsabilisationque tiendraient les sciences sociales. On a pu lire ce genre de niaiseries dans le livre de Philipe Val, ex-éditorialiste de Charlie Hebdoet islamophobe convaincu : Malaise dans l’inculture(Grasset, 2015), dont le titre détourne celui du célèbre ouvrage de Freud et dans lequel il dénonce le sociologisme qui excuse. Dans un entretien donné à L’Express, il affirme qu’une certaine sociologienie la responsabilité et la liberté de l’individu. Il ajoute que quand on en fait une idéologie, ça provoque des millions de morts… Lahire a courageusement consacré une quarantaine de pages de Pour la sociologie. Et pour en finir avec une prétendu « culture de l’excuse »(La Découverte, 2016) à ce tissud’imbécilités qui fait de la sociologie le nouvel avatar d’une vision que Val qualifie de « stalino-marxiste ».
De son côté, Manuel Valls, quand il était Premier ministre, affirmera, à propos d’analyses tenus par des chercheurs en sciences sociales sur les phénomènes de radicalisation – expliquant que les terroristes sont, qu’on le veuille ou non, le produit de la société au sein de laquelle ils ont vécu –, en avoir marre de « ceux qui cherchent en permanence des excuses ou des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s’est passé » (i.e.aux attentats du 13 novembre 2015). Pour l’ancien séide du libéralisme socialiste, « il ne peut y avoir aucune explication qui vaille. Car expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser ». Si, en ce cas d’espèce, la saillie vallsienne paraît à tout le moins outrancière, des raisonnements similaires se développent au sein même du monde des sociologues, comme par exemple sous la plume de Thierry Tirbois, enseignant à Paris-Sorbonne, qui écrit sur le blog nonfiction.fr qu’à force de dire aux enfants de milieux modestes qu’ils ne peuvent y arriver, ils finissent par le croire !
Dans leur contribution au numéro de novembre-décembre 2017 du Débat, Bronner et Géhin enfoncent le clou des supposés savoirs-croyances produits par la critique. Ceux-ci dévitaliseraient les notions de mérite, de responsabilité ou de moralité et conduiraient à une « culture de l’excuse ». La critique serait donc complice d’un « biais d’auto-complaisance » et les chercheurs critiques devraient réfléchir à deux fois avant de mettre en avant la force des déterminations sociales, car l’exercice pourrait conduire à une forme d’advocacy researchqui produirait ce qu’elle cherche en le cherchant ! On peut aussi lire ce genre d’inanités dans un livre de Danielle Tartakowsky, ex-Présidente de l’Université Paris 8 et historienne marxiste spécialiste de la manifestation qui, dans son ouvrage intitulé Construire l’Université au XXIesiècle, dénonce, sans ciller, l’excellent ouvrage de Nicolas Jounin, Voyage de classe(La Découverte, 2014), livre de sociologie critique qui « instrumentaliserait » Bourdieu (sic) et démontrerait aux étudiants qu’ils sont sociologiquement condamnés à demeurer des exclus. Elle affirme préférer Eloquentia, initiative populiste qui propose à ces mêmes étudiants un programme d’expression publique et d’éloquence qui, selon ces termes, permettrait de combattre les obstacles psychologiques et les réflexes d’autocensure qui paralyseraient les jeunes qui auraient intériorisé les stigmates dont les médias ou d’autres les affublent. Ou quand les bateleurs en tous genres sont distingués et les enseignants-chercheurs scrupuleux et innovants dénigrés…
Bronner et Géhinavancent donc logiquement que certainsdiscours sociologiques critiques diffusés dans l’espace public peuvent représenter un danger. Lahire a largement répondu à cet argument dans Pour la sociologie,ainsi que dans quelques émissions radio et articles. Invité par Caroline Broué dans son émissionLa Grande table, il a rappelé que derrière les attaques visant le « sociologisme », c’est-à-dire une supposée dérive des analyses sociologiques, ce sont bien les sciences sociales en tant que telles et encore davantage leurs développements critiques qui sont visés et décriés.
L’accusation, reprise lors de cette émission par l’essayiste Brice Couturier, tient à ce que la sociologie, en tâchant d’expliquer et de comprendre exonèrerait les individus et en ferait des victimes plutôt que des coupables, en renvoyant toutes les causes des actions qu’ils peuvent commettre du côté de la société et des déterminations liées aux milieux sociaux, notamment aux détriments des vecteurs idéologiques et culturelles. Lahire a eu raison de rappeler qu’il s’agissait là d’une erreur grossière de découpage. La culture, l’idéologie, la religion, la communication, le politique, etc., ne sont pas des domaines autonomes qui auraient une réalité propre, en dehors du social. Le prétendre c’est ne rien y comprendre, tout comme de considérer qu’expliquer ce qui rend probable et possible les faits sociaux, ce serait les cautionner. En revanche, les détracteurs sagaces des sciences sociales et de la critique ont très bien perçu le rôle que celles-ci peuvent jouer dans la mise au jour des logiques de domination à l’œuvre et des visions conservatrices qui les justifient par des discours mâtinant naturalisme et philosophie de la responsabilité individuelle. Pour donner un exemple simple, Lahire évoque les pauvres qui, dans cette perspective, sont pauvres parce qu’ils ne se sont pas donnés les moyens de s’arracher à leur condition et les riches qui seraient riches du fait des efforts qu’ils auraient consenti à faire pour devenir riches. Nous ajouterons que cette vision simpliste de la réalité sociale évite surtout tout effort dialectique permettant de montrer non seulement que la distribution inégale des richesses n’a pas grand chose à voir avec des degrés de volonté et de responsabilité différenciés, mais, surtout, empêche de penser que la richesse des uns peut être la cause de la pauvreté des autres.
On l’aura compris, l’idée sur laquelle fait fond ce battage tient à ce que la sociologie critique serait par trop politique, notamment quand elle s’attaquerait à montrer en quoi les inégalités et les formes de domination sont produites et reproduites par des institutions, des structures, des systèmes qui n’ont rien de naturels et qu’il s’agit de ne pas méconnaître si l’on veut les combattre. Ce but politique de la critique qui vise à suspendre l’adhésion préréflexive au monde tel qu’il va et qui veut se mêler à sa manière et depuis ce qu’elle est de la praxis socialetend à être fortement décriée. L’idée que puisse par exemple se constituer des lieux de débats – journées d’études, colloques, etc. –, mélangeant milieux universitaires et milieux militants est aujourd’hui ouvertement critiquée. Si l’on comprend, pour ne prendre que cet exemple, que les propos d’Houria Bouteldja sur le philosémitisme, le viol, l’homosexualité ou encore la « blanchité » puissent être perçus comme pour le moins discutables, il faut donc les discuter.
À cet égard le n° 197 de la revue Le Débat s’avère très exactement du même tonneau que le Danger sociologique.Dominique Schnapper s’y inquiète évidemment de la politisationde la recherche, qui serait, selon elle, la grande tentation des sociologues français qui viseraient àremplacer la discussion rationnelle par des dénonciations de nature politique. On en déduit donc que la production de connaissances engagées serait nécessairement une opération éloignée de la rationalité. C’est, ce qu’il y a quelques années, faisait avancer à Nathalie Heinich commentant l’ouvrage de Christine Delphy, Classer, dominer. Qui sont les autres(La Fabrique, 2008), qu’aucun des textes du recueil en question n’aurait pu trouver place dans une revue scientifique, « même de bas niveau » ajoutait-elle, et que Delphy usurpait son poste de chercheuse au CNRS. Si la sociologie ne saurait être, pour Heinich et quelques autres, un sport de combat, elle pourrait, semble-t-il, sonner l’ouverture de la chasse aux sorcières. Pour sa part, Pierre-Michel Menger, estime que la critique dénonce davantage qu’elle analyse et démontre.Il oppose deux ontologies : une première, critique, qui n’aurait vocation qu’à inscrire les faits sociaux dans des systèmes de contraintes, rabattrait toute explication sur le consentement inconscient à l’arbitraire des rapports de force et aurait, par conséquent, quelque difficulté à penser le mouvement, l’innovation le changement. A contrario, une seconde ontologie, non critique, donnerait tout « crédit à la qualification processuelle de la réalité » contre « la menace fataliste de l’éternel retour du même ». On trouve également, dans cette livraison hivernale du Débat, Nathalie Heinich, fidèle au poste d’arbitre des élégances sociologiques. Elle nous livre un « Misère de la sociologie critique » qui étale une nouvelle fois, sans surprise, sa détestation des sciences sociales engagées.À son habitude, elle considère les approches critiques comme relevant de la préhistoire de la discipline et rejette la normativité dans le préscientifique. Pour l’ex-étudiante de Bourdieu, la science ne peut bien sûr avoir partie liée avec le politique et le constructivisme critique qui, selon Marcel Gauchet, serait un « inexistentialisme ». Gauchet qui, au passage, estime, lui aussi, que les sciences sociales ne nous apporteraient plus grand chose dans la mesure où elles se seraient rendues incapables de saisir ce qui se passe dans la tête des gens. Pour Heinich, la critique serait doxique et dogmatique quelles qu’en soient les versions – École de Francfort, sociologie de la domination, études de genre, etc. – et interdirait que soient énoncées certaines vérités. La proscription du vrai est pourtant précisément ce qu’elle préconise en estimant, par exemple, que l’antisexisme devrait rester cantonné à la sphère militante, voire en suggérant que la sociologie pourrait, en l’espèce, n’avoir aucune vérité scientifique à produire sur la question. Olivier Galland, autre mousquetaire du Débatfaisant feu sur la critique estime que ce qu’il nomme la « sociologie du déni » produirait des discours victimaires.
De fait, dans Le Danger sociologiqueet ses avatars, ce qui est attaqué, ce sont les approches holistiques qui refusent de décorréler l’individuel et le collectif, l’un faisant l’histoire de l’autre et réciproquement, parce que cette dialectique heurte frontalement le raisonnement libéral. Dans Socialisme et sociologie(éditions EHESS, 2017), Lemieux et Karsenti soulignent à raison combien l’économie, le droit ou encore la psychologie entretiennent un lien étroit avec le libéralisme, c’est-à-dire avec les disciplines qui privilégient l’individualisme méthodologique.Ils nuancent toutefois le propos en précisant qu’il s’agit, dans ces disciplines, d’une tendance et que les courants internes qui ne s’y conforment pas y sont généralement critiques et minoritaires. Il faudrait voir ce qu’il en est pour d’autres sciences sociales autonomisantes, comme par exemple les sciences de l’information et de la communication (SIC) ou les Cultural Studies; effectuer un travail d’enquête précis sur les tendances intellectuelles de ces sous-champs et se donner les moyens de rendre compte de la structuration de ces régions épistémologiques depuis les rapports plus ou moins affinitaires qu’elles entretiennent à l’individualisme méthodologique. Pour ce qui concerne les SIC, la chose nous semblerait tout particulièrement intéressante dans la mesure où elles ont un statut épistémique fort singulier. Elles se présentent comme des sciences sociales particulièresen ce qu’elles choisissent d’abstraire une catégorie de phénomènes sociaux à étudier, sauf que cette opération de spécification par la communication les maintient à un étiage qui serait plutôt celui d’une science synthétique. Ce flou des approches dites « communicationnelles » ou la diversité des épistémologies des Studiesconduit à des positionnements fort variés quant à la place à octroyer aux explications faisant la part belle, en dernière instance, aux comportements individuels.
Pour donner un exemple qui nous touche directement, la recomposition du CEMTI, avant désintégration, en deux équipes a été justifiée par certains collègues par la nécessité de donner « toute son importance aux choix individuels de chercheur.e.s » et de « ne pas représenter la société comme un seul ‘‘sujet en grand’’ dominé par des structures économiques et sociales, aussi puissantes soient-elles ». On s’étonnera que de telles « puissantes structures » puissent ne pas être prises en compte, mais aussi que de la préséance accordée à la totalité puisse se déduire mécaniquement un manque d’attention accordé aux cadres de pensée, aux subjectivités et aux processus de subjectivation. Être vent debout contre la raison dialectique, le paradigme holistique et le principe de totalisation amène ainsi à proférer quelques assertions pour le moins approximatives. De surcroît, cela ne vaccine évidemment pas contre le fait de nourrir quelque prétention à l’hégémonie théorique et de considérer ses propres modèles d’analyse comme devant être au cœur de la réforme des sciences sociales (la modestie fait rarement bon ménage avec les egos aux volumes « montgolfiers ») dont on souhaite qu’elles se fragmentent en une myriade de Studiesqui, enfin, feraient droit à la diversité et l’expressivité du chercheur.e comme de l’enquêté.e.
Dans sa Théorie du sujet(Seuil, 2008), Alain Badiou affirmait que le fait de ne pas céder sur certains éléments théoriques ou éthiques conduisait généralement à se faire accuser de stalinisme. L’effort de totalisation considéré comme antichambre du totalitarisme et/ou comme barrière à penser le complexe, l’imprédictible et l’individu est toutefois une ritournelle bien peu convaincante sur laquelle nous avons déjà eu l’occasion d’échanger lors de séances précédentes, aussi je ne développerai pas. Je voudrais juste souligner que récuser l’effort de totalisation, c’est tout bonnement s’interdire une pensée robuste des ordres sociaux et prendre le risque de voir dans le moindre bricolage, détournement, décodage ou dans le nombrilisme et l’individualisme, des gestes et des dispositions qui pourraient être révolutionnaires. Dénigrer les approches holistiques, c’est faire comme si l’histoire pouvait être soluble dans le spectacle, le social dans les fluctuations individuelles et la critique radicale – celle qui va à la racine – soluble dans le brouet postmatérialiste. La chose est d’ailleurs d’autant plus étrange chez des collègues qui ont tendance à considérer, depuis un foucaldisme mal digéré, que toute situation est toujours l’exercice d’un pouvoir qui s’appuie sur des micro-violences répétées qui font système. Ledit « système » ne serait-il pas une bonne raison d’en revenir au principe de la totalité, sauf à le confondre et le réduire à la « systématicité », c’est-à-dire un quelque chose qui pourrait être ramené à une volonté individuelle implacable qui s’exercerait aux dépens d’une autre ?
C’est là un point important et j’en terminerai avec ça. Il est me semble-t-il bine mis au jour dans la controverse entre Philippe Corcuff et Elsa Rambaud, suite à la publication par cette dernière d’un article dans la RFSP (vol. 67, n° 3, 2017), intitulé « La ‘‘petite’’ critique, la ‘‘grande’’ et ‘‘la’’ révolution ». Je ne rentrerai pas dans le cœur de cette controverse, mais je voudrais juste préciser que les critiques qu’adresse Corcuff à Rambaud en viennent, à un moment donné, à être ramenées à un forme de domination exercée par un homme d’âge mûr condescendant, sur une jeune chercheuse. Corcuff est ainsi accuser de céder à une « domestication du corps des universitaires », de se livrer à une « excommunication épistémologique et politique » ad hominemet de « remettre à sa place », depuis une position mandarinale, une dominée du champ. Corcuff voit dans ce reproche le symptôme « d’un implicite égocentré, ayant du mal à détacher une production particulière du tout que constituerait une personne ». Et d’ajouter : « On voit déjà qu’une série de présupposés actifs dans les milieux académiques des sciences sociales aujourd’hui freinent les possibilités de débats critiques, en particulier des préjugés idéalistes et subjectivistes quant à l’activité intellectuelle et, au sein de ces derniers, des tendances égocentrées, particulièrement activées par les dispositifs institutionnels d’individualisation des travaux, des carrières et des reconnaissances, et encore davantage avivées dans un contexte néolibéral d’exacerbation des concurrences interindividuelles autour de postes raréfiés ».
Le passé proche de notre environnement de recherche en donne, hélas, une preuve supplémentaire.