Journée d’étude — Uzeste carrefour des possibles : communisme, commun(s), communalisme et communautés libertaires – Uzeste/Théâtre amusicien – 7 juillet 2019



10h – POLITIQUES D’UZ : RETOUR SUR UN ENGAGEMENT – Julie Denouël (CREAD – Université Rennes 2)

11h15 – LES « EN-DEHORS » : MILIEUX LIBRES ET COLONIES LIBERTAIRES À LA BELLE ÉPOQUE – Anne Steiner (SOPHIAPOL – Université Paris Nanterre)


14h30 – LE MUNICIPALISME LIBERTAIRE DE MURRAY BOOKCHIN – Floréal Romero (paysan, chercheur indépendant)
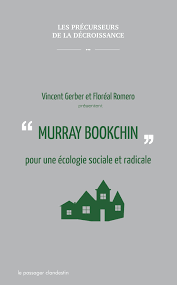

15h45 – DU/DES COMMUN(S) – Fabien Granjon (EXPERICE – Université Paris 8)

Castoriadis (Cornélius), L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1999.
Coriat (Benjamin) dir., Le retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015.
Dardot (Pierre), Laval (Christian), Commun. Essai sur la révolution au XXIesiècle, Paris, PUF, 2014.
Garo (Isabelle), Communisme et stratégie, Paris, Éditions Amsterdam, 2019.
Glissant (Édouard), Philosophie de la relation. Poésie en étendue, Paris, Gallimard, 2009.
Hardt (Michael), Negri (Antonio), Commonwealth, Paris, Gallimard, 2012.
Laval (Christian) et al., dir., L’alternative du commun, Paris, Hermann, 2019.
Nicolas-Le Strat (Pascal), Le travail du commun, Rennes, Éditions du commun, 2016.
* * *
Pour ce qui me concerne, je souhaiterais partager avec vous, deux-trois choses sur la question des communs(au pluriel) et du commun(au singulier) ; le commun au singulier pouvant être provisoirement pensé comme la condition de possibilité des communs au pluriel. Dans ma pérégrination, je mêlerai à la fois des auteurs qui ont travaillé sur ces questions du ou des communs (Dardot, Laval, Hardt, Negri, Nicolas-Le Strat, Garo, etc.), avec d’autres, sans doute moins, voire pas du tout, attendus sur ces questions, à l’instar de Castoriadis, Glissant ou encore Tassin. Par ailleurs, ce que je dirai, du et des communs, est mû par un intérêt sincère pour ce qu’ouvre la problématique éponyme dont il me semble qu’elle peut jouer un rôle non négligeable notamment dans le réarmement critique pratique à un niveau local et, dans le même temps, cette problématique du/des communs n’est évidemment pas sans poser problème, notamment quand elle voudrait jeter aux orties la question du contrôle de l’État ou se substituer à l’idée plus globale de la nécessité communiste.
Il ne vous a pas échappé que la thématique des communs est presque devenue une antienne dans certains milieux à gauche, dans le cadre de nombre d’expérimentations économico-culturalo-politiques actuelles (e.g. au sein du mouvement des lieux intermédiaires et indépendants), et « d’ici d’en bas », à Uzeste, le terme est très souvent « UZ-ité ». Comme le précisent Christian Laval, Pierre Sauvêtre et Ferhat Taylan dans leur ouvrage sur L’alternative du commun : « combats sociaux, alternatives économiques, mobilisation écologique, innovations urbaines, lutte démocratique et potentialité du numérique sont en train de se rejoindre dans une même références aux communs, perçus et conçus comme les conditions et les bases de toute vie collective » (2019 : 6). Cette convergence ferait ainsi du commun « un régime de pratiques, de luttes, d’institutions et de recherches ouvrant sur un avenir non capitalistes » (Dardot, Laval, 2014 : 17).
Je souhaiterais faire rapidement, trop rapidement sans aucun doute, le point sur ces notions en sachant que je serai donc obligé de faire l’impasse sur certains développements qui seraient sans doute utiles, mais qui nous mèneraient bien au-delà du temps qui nous est imparti.
La première chose que l’on peut dire, c’est que si le thème des communs squatte le devant de la scène critique, ce n’est pas tout à fait un hasard. Cet intérêt pour le et les communs exprime en effet une volonté de répondre à une série de manœuvres des marchés et des entreprises capitalistes aidés par les États, à grand renfort de contrats, de lois et de décisions judiciaires, manœuvres dont le but est d’imposer l’extension du domaine de la propriété. Cette dynamique de renforcement rapide des droits de propriété sous le double coup de la rationalité néolibérale et du pouvoir étatique est telle, que l’on parle à son propos de Second mouvement des enclosures, lequel mouvement viendrait donc forclore de nouvelles sphères de propriété et étendre les droits alloués d’exploitation. Cette extension des droits de propriété est qualifié de second mouvement des enclosures en référence à ce qui s’était passé en Angleterre à la fin du XVIèmesiècle, à savoir la privatisation de ressources spatiales qui jusqu’alors étaient des biens communs.
Une enclosure est un processus par lequel des intérêts privés arrachent des ressources de leur contexte naturel ou traditionnel, souvent avec le soutien et la bénédiction d’un État, pour en faire des marchandises qui seront désormais évaluées à travers un prix sur un marché. L’enclosure consiste donc à convertir des ressources partagées et utilisées de manière large, en ressources propriétaires, sous contrôle privé et ces ressources visent alors à être traitées comme des marchandises négociables. Il est aussi important de préciser que les enclosures ne sont pas seulement une appropriation des ressources, une marchandisation de biens communs, mais ce sont aussi des attaques contre les communautés citoyennes d’usagers, leurs pratiques et leurs traditions de faire commun à tout le moins en certains endroits. L’objectif principal des enclosures est certes l’accaparement des ressources, mais il cherche aussi à imposer aux personnes un véritable changement de régime de vie. Les enclosures visent de fait à convertir un système de gestion collective et de mutualité sociale en marché privilégiant la propriété privée, les prix, les rapports mercantiles et le consumérisme. Il s’agit donc de traiter les individus non plus comme membres à part entière d’une communauté de vie partageant des intérêts et des biens communs, mais comme des individus isolés et des consommateurs.
Théoriquement, la nécessité des enclosures a été notamment justifié par un texte maintenant assez connu de Garret Hardin intitulé La tragédie des communs, qui a été récemment réédité à l’occasion de son jubilé, aux PUF, en 2018. Dans ce texte publié originellement dans le numéro 162 de la revue Science, en 1968, Hardin considère la situation selon lui exemplaire, d’un champ dans lequel tous les éleveurs ont le droit de faire paître leurs troupeaux. Si l’accès à la ressource « champ » est vraiment libre affirme-t-il, chacun sera tenté d’ajouter des bêtes à son cheptel pour profiter au maximum de cette ressource commune. Et ce faisant, les paysans finiront par entraîner l’épuisement du champ et, partant, entraîneront la ruine de tous. La conclusion d’Hardin est alors claire : seule l’attribution de droits de propriété individuels est à même d’éviter ce qu’il appelle donc la tragédie des communs, c’est-à-dire l’épuisement de la ressource, en l’espèce le pâturage, car cette attribution de droits de propriété individuels est selon lui, le seul moyen de susciter un intérêt personnel des agents économiques pour l’entretien et la gestion rationnelle des ressources.
Malgré le caractère très sommaire de ses analyses, le texte de Hardin est devenu le fondement théorique de référence quand il s’agit de discréditer des formes d’organisation sociale ne reposant pas sur l’appropriation privative des ressources. Son article est en fait une défense catégorique de la propriété privée qui se fonde sur une anthropologie très rudimentaire, celle de l’homo œconomicus, faisant de l’intérêt individuel le seul moteur et la seule régulation raisonnable de l’action humaine.
Le raisonnement de Hardin était, à l’origine, censé s’appliquer uniquement au monde physique, à des biens naturels qui existent en quantité limitée et dont la jouissance est concurrentielle, en l’occurrence l’herbe du champ ; mais dans le cadre du second mouvements des enclosures, la variété des domaines visés est extrêmement large, notamment en ce que ces nouvelles enclosures sont liées à la notion juridique d’inventiontelle que définie dans les brevets et les droits de propriété intellectuelles et qu’elle peut donc toucher aux plantes, aux semences, aux idées, aux savoirs traditionnels, aux connaissances scientifiques et même au langage. Le renforcement de la propriété intellectuelle est bien évidemment un renforcement des droits privés exclusifs et de l’idéologie propriétaire, lesquels sont censés assurer l’efficacité des marchés. Benjamin Coriat note à cet égard que « la crise des subprimes elle-même – qui consistait à fabriquer des instruments financiers pour transformer en ‘‘propriétaires’’ [fonciers] des ménages notoirement insolvables – relève de cette idéologie propriétaire » (2015 : 10).
À cette extension du droit de la propriété exclusive on peut évidemment ajouter le démantèlement des services publics au sein de ce qui reste des welfare states et de la perte de contrôle des citoyens sur un ensemble d’institutions qui sont, pour partie, ou entièrement privatisées. On a notamment, dès le premier septennat de Mitterrand assisté, après une vague de nationalisations, à un immense transfert de biens et de capitaux de l’État du secteur public au secteur privé : privatisation des compagnies publiques de chemin de fer, des entreprises nationalisées des charbonnages, de la sidérurgie, des chantiers navals, de la production et distribution d’eau, de gaz et d’électricité, de la poste, du téléphone et de la télévision ; plus récemment : les autoroutes, le transport ferroviaire, les barrages hydroélectriques, les grands aéroports, les télécommunications, on parle même des routes nationales. On a également assisté à la privatisation partielle des mécanismes d’assurance sociale, de la retraite, de l’enseignement supérieur, de l’éducation scolaire, de la santé, etc. Et puis de manière plus large encore, on assiste aussi à l’introduction des mécanismes concurrentiels et de critères de rentabilité dans l’ensemble des services publics. Bref, l’État tend à ne plus jouer le rôle qui a été le sien après-guerre de redistributeur des richesses et de régulateur de l’économie. C’est même grâce à son action dans différents domaines, dont certains éminemment centraux comme la santé, que de véritables monopoles ou quasi-monopoles se sont développés. Dans le domaine de la pharmacie par exemple, on constate que la recherche scientifique privée (faut-il le rappeler, rendue possible par la formation et la recherche publiques) n’investit que les domaines susceptibles de produire des médicaments rentables (le paludisme, parmi les premières causes de mortalité dans le monde n’intéresse, par exemple, de fait aucun de ces acteurs). Des entreprises comme Mital, Monsanto, Pfizer, Roche, Apple, Amazon, Google ou d’autres en position de monopole, ne sont pas spécialement connus pour leur philanthropie. L’exemple le plus probant c’est évidemment celui de Microsoft qui a mis à profit son contrôle sur 90 % des systèmes d’exploitation d’ordinateur, via Windows, pour accroître les ventes de ses applications de bureautique en faisant pression sur les fabricants pour qu’ils intègrent par défaut les logiciels Office dans leurs ordinateurs. Cette stratégie a permis à Microsoft d’étouffer la concurrence, d’amasser d’énormes profits et à Bill Gates de devenir l’un des hommes les plus riches du monde.
Des communs
Face à ce renforcement des droits de propriété, ce sont toutefois révélées des initiatives allant plus ou moins frontalement contre cet élargissement des droits de propriétés, notamment intellectuelles. Je ne souhaite pas développer ce point en particulier, mais le domaine du numérique a été le lieu, comme vous le savez, de nombreuses innovations pratiques et juridiques : logiciels libres, licence GPL, Copyleft, licence Creative Commons (sous laquelle est par exemple commercialisé notre ouvrage Politiques d’UZ), Open data, Wikipédia, P2P, etc., initiatives dont l’objectif est d’inclure et de permettre le libre accès au plus grand nombre. Ces dynamiques de résistance aux nouvelles enclosures ont donc pris globalement la forme d’une lutte pour les communs (au pluriel), en s’appuyant notamment sur le travail d’une économiste nobélisée en 2009, Elinor Ostrom, qui a inspiré le développement « de formes juridiques et institutionnelles novatrices [qui] entendent tout à la fois assurer l’accès à des ressources partagées, et donner naissance à des alternatives aux constructions institutionnelles assises sur l’exclusivité des droits » (Coriat, 2015 : 11).
Dans un ouvrage sortie il y a maintenant presque 30 ans, Governing the commons (1990), Elinor Ostrom va faire valoir qu’il existe d’autres mécanismes que l’appropriation privative et qu’il est possible à des individus de s’auto-organiser et de s’autogouverner pour gérer des ressources rares, sans passer par la propriété privée. De même, la régulation par une autorité centrale, dont au premier chef celle de l’État qui, tout en renforçant sans cesse son socle bureaucratique brade dans le même temps ses capacités régulatoires et d’intervention dans le domaine social, culturel et éducatif, eh bien cette régulation centrale est envisagée comme devant être soumise à l’activité sociale et à la participation politique du plus grand nombre. On peut bien évidemment discuter de l’intérêt pour le RIC, mais la revendication des Gilets jaunes me semble exprimer, peut-être maladroitement, cette nécessité de la participation politique directe dans la décision et dans la gestion des affaires communes.
Ostrom va donc réhabiliter la notion de « communs » au pluriel, en la liant à des communautés bien délimitées, et à des règles négociées permettant de gérer adéquatement les ressources mises en propriété partagée. Mais elle va également s’efforcer d’adapter son modèle des communs pour l’essentiel fondé sur des études de cas de gestion de ressources naturelles, à la gestion de ressources d’un autre genre : des ressources immatérielles. Avec Charlotte Hess, Ostrom va notamment diriger un ouvrage intitulé Understanding Knowledge as a Commons (2007), dans lequel elle prend pour emblématique des communs informationnels l’exemple des logiciels libres qui sont présentés comme effectivement produits au sein de collectifs qui s’autogouvernent, de la même manière qu’une communauté de pêcheurs pouvaient s’auto-organiser pour gérer collectivement une zone de pêche.
De fait, ces dernières années, le domaine de développement des communs a plus spécifiquement été celui des communs de la connaissance, que l’on peut définir avec Benjamin Coriat comme « des ensembles de ressources de nature littéraire et artistique ou scientifique et technique dont la production et/ou l’accès sont partagés entre individus et collectivités associés à la construction et à la gouvernance de ces domaines » (2015 : 13).
Les principes des communs tels qu’ils sont alors mis sur le devant de la scène via cette résistance aux droits de propriété intellectuels ne sont toutefois pas entièrement nouveaux dans leur fondement, puisque, rappelons-le, ce à quoi s’intéresse Ostrom au départ, c’est aux pratiques de gestion des ressources naturelles : forêts, chemins communaux, pêcheries, pâturages, accès à l’eau, etc. Mais surtout, ce que souligne Ostrom, c’est que les communssont le produit d’un gouvernement collectifassurant l’accès aux ressources, à leur allocation et à leur entretien sur la base de principes qui ne sont pas ceux du marché, même si la ressource peut produire des biens et services marchandisés. On touche là un point très important puisqu’à la base des communs(au pluriel), il y a une philosophie politique qui est celle du commun(au singulier) de laquelle j’essaierai évidement de vous dire deux mots tout à l’heure, mais dont il me semble qu’elle entretient notamment quelque proximité avec la pensée de Cornélius Castoriadis et de ses concepts de démocratie, d’instituéet d’instituant, de praxisou encore d’imaginaire radical, concepts qu’il déploie dans son œuvre majeure L’institution imaginaire de la société(1999).
Mais au préalable, je vais me permettre de rappeler les principales caractéristiques des communs que j’ai ici tentées de résumer synthétiquement en quatre points qui s’entremêlent :
-première caractéristique : les communs sont des « ensembles de ressources » dont la nature, comme nous l’avons vu, peut être fort variée. Notamment, ils peuvent être matériels/tangibles ou immatériels/intangibles, c’est-à-dire constitués de biens rivaux ou non-rivaux dont la « gestion » peut consister en la préservation de la ressource dans le cas de ce que Ostrom nomme des Common-Pool Resources (stocks constitués d’unités), mais aussi en sa croissance et son extension dans le cas des communs intellectuels qui sont des collections d’informations et de connaissances. Il existe par ailleurs des communs qui couplent ces deux aspects, à l’instar du matériel biologique ou génétique ;
-deuxième caractéristique : ces ressources communes sont collectivement gouvernées « dans le but de permettre un accès partagé aux biens » (Coriat, 2015 : 13). Les communs sont donc des ressources socialisées régies par des règles, des normes, des procédures, des droits et des obligations établis collectivement par une communauté démocratique auto-organisée. Les communs poussent donc à une réflexion sur ce que le juriste français Léon Duguit avait appelé au début du XXesiècle, la fonction sociale de la propriété et plus largement, en ce début de XXIesiècle, à une réflexion sur la création de la valeur au sein des sociétés contemporaines dont la forme de capitalismequi les structurent et que d’aucuns nomment « cognitif » aurait pour caractéristique de généraliser la production de la valeur en dehors même des phénomènes d’exploitation et de la sphère professionnelle. Thomas Coutrot note à cet égard que « la productivité dépend très souvent de la capacité de l’entreprise à utiliser le jeu des normes sociales qui s’établissent dans les collectifs de travail » (Critique de l’organisation du travail).
Pour Michael Hardt et Toni Negri par exemple, il existerait une autre forme de commun(s), de nature biopolitique, qui aurait partie liée avec les nouvelles formes de subjectivité, de vie et de production sociale du capitalisme le plus avancé, lequel nécessiterait que les sujets sociaux disposent d’un haut degré de liberté pour satisfaire à l’impératif de créativité et d’innovation. Autrement dit, la production capitaliste serait aujourd’hui tendanciellement une production de plus en plus immatérielle dans ses processus de valorisation, et l’accumulation capitaliste serait toujours plus extérieure au processus de productionstricto sensu, exploitant la coopération dans ses différentes formes, ce qui rendrait ce capitalisme à la fois plus hégémonique, mais aussi plus fragile dans la mesure où il exploite des franges du travail plus autonomes que le travail salarié, travail dont l’une des caractéristiques centrales tiendrait à ce qu’il serait donc de plus en plus cognitif et impliquerait toujours plus de coopérations sociales. Le capital subsumerait ainsi la société dans son ensemble et notamment le commun biopolitique, c’est-à-dire la vie sociale dans toutes ses largeurs, mais, en quelque sorte, à ses risques et périls. Dans cette perspective hardto-negriste le commun est donc d’abord une forme de social singulier qui serait le nouveau pharmakon du capitalisme : à la fois sa vitamine et son poison, surtout son poison. Hardt et Negri n’hésitent donc pas à écrire que le travail immatériel serait à la base d’un « potentiel pour une sorte de communisme spontané » (in Empire, 2000 : 359) et développent donc une vision un rien finaliste, renouant là avec une forme de déterminisme historique qui postule un vacillement du système capitalisme depuis sa propre dynamique de développement, laquelle serait en quelque sorte devenue révolutionnaire malgré elle. Plus précisément, la question de la révolution et des conditions de sa conduite ne serait plus à l’ordre du jour, remplacée par un intérêt pour les processus d’institution d’une autonomie des sujets par le capitalisme lui-même, autonomie qui n’aurait besoin ni d’être défendue, ni d’être organisée. À ce jour, cet immanentisme critique n’est pas franchement attesté par des faits concrets, tant s’en faut.
L’on peut noter que la problématique du commun repose aussi, et une nouvelle fois non sans problème, la question du travail, de son dégagement de l’emprise du capital, de sa déprolétarisation et de la coopération autonome organisée par les travailleurs eux-mêmes, mais aussi par les usagers et plus largement par les citoyens et leurs organisations, cette coalition permettant de redialectiser le monde de la production et celui de la vie sociale. Dardot et Laval considèrent, à cet égard, la nécessité de produire une institution civique du marché combinant « autogouvernement des producteurs » et « souveraineté collective des consommateurs » (2014 : 543) dont on voit bien au travers des termes employés l’esprit réformiste. Toutefois, sur cet aspect de la démocratie participative liée au(x) communs(s), les expérimentations municipalistes-communalistes (Marinaleda en Espagne, Ovacik en Turquie, Saillans ou Trémargat en France, etc.) restent néanmoins à suivre de près, tout comme certaines initiatives au principe de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler des lieux intermédiaires et indépendants, je pense par exemple aux camarades de l’Asilo à Naples qui ont réussi à produire et à imposer à la capitale de la Campanie de nouvelles normes juridiques quant à l’« usage civique urbain et collectif » de certains lieux qui les sortent des formes de gestion municipale, privée, ou public/privé. Sans majorer la portée générale d’une telle initiative, il ne faut pas pour autant en minorer la portée située (je tiens de la documentation à disposition de celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur cette expérience).
-troisième caractéristique : contrairement à ce que l’on est généralement amené à penser, les modalités pratiques de gouvernement des communs peuvent désigner des catégories de participants qui ne jouissent pas forcément des mêmes prérogatives s’agissant de l’accès et des bénéfices des communs. Benjamin Coriat précise ainsi qu’« Une dimension essentielle des protocoles et procédures [des communs] […] a précisément pour objet la mise en compatibilité des intérêts de ces acteurs distinctsqui participent au commun, en partant du principe qu’ils ne sont pas nécessairement identiques (Coriat ; 2015 : 36). Sous cet angle se pose alors la question de la captation possible des communs et de la valeur des communs par le marché capitaliste. En l’espèce, les communs appellent donc à une réflexion sur la possibilité d’une économie non marchande. D’aucuns (e.g. Michel Bauwens) travaillent par exemple à la mise en place d’une économie éthique ou « sociale et solidaire » et sur le principe de coopératives ouvertes qui se prémuniraient contre les travers classiques des coopératives qui ont tendance à finir leur course du côté des marchés. Il s’agirait ainsi d’établir des statuts internes tournés vers les communs, en construisant un modèle de propriété et de gouvernance fondé sur une approche partenariale, en coproduisant du commun de manière privilégiée et seulement secondairement des marchandises, et en s’organisant autour d’un commun qui, bien que pouvant être local devrait néanmoins viser l’échelle organisationnelle mondiale.
D’aucuns en appellent par exemple à la construction d’une cosmopolitique des communs ou d’un « espace oppositionnel mondial » dont la constitution du réseau des villes rebelles dites « sans peur » (Barcelone, Madrid, Naples, Grenoble, Valparaiso, etc.) ou la tenue des sommets internationaux municipalistes seraient les premières briques d’une « connectivité capable de mettre [les initiatives et expérimentations du commun] en relation à un niveau qui dépasse le régional » (Coccoli in Laval, 2019 : 76). Cette connectivité menace toutefois « le principe même du commun, à savoir l’autogouverment ». En effet s’interrogent Dardot et Laval, « comment penser cette coordination de telle manière qu’elle soit elle-même au principe d’une coobligation de niveau supérieur qui procède de celle qui est propre aux niveaux inférieurs ? » (2014 : 527), question à laquelle vient de suite s’en greffer une autre : « de quelle institution se doter pour qu’un ‘‘autogouvernement translocal’’ ne soit pas un oxymore ? » (Hamou in Laval, 2019 : 339) et une autre encore : le fédéralisme peut-il se passer d’une forme de centralisation démocratique ? La nécessité que porte le commun est donc celle de formes nouvelles d’institution des pouvoirs et d’un gouvernement autonome des sociétés à différents niveaux d’échelle : « Une politique délibérée du commun visera donc, nous disent Dardot et Laval, à créer les institutions d’autogouvernement qui permettront le déploiement le plus libre possible de cet agir commun, dans les limites que se donneront les sociétés, c’est-à-dire selon les règles de justice qu’elles établiront et auxquelles elles consentiront » (Dardot, Laval, 2014 : 460). Autrement dit, le commun invite à « instituer politiquement la société, en créant dans tous les secteurs des institutions d’autogouvernement qui auront pour finalité et pour rationalité la production du commun » (Dardot, Laval, 2014 : 462).
-quatrième caractéristique : contrairement à une idée reçue, les communs ne sont pas une négation des droits de propriété, mais un renouvellement de ces droits sur le principe du bundle of rights, c’est-à-dire d’un faisceau de droits susceptible de déboucher sur des formes de propriété communale, c’est-à-dire des formes de communalisme. Je ne rentre pas dans le détail, mais Ostrom et Schlager définissent cinq droits fondamentaux : les droits d’accès, les droits de prélèvement, les droits de gestion, les droits d’exclusion et les droits d’aliénation. L’écologie sociale et radicale de Murray Bookchin et son municipalisme libertaire relèvent me semble-t-il de ce type de communalisme. Du point de vue du droit de propriété, les communs récusent le principe du droit exclusif de la propriété privée, mais ne se rangent pas pour autant derrière le principe du bien publicouvert à tous. Les communs sont en quelque sorte une option médiane qui définit généralement des droits d’accès et de prélèvement ou d’usage qui s’assortissent d’obligations. Cela veut donc dire que les participants à la gouvernance des communs, celles et ceux que l’on appelle les commoners, peuvent détenir des droits et des positions de pouvoir différenciés, tout en supposant que cette différence peut ne pas produire dans ses conséquences, la production ou l’entretien d’inégalités. Le juriste Léon Duguit affirmait à cet égard :
« La propriété n’est plus dans le droit moderne le droit intangible, absolu que l’homme détenteur de la richesse a sur elle […]. Le propriétaire, c’est-à-dire le détenteur de la richesse a, du fait qu’il détient cette richesse, une fonction sociale à remplir ; tant qu’il remplit cette mission, ses actes de propriété sont protégés. S’il ne la remplit pas ou la remplit mal, si par exemple il ne cultive pas sa terre, laisse sa maison tomber en ruine, l’intervention des gouvernants est légitime pour le contraindre à remplir sa fonction de propriétaire, qui consiste à assurer l’emploi des richesses qu’il détient conformément à leur destination » (Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, 1912 : 20).
Bernard Lubat raconte souvent qu’ici, à Uzeste, le paysan qui ratait sa récolte se faisait remonter les bretelles par la communauté villageoise, car un raté dans la gestion de la ressource commune avait des conséquences générales sur la vie de ladite communauté. On sait aussi, à Uzeste, ce qu’est l’accaparement et donc la gestion décommunalisée de certains biens comme les chemins forestiers…
Pour parler de communsau pluriel, il faut donc qu’il y ait coexistence d’une ressource à laquelle sont accrochés des droits et des obligations, selon un mode collectif de gouvernance. Ce qui nous permet, au passage de considérer que ce dont parlait Garrett Hardin dans sa fameuse « tragédie » ne relevait précisément pas des communs. Et, de même ce qu’il faut qualifier de biens communs (globaux), de choses communes ou ce que le droit romain définissait comme des res communes, comme l’atmosphère, l’océan, le climat, etc., ne sont pas des communsau sens strict, dans la mesure où ils ne sont pas franchement « soumis à une gouvernance permettant de faire respecter les droits d’accès et d’usage des différents prétendants » (Coriat, 2015 : 24). Mais au-delà même des précisions de périmètre, la question qui évidemment arrive assez vite quand on réfléchit un tant soit peu aux communs, tient aux conditions de possibilités d’existence des communsau sein même du système capitaliste actuel et de sa nature englobante. Si l’on voit bien se dessiner la possibilité de communalismes restreints, locaux, municipaux (de nombreux exemples en témoigne et une cycle durant l’hestejadaleur sera dédié), il semble effectivement plus difficile d’imaginer les communstels que nous les avons définis comme levier global d’affranchissement du capitalisme. Le micro-institué, même fédéré comme chez Proudhon ou plus récemment chez Bookchin ou Dardot et Laval, peut-il être envisagé comme un coin révolutionnaire ? La question du dépassement du localisme est une question difficile et qui reste entière à ce stade. Isabelle Garo discute entre autres choses ce point dans son dernier ouvrage et estime que la problématique des communs tend, à l’instar de la démarche d’Elinor Ostrom, à ne pas « prendre en compte les conditions politiques et sociales globales qui permettent – ou non – la construction des biens communs » (2019 : 143). Et d’ajouter : « La centralité conférée à la question des institutions interdit de penser l’État comme forme politique d’un rapport social d’exploitation et de domination, et laisse pendante la question de l’organisation susceptible de combiner le fédéralisme et une perspective centrale maintenue, capable d’en assurer la perpétuation et d’en garantir les principes » (2019 : 149).
Du commun
Les communs, au pluriel, suppose une action d’autogouvernement, une praxis « établissant les règles de l’usage commun et de son prolongement dans un usage instituant procédant à la révision régulière de ces mêmes règles » (Dardot, Laval, 2014 : 477)et relève donc d’une activité de nature foncièrement politique portée par une communauté souveraine et autonome s’appuyant sur les principes de codécision relative aux règles et de coobligation issu de ces règles. Il n’y a donc pas de communs sans dispositif politique qui va avec et que l’on peut appeler le commun, au singulier, ou ce que Pascal Nicolas-Le Strat appelle le travail du commun (2016) et qui n’est autre qu’un travail de production de la démocratie qui pose que toute activité de mise en commun doit être accompagnée d’une élaboration collective et doit faire l’objet d’une gouvernance « par le bas ». De fait, pour Ostrom, le commun a pour principe, d’une part, l’auto-organisation et la coopération ; et d’autre part, l’autogouvernement, c’est-à-dire la collectivisation-horizontalisation des décisions et une méfiance absolue vis-à-vis du principe délégataire et de la « démocratie » représentative. Nicolas-Le Strat précise à cet égard qu’agir et penser « en terme de commun impliquent donc un déboîtement radical car il s’agit bien de défaire cet emboîtement historique constitué par le capitalisme entre État et marché, ‘‘public’’ et ‘‘privé’’. […] [Le commun, ajoute-t-il, pousse] à inventer les formes institutionnelles appropriées aux activités engagées et respectueuses des aspirations communes » (2016 : 30 et 32).
Le commun au singulier en appelle donc à une sorte de philosophie politique. Et si l’on est d’accord pour considérer les communs comme des ressources gérées collectivement par une communauté selon des règles établies par cette communauté, en vue d’un accès et d’une utilisation équitable et soutenable à ses ressources, encore faut-il reconnaître aux communs la nécessité qu’il pose de l’existence d’une éthique du commun qui dépasse les modèles appauvrissant de l’économie libérale actuelle. David Bollier écrit à ce propos : « les communs constituent le terreau dans lequel naissent de nouvelles pratiques sociales de mise en commun (commonings) ; celles-ci nous fournissent des pistes efficaces pour repenser notre ordre social, notre gouvernance politique et notre gestion écologique ». C’est sans doute sous cet aspect d’ailleurs que les communs ont un caractère offensif. Si le principe même des communs au pluriel porte clairement une dynamique défensive de préservation des ressources et de résistance aux prédations capitalistes, le commun (au singulier), se propose, lui, d’imaginer des initiatives plus combatives. Passer des communs (pluriel) au commun (singulier) c’est se donner les moyens de passer de la défense des communs à leur institution et à la « ré-institution générale de l’existence collective sur la base du principe de commun » (Laval et al., 2019 : 8). C’est passer de l’idée de luttes de préservation de ressources à l’idée de combats dont les modes de coopération qui leur sont attenants déterminent autant les manières de lutter (l’ répertoire d’action), ce pourquoi la lutte s’engage et se mène (l’objectif), que les combattants eux-mêmes (les dispositions militantes). L’opposition pratique à un monde ne peut alors être déliée de la construction tout aussi pratique d’autres mondes : la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et son monde, Uzeste et son monde, Lespiet et son monde… Ce qui fait dire à Christian Laval et ses collègues que nous sommes dans une période de « problématisation stratégique du commun » (2019 : 10). Pierre Dardot se demande toutefois si le principe du commun en tant que principe politique posant la nécessité de l’autogouvernement peut réellement être un principe stratégique. La question est lourde et je me contenterai de refiler lâchement la patate chaude à Isabelle, puisque la question stratégique est au cœur de son dernier ouvrage. Isabelle note par exemple que Dardot et Laval « développent une analyse prospective qui répudie le socialisme autant que le communisme, et propose une troisième voie située du côté de l’invention institutionnelle et du contrôle démocratique, à distance de l’État et des organisations politiques existantes » (2019 : 145).
Aussi, le commun tel que nous venons d’en dire deux mots entretient quelque accointance avec la pensée de Castoriadis, notamment avec sa manière de penser la démocratie et la praxis. Pour le philosophe, il faut refuser les sociétés dites démocratiques qui sont au service d’institutions qui ne sont pas en mouvement, qui ne sont pas participablespar toutes et tous et qui figent les règles au service d’intérêts particuliers. Il faut au contraire instaurer « un état de choses dans lequell’homme social peut et veut regarder les institutions qui règlent savie comme ses propres créations collectives, donc peut et veut lestransformer chaque fois qu’il en a le besoin ou le désir ». Le commun a donc avoir avec un pouvoirinstituant tel que le définit Castoriadis, c’est-à-dire un pouvoir de création qui depuis l’institué qu’il crée se donne les moyens de se ré-instituer. Et dans cette perspective, une société juste c’est d’abord une société où la question de la justice et de la validité des normes et lois communes reste en permanence une question ouverte, c’est une société en capacité de s’autogouverner, c’est-à-dire de maintenir ses capacités imaginaires, ses capacités « de voir dans une chose ce qu’elle n’est pas, de la voir autre qu’elle n’est » (Castoriadis, 1999 : 177).
Une société du commun serait donc une société foncièrement autonome qui ne reçoit pas ses lois et ses institutions d’une instance extérieure à elle-même, fût-elle élue et soi disant représentative. C’est une société laissant libre cours à l’auto-institution explicite, réflexive et permanente, une société qui maintient en permanence une dialectique entre l’institué et l’instituant, entre l’histoire faite et l’histoire se faisant (1999 : 161). Si le commun a une portée révolutionnaire, sans doute est-elle dans cette invitation à développer une société a-bureaucratique, capable d’une reprise perpétuelle de ses institutions et de considérer l’émancipation comme un processus dynamique qui est toujours à recommencer, un processus de reprise permanente de la réflexivité par lequel les sujets et les collectifs qu’ils forment s’auto-altèrent et se transforment continuellement en se constituant comme de nouveaux sujets et comme de nouveaux collectifs. Ce point est tout particulièrement saillant chez Hardt et Negri qui estiment que la période actuelle ouvre d’ores et déjà cette possibilité de luttes constituantes à même le capitalisme, lequel, comme le signale avec ironie Isabelle Garo, serait devenu « le meilleur allié du projet communiste » (2009 : 120), et ce, sans même que des luttes organisées en soient à l’initiative.
Dans Fabrique de porcelaine, Toni Negri précise également que le commun n’est pas, « une sorte de ‘‘fond organique’’, ni quelque chose de déterminable du point de vue physique. […] [mais qu’il] se présente sous la forme d’une activité, et non comme un résultat » (2006 : 91-92). Dans la perspective biopolitique qu’il développe avec Hardt, est précisé, comme je vous l’ai indiqué auparavant, que le commun n’est pas extérieur au capitalisme, il lui est pratiquement consubstantiel. Pour Hardt et Negri, le commun serait une dimension immanente aux processus productifs de la nouvelle économie : « en répondant à ses propres besoins, affirment-ils, la production capitaliste contemporaine ouvre la possibilité et les bases d’un ordre social et économique fondé sur le commun » (Hardt, Negri, 2012 : 13). Aussi, les luttes politiques les plus importantes seraient donc celles qui ouvriraient au « contrôle et [à] l’autonomie de la production de subjectivité » (Hardt, Negri, 2012 : 15). Pour Hardt et Negri, il ne fait en effet aucun doute que « l’autonomie grandissante du travail [est] au cœur des nouvelles formes de crise de la production et du contrôle capitalistes » (2012 : 213). Et sous cet aspect, le commun est donc sans doute d’abord un processus de subjectivation ou d’individuation qui conduit à revendiquer à prendre part et à prendre sa part à l’exercice du pouvoir. C’est à cet égard que Pierre Sauvêtre parle de subjectivation du co-pouvoir (in Laval et al., 2019). Contre l’idée d’identités de classe, il s’agirait de valoriser des singularités plurielles parce qu’elles seraient autant de foyers d’auto-destruction du capitalisme.
À l’heure du capitalisme cognitif, la lutte des classes prendraient alors notamment la forme de ce qu’ils appellent l’exode, c’est-à-dire « un processus de soustraction à la relation avec le capital par l’actualisation de l’autonomie potentielle de la force de travail » (227). L’exode serait donc le refus des formes d’exploitation posées par le capitalisme au travail biopolitique et la construction de nouvelles formes de vie qui utilisent à d’autres fins la puissance de ce travail biopolitique. Au cœur de cet exode il y a, pour Hardt et Negri, la possibilité d’un pouvoir constituant dans le cadre duquel l’imaginaire deviendrait l’ingrédient central de l’activité politique, laquelle activité politique serait également un adjuvant de l’imaginaire. On retrouve là Castoriadis et son imaginaire instituant qui est une réévaluation permanente de l’institué qui fait surgir ce qui n’est pas ou n’a pas été. Pour le philosophe, l’imaginaireradical est une « création incessante et essentiellement indéterminée […] de figures, [de] formes, [d’]images à partir desquelles seulement il peutêtre question de quelque chose » et qui se situe à la fois au niveau individuel/psychique et collectif/social-historique.Le commun hardto-négriste envisage donc la désinhibition de l’imaginaire social comme un acte fondateur du politique et Nicolas-Le Strat d’estimer, sous cet aspect, que les démarches d’expérimentation artistique, sociale ou urbaine ont un rôle central à jouer, notamment en ce qu’elles ont « le mérite de nous prouver à nous-mêmes que nous possédons cette capacité [au commun], que nous en disposons collectivement et que nous avons le pouvoir de la développer » (2016 : 34). Dans cette perspective, le travail d’institution du commun passe par une créativité qui « permet personnellement et collectivement, de rester à l’initiative et en capacité d’agir dans n’importe quel contexte » (2016 : 84). Le travail d’Uzeste Musical pourrait être, me semble-t-il, pleinement envisagé sous cet angle d’un imaginaire instituant, l’improvisation y jouant notamment le rôle d’un principe d’action ouvrant à la mise en capacité « de ré-interprétation de l’existant, de renégociation de l’institué et de ré-invention partielle des normes et règles qui président à l’existence collective » (2016 : 84).
Tout-monde et commun politique
Ce que je souhaiterais faire pour conclure et, d’une autre manière, faire le lien avec Uzeste, c’est souligner la proximité de certains postulats de la pensée d’Hardt et Negri avec celles d’Édouard Glissant, et de Castoriadis une nouvelle fois. Même si les deux théoriciens de la multitude ne partagent assurément pas le même type de postulats théoriques que ceux de Glissant, ni, évidemment, la même ambition, leur pensée du biopolitique entretient toutefois quelque résonnance avec la pensée du Tout-monde, de la créolisationet de l’intervalle ou de l’écart. Pour Hardt et Negri, par exemple, il ne fait aucun doute que « la globalisation a pour effet principal de créer un monde commun, un monde que pour le meilleur et pour le pire, nous partageons tous, un monde qui n’a pas de ‘‘dehors’’ » (Hardt, Negri, 2012 : 10). Or ce que Glissant appelle mondialité, n’est, me semble-t-il, pas autre chose que la possibilité la plus générale de produire positivement du commun malgré l’égide négative de la mondialisation, c’est-à-dire des échanges qui nous changent dans « la conscience de la diversité du monde, non pas de sa disparité, mais de la solidarité des différences » (Glissant, 2009 : 31). Chez Castoriadis on retrouve aussi cette critique de l’homogène, de l’universel, de ce qu’il appelle l’ontologie ensembliste-identitaire ou la logique ensidique et, a contrario, un intérêt pour le Divers, le plurivoque, le séparé-relié ; l’imaginaire instituant relevant d’« un productif insaisissable, un formant informe, un toujours plus et toujours aussi autre » (1999 : 154).
Hardt et Negri diraient plutôt qu’il s’agit de développer un travail biopolitique produisant de nouvelles subjectivités, posant moins le problème de ce que nous sommes que celui de ce que nous devenons, le problème de l’intensification de nos capacités au point de déclencher des processus d’autotransformation par-delà les identités dominées et celui de l’innovation sociale et institutionnelle susceptibles d’accompagner et de porter cette autotransformation.
Le commun, dans un cas comme dans l’autre, est, comme nous l’avons rappelé tout à l’heure, dépendant de capacités à imaginer, à se défaire des normes de l’ordre social, à produire des imaginaires politiques ou des poétiques du divers, de la Relation ou ce que Glissant nomme la pensée de l’errancequi, précise-t-il, « n’est pas l’éperdue pensée de la dispersion mais celle de nos ralliements non prétendus d’avance, par quoi nous migrons des absolus de l’Être aux variations de la Relation ». Et il ajoute : « Par la pensée de l’errance nous refusons les racines uniques. […] Contre les maladies de l’identité racine unique, [la Relation] est et reste le conducteur infini de l’identité relation » (2009 : 61).
Hardt et Negri estiment également qu’une des « tendances majeures de la composition technique du travail résulte[rait] aujourd’hui [de dynamiques migratoires] et de processus de métissage social et racial » (2012 : 202). On pourrait évidemment aussi relier cette assertion à des éléments de la pensée glissantienne et notamment à la créolisation, notion qui, chez Glissant, décrit les processus généraux d’ouverture à l’imprévu consenti des diversités : « Je change par échanger avec l’autre, sans me perdre pourtant ni me dénaturer » (2009 : 66). On en revient alors à la Relation qui « distingue entre les différents [et les différences] pour mieux les accorder » (2009 : 72) dans un commun qui émerge précisément de la rencontre des différences, différents et différends.
On retrouve également cette idée chez Étienne Tassin pour qui le commun est ce qui se tisse entre des individus qui ne partagent aucune communautépréalable, mais qui font naître de leur rencontre un réseau de relations susceptible d’accueillir la division etla conflictualité et donc de créer de cette manière du politique, et plus précisément encore du cosmopolitique, c’est-à-dire un politique ouvert à l’altérité maximale, au Tout-monde, où l’étranger n’est pas un sujet faible, et encore moins un ennemi, mais le partenaire à égalité dans la nécessité d’un monde communà construire ensemble, dans la nécessité à produire de la subjectivation politiqueet un agir-ensemble. Car pour Tassin, comme pour Glissant, comme pour Hardt et Negri, comme pour Dardot et Laval, comme pour Castoriadis, ou comme pour Lubat et les œuvriers uzestois, la question politique centrale est « Qu’avons-nous à faire ensemble ? ». C’est celle de l’agir commun, ce qui fait dire à Pierre Dardot et Christian Laval que le principe politique du commun est qu’« il n’y a d’obligation qu’entre ceux qui participent à une même activité ou à une même tâche [et qu’]il exclut par conséquent que l’obligation trouve son fondement dans une appartenance qui serait donnée indépendamment de l’activité » (2014 : 23). C’est cette question « Qu’avons-nous à faire ensemble ? » qui ouvre à l’éventuelle affirmation d’une singularité individuelle et non l’inverse. Dans cette perspective, le commun est donc aussi une exploration d’un soi politique car ce n’est que dans l’action menée avec d’autres et contre d’autres que se révèle, à lui-même comme aux autres, l’acteur politique. Le commun est, en ce sens, ce qui permettrait de faire émerger des modes de subjectivation et des agirs qui donnent la possibilité de défaire les identités préalables pour inventer des configurations protéiformes du peuple(Tassin, « Au-delà du peuple ? Pluralité et cosmopolitique », Tumultes, 2013). Il serait en quelque sorte ce par quoi il faut passer pour créerce qu’on pourrait appeler des ressources politiques, c’est-à-dire des capacités concertées à agir et à devenir en toute autonomie, laissant se créer de nouveaux écarts, de l’entreouvert (pour le dire cette fois avec les mots de Jullien), susceptibles de relancer à nouveaux frais du commun, cercle vertueux qui semble aujourd’hui un rien utopique, tant ce projet manque concrètement et cruellement d’une vision stratégique et des organes pratiques de sa mise en œuvre : « C’est la reconnexion de la question du commun à celles de l’État, des luttes et de leur organisation, du combat idéologique et hégémonique, de la réappropriation du travail et de la production, qui peut rendre son sens aux thématiques contemporaines du socialisme et du communisme, en reliant projet global de transformation, construction de médiations concrètes et prise en compte des expériences acquises » (Garo, 2019 : 113). Les questions de programme, d’organisation, de stratégie et de conquête du pouvoir d’État ne sauraient donc être noyées dans les eaux troubles d’une supposée autonomie de la production, de la réticulation collaborative des intelligences et des subjectivités ou d’un coopérativisme à courte vue. Le chantier est donc ouvert pour saisir plus avant l’intérêt politique de faire se rencontrer les approches du/des communs avec l’horizon d’attente communiste, tant en théorie qu’en pratique.
17h30 – COMMUNISME ET STRATÉGIE – Isabelle Garo (Philosophe – Lycée Chaptal Paris)


La question communiste en 2019
Le point de départ de mon travail est un paradoxe : d’un côté, on peut constater un retour, relatif mais réel, de la thématique communiste, sous la plume d’auteurs dont l’écho est important, bien au-delà des cercles militants. Cette question se trouve aujourd’hui retravaillée par des philosophes comme Alain Badiou, Antonio Negri, Jacques Rancière ou Jean-Luc Nancy. Mais de l’autre, sa portée politique ne bénéficie pas du même regain d’intérêt. Mon projet était ici d’analyser le sens complexe de ce retour partiel, qui a fait migrer le communisme sur le terrain théorique mais qui témoigne pourtant bien d’une recherche croissante d’alternatives, face aux dégâts colossaux du capitalisme contemporain. Plutôt que de proposer un panorama général du débat d’idées à gauche, strictement descriptif, j’ai choisi de m’arrêter sur quelques auteurs seulement, qui tous se réemparent des questions cardinales du socialisme et du communisme sous un angle original et prospectif, chacun mettant l’accent sur telle ou telle dimension de l’alternative : Alain Badiou (sur l’État et le parti), Ernesto Laclau (sur la conquête du pouvoir et la stratégie), Antonio Negri et les théoriciens des communs (sur le travail et la propriété). Ces auteurs ont en partage un autre trait essentiel : c’est en se confrontant à Marx et au marxisme de façon critique qu’ils contribuent tous à la réactivation de la réflexion sur les alternatives au capitalisme contemporain. Ce faisant, ils participent de deux tendances marquantes : d’une part, ils illustrent l’éclatement des projets esquissés, incompatibles les uns avec les autres, se focalisant sur certaines des thématiques de la tradition socialiste, communiste ou anarchiste à l’exclusion des autres ; d’autre part, ils concrétisent un effort de repolitisation de la théorie, mais demeurant sur le terrain de la théorie elle-même. On peut ajouter qu’une telle repolitisation reste tributaire du déplacement philosophique de la politique, dans la filiation maintenue et réactualisée de la critique du marxisme développée lors des décennies 1960-1980, dont ces auteurs sont tous des représentants ou des héritiers directs. Dans la situation qui est la nôtre, la question est plus urgente que jamais : comment retrouver la voie de l’alternative sociale et politique ? Car, sur le terrain social et politique, l’urgence d’une alternative se heurte frontalement à l’incapacité à la construire collectivement et aux défaites en série du mouvement ouvrier, alors que le capitalisme, entré dans sa phase néolibérale autoritaire, n’additionne plus seulement ses méfaits mais multiplie les uns par les autres ses désastres : explosion des inégalités, exploitation renforcée, combinaison des dominations et des oppressions, heurt des impérialismes, financiarisation sans frein, militarisation généralisée, saccage de la nature, domination idéologique, etc.
Cette séquence destructrice d’une ampleur sans précédent suscite colères et révoltes, luttes sociales et contestations multiples, sans que soit pour autant envisageable à court terme une transformation radicale du mode de production tout entier en dépit de son urgence croissante. Dans ces conditions, la résurgence de la contestation sur le terrain philosophique et plus largement théorique est à considérer comme un aveu de faiblesse, mais aussi comme un atout, l’un des moyens de contrer une idéologie néolibérale trop persuadée de sa toute-puissance, et l’indice d’une contestation en quête de voies politiques neuves, contribuant à sa manière à rouvrir l’espace d’une intervention à la fois critique et militante. Mais plutôt que d’ajouter au manteau d’arlequin des alternatives éparses une option supplémentaire ou bien de tenter la réconciliation d’hypothèses fondamentalement divergentes, le choix de ce livre est de les aborder sous l’angle de ce qui manque à la fois à la critique et à la contestation politiques contemporaines : une stratégie, au sens politique fort du terme, permettant la construction collective par les exploité.e.s et les dominé.e.s d’un projet d’une transformation globale, mobilisateur et radical. Au-delà des moyens de la conquête du pouvoir, le terme désigne l’invention de médiations débordant une telle conquête, visant à échapper à l’étatisation et au retournement des moyens en finalités. La stratégie concerne donc les formes d’une mobilisation collective à organiser dans la durée, mais elle désigne aussi bien une réflexion critique qui combine l’analyse historique à l’élaboration d’une conscience partagée, démocratique et en débat, cette dernière accompagnant l’intervention politique pour la contrôler et la réajuster à des finalités qui s’élaborent elles aussi à mesure. C’est d’une stratégie située à un tel niveau d’exigence dont nous avons le plus urgent besoin désormais. Dans la situation présente de crise combinée du capitalisme et de l’alternative au capitalisme, cet angle ou cette perspective stratégique s’ouvre pleinement dès lors qu’on procède à la confrontation des formulations contemporaines de l’hypothèse communiste à ce qui est et reste son creuset, la conception élaborée en son temps par Marx, en tant qu’elle est contemporaine d’une séquence révolutionnaire qui, entre 1848 et 1871, a défini la modernité politique en ses contradictions essentielles. D’où l’approche antichronologogique que j’ai retenue, qui consiste à relire Marx sous cet angle stratégique à partir des questions posées par les théoriciens d’aujourd’hui mais aussi par notre situation sociale et politique. Cette démarche, outre qu’elle permet de redécouvrir l’œuvre de l’auteur du Capitald’une manière qui lui restitue sa dimension d’intervention théorique et politique en situation, aide à la réactivation stratégique de la critique du capitalisme, à l’heure où cette critique retrouve son actualité mais peine à reconstruire sa radicalité non pas seulement critique donc, mais bien politique. En effet, s’il est bien connu que Marx ne définit nulle part le communisme dans le détail de son fonctionnement, et s’il est souvent admis que son analyse du capitalisme, du fait de sa globalité, conserve voire retrouve aujourd’hui sa pertinence, il est beaucoup plus rarement souligné qu’il propose une approche en réalité essentiellement stratégique de la question communiste. C’est cette dimension stratégique que je voudrais souligner en m’arrêtant sur la seule question de la propriété et des communs, au centre des alternatives contemporaines.
Les mutations du capitalisme et le commun
Cette question de la propriété est aujourd’hui le lieu d’un débat vivant. Elle fournit aussi l’exemple d’une distance et même d’un fossé qui va croissant entre les théories de l’alternative d’un côté et la réalité politique et sociale de l’autre, faite d’inégalités croissantes, de privatisations et de marchandisation généralisées. La renaissance du débat sur la propriété est logique : face à l’assaut des politiques néolibérales contre le droit du travail, au démantèlement des secteurs publics, école, santé, transport, mais aussi face à la puissance des acteurs juridiques et politiques qui en sont le relais – États nationaux, construction européenne, traités internationaux, institutions financières et politiques mondiales, etc. – et à l’accaparement capitaliste de la nature, elle permet de réexplorer tous les moyens d’enraciner l’alternative dans les conditions du présent, aussi défavorables soient-elles. S’y ajoute le fait que, dans le cadre du capitalisme contemporain, le droit de propriété présente des enjeux nouveaux, qui conduisent notamment à l’inflation sans précédent des brevets et à l’emprise du droit de propriété intellectuel, au seul bénéfice des grandes entreprises internationales, s’emparant du vivant, de l’intelligence collective, de l’activité sociale en général. Dans le même temps, les vagues de privatisation déjà anciennes qui se sont attaquées aux biens de première nécessité, à commencer par l’eau, ont suscité en retour des mobilisations populaires, en particulier au début des années 2000 en Amérique latine, épicentre d’un nouveau progressisme aujourd’hui en crise. Il faut y ajouter les luttes pour l’accès à la terre, aux semences, pour le partage et la gratuité. On pourrait allonger sans fin la liste de ces contestations des droits de propriété capitalistes en cours d’expansion. Dans leur sillage, on assiste depuis quelques décennies au redéploiement d’une réflexion économique et juridique, qui s’efforce de construire des propositions précises, points de départ d’une reconquête possible de l’ensemble de la vie sociale : commun.s au pluriel ou au singulier, salaire à vie ou allocation universelle, coopératives, décroissance, réduction du temps de travail, taxes sur les transactions financières, etc. Ainsi, la thématique de la propriété émerge-t-elle de nouveau sous une forme renouvelée, après une longue éclipse et son abandon par les diverses organisations politiques de la gauche.
Sur ce plan, l’approche de Toni Negri continue de susciter l’intérêt et je vais la résumer à grands traits afin de voir en quoi elle interroge le marxisme sur le terrain de l’analyse mais aussi sur le terrain politique et stratégique. On rencontre cette approche en particulier dans la trilogie rédigée entre 2000 et 2009 en collaboration avec le théoricien américain Michael Hardt développe l’idée d’une transformation de la classe ouvrière et, plus généralement, d’une mutation du capitalisme, qui rendent selon eux inopérantes les vieilles options socialistes et communistes. Leur objectif est de repenser la politique dans le cadre de la mondialisation capitaliste, en considérant cette dernière comme une évolution finalement plus positive et prometteuse qu’inquiétante, pour qui sait en repérer les tendances souterraines. Au premier rang de ces tendances se trouve la disparition en cours de toute forme de contrôle politique sur une logique libérale qui s’en émancipe toujours plus radicalement. Selon les auteurs, ce contrôle était jusque-là dévolu aux États-nations et assuré par le dispositif de la souveraineté moderne dont ils sont les dépositaires. A leurs yeux, sa défaite est une bonne nouvelle, témoignant d’un processus irrésistible de décentralisation et de déterritorialisation, selon le terme de Deleuze – l’une des grandes références théoriques de Negri –, processus qui augure d’une défaite inéluctable de toutes les formes de contrôle. Negri le dit sur mode euphorique : « L’Empire gère des identités hybrides, des hiérarchies flexibles et des échanges pluriels, en modulant ses réseaux de commandement. Les couleurs nationales distinctes de la carte impérialiste du monde se sont mêlées dans l’arc-en-ciel mondial de l’Empire ». Pour Negri et Hardt, l’Empire est une réalité planétaire qu’ils objectent aux théories marxistes de l’impérialisme. Si l’Empire détient bien un réel pouvoir d’oppression, il présente surtout des potentialités de libération, qui condamnent à la péremption les anciennes hypothèses politiques de dépassement du capitalisme, non parce que la cause serait perdue d’avance, mais au contraire parce que la disparition de ce dernier est d’ores et déjà un fait : « L’Empire prétend être le maître de ce monde parce qu’il peut le détruire : quelle horreur et quelle illusion ! En réalité, nous sommes maîtres du monde parce que notre désir et notre travail le régénèrent continuellement ».
Autrement dit, il s’agit simplement de prendre acte des tendances à l’œuvre et « de les réorganiser et de les réorienter vers de nouvelles fins ». Bien des commentateurs ont noté le spontanéisme et l’optimisme forcené qui sous-tendent cette proclamation. Mais un autre point frappe : alors qu’ils souhaitent promouvoir la puissance d’un nouveau sujet politique, la multitude, Negri et Hardt renouent paradoxalement avec le déterminisme historique si souvent imputé au marxisme en général, attribuant pour leur part un rôle moteur aux mutations technologiques, indépendamment de toute stratégie et de tout projet. Le grand tournant politique qui accompagne cette analyse concerne la nature de la conflictualité sociale et, plus fondamentalement encore, la thèse marxiste de la lutte des classes, remplacée par la thématique de la multitude. Cette redéfinition de l’affrontement social – qui se trouve également au centre de l’approche d’Ernesto Laclau et de nombres d’autres auteurs – reprend des thèses développées au cours des décennies 1960 à 1990, qui objectent à l’analyse de classe une homogénéisation sociale croissante. Une telle affirmation, défendue en dépit de tous les travaux sociologiques ultérieurs qui la démentent ou la complexifient -il faut le souligner-, vise à étayer l’affirmation de la disparition de la classe ouvrière comme réalité sociale et politique. La perspective d’une sortie du capitalisme se voit remplacée par l’appel à la réorientation de sa gestion et par le souhait d’une amplification de ses tendances immanentes, censées conduire au communisme. Leur argumentaire repose tout entier sur l’idée que le travail immatériel, qui tendrait à se généraliser et qui « implique immédiatement interaction et coopération sociales », à la différence des formes antérieures du travail, organisées et disciplinées de l’extérieur. La déduction politique est d’autant plus directe que c’est elle qui fournit en réalité ses prémisses à l’analyse : « dans l’expression de sa propre énergie créatrice, le travail immatériel semble ainsi fournir le potentiel pour une sorte de communisme spontané et élémentaire ».
Ces questions et leurs aspects juridiques et politiques sont développés en particulier dans Commonwealth, ainsi que dans un livre d’entretiens intitulé significativement Good Bye, Mister Socialism. Pour Negri, être communiste, c’est être « contre l’État », hostilité qu’on retrouve chez bien des théoriciens qui se réclament aujourd’hui du communisme. Cette opposition à l’État, qui est son pur et simple rejet, implique l’opposition aux formes privées de la propriété, mais tout aussi bien à ses formes publiques « c’est-à-dire nationales, c’est-à-dire étatiques, dans lesquelles se configurent toutes ces opérations d’aliénation de la puissance du travail ». Le commun se présente ici comme travail commun, incarnant le communisme en acte contre tous ses détournements, capitaliste ou socialiste. Le commun ainsi définit « englobe aussi les langages que nous créons, les pratiques sociales que nous instaurons, les modes de socialité qui définissent nos relations, etc. ». À distance du concept traditionnel de bien commun, c’est ici sur la coopération que l’accent est mis : « le travail cognitif et affectif produit en règle générale une coopération indépendamment de l’autorité capitaliste, y compris dans les circonstances où l’exploitation et les contraintes sont les plus fortes, comme dans les centres d’appels ou les services de restauration ». Negri et Hardt ne craignent donc pas d’affirmer que l’autonomie se détecte dès à présent au sein des secteurs les plus typiquement capitalistes, où les salariés sont les plus exploités et précarisés. Mais rien n’est dit des conditions de travail et de salaire, ni du maintien massif des formes taylorisées de la production, le propos se concentrant sur la fonction strictement prédatrice d’un capital qui « capture et exproprie la valeur à travers l’exploitation biopolitique qui est, en un sens, produite hors de lui ». Je crois, qu’en dépit de son succès, une telle conception est en train de vieillir à vive allure et elle invite à revisiter la critique de Marx dont Negri et Hardt font une des dimensions constitutives de leur réflexion, tout en lui attribuant des thèses qui ne sont pas les siennes, ce qui invite à y revenir.
Propriété et réappropriation : une question stratégique
À partir de là, ma question est d’abord : que nous dit Marx de cette question, qui puisse être encore fécond aujourd’hui ? Et cela si on l’aborde son analyse non pas comme thèse définitive, durcie en définition intemporelle du communisme (à savoir, la propriété collective des grands moyens de production et d’échange) mais comme question stratégique, permettant de penser la transition à un monde non capitaliste. D’abord, cette question est un fil rouge -si j’ose dire- de son œuvre, mais aussi de toute la tradition socialiste et communiste. Dans son ouvrage de référence, Jacques Grandjonc (Communisme/Kommunismus/Communism, 1785-1842, Éditions des Malassis, 2013) rappelle que le terme de communisme est apparu à la fin du 18e siècle et qu’il fut d’abord utilisé dans le cadre de débats portant sur la propriété et plus particulièrement sur la communauté des biens. C’est de ces termes qu’héritent d’abord Engels, puis Marx, avant de participer eux-mêmes activement à leur définition. Chez Marx, la question de la propriété est omniprésente mais elle ne définit pas à elle seule l’alternative au capitalisme et surtout elle le conduit à une conception originale de la propriété collective combinée à la propriété individuelle. Il faut rappeler que dès 1843, Marx passe de la revendication démocratique au socialisme puis au communisme : Marx va s’efforcer d’articuler la question philosophique de l’aliénation, qu’il hérite de Hegel et des Jeunes Hégéliens, à une dénonciation précisée de la propriété privée : c’est la thématique de la réappropriation – réappropriation des richesses, mais aussi et surtout réappropriation de soi – qui relie ces dimensions, avant de prendre la forme d’un projet politique alternatif. De façon surprenante, au moment où il se réclame du communisme, Marx dénonce dans les Manuscrits de 1844, le « communisme grossier » comme volonté unilatérale et obsessionnelle d’abolition de la propriété privée, restant de ce fait même assujettie à cette dernière. Un tel communisme se révèle un symptôme bien plus que la solution des pathologies sociales dont il reproduit la logique en l’inversant.
Paradoxalement, ce communisme de première génération, qu’on peut rapprocher du babouvisme et de ses suites, est fondamentalement, aux yeux de Marx, un individualisme et un égoïsme, « généralisation et achèvement » de la propriété privée, qui « n’a pas encore saisi l’essence positive de la propriété privée », ni « la nature humaine du besoin ». La prise en compte de cette « essence positive » laisse entre- voir une autre abolition, non pas négation simple, mais négation de la négation, qui prend en compte l’ensemble des rapports de l’homme à lui-même ainsi qu’à la nature, offrant « la vraie solution de l’antagonisme entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme, la vraie solution de la lutte entre existence et essence, entre objectivation et affirmation de soi, entre liberté et nécessité, entre individu et genre. Il est l’énigme résolue de l’histoire et il se connaît comme cette solution » (Man44, 86). Si le retour de l’homme à lui-même n’est pas réappropriation d’une essence déjà là, mais reprise de « toute la richesse du développement antérieur », le communisme ne peut être simple abolition, mais doit correspondre à la réélaboration d’un rapport social à partir de lui-même. Cela vaut pour la propriété privée, dont Marx laisse ici entendre qu’elle ne doit pas simplement laisser place à la propriété commune, mais qu’elle doit être radicalement redéfinie. Il faudra attendre le Capitalpour qu’il y présente de nouveau le rapport communiste à la propriété privée comme « négation de la négation », précisant cette fois qu’il s’agit de rétablir de la « propriété personnelle ».
En outre, la critique de la propriété privée, se trouve directement reliée par Marx à la sphère de la production et du travail, comme lieu originaire de la dépossession de soi. Surmonter cette dépossession exigera de tout autres moyens que l’égalité de revenu et la propriété collective, formes simplistes de la réappropriation précisément parce qu’elles ne prennent pas en compte la vraie nature de l’ensemble des aliénations. Bien plus tard, dans le Capital, on peut vérifier à quel point la question de la propriété est conçue par Marx non comme une perspective lointaine de collectivisation mais comme le ressort d’une mobilisation au présent. En ce sens la question de la propriété telle que la pense Marx moins le communisme que l’intervention communiste au sein du capitalisme. Et c’est cette importance du communisme comme construction de la mobilisation qui m’intéresse ici, à distance de toute définition de l’alternative indépendamment des moyens pour y parvenir. Dans le texte du Capitalque je mentionnais tout à l’heure, c’est-à-dire le dernier chapitre (ch. 24) du livre I, Marx présente une conception de la transition au communisme qui semble marquée par le déterminisme et par l’idée de sortie inéluctable hors du capitalisme. Ce texte, réputé le plus antistratégique, au sein d’un livre qu’on considère comme ignorant les questions politiques et les luttes de classe, se situe en réalité au coeur des réflexions stratégiques de Marx.
Le texte affirme en effet que la centralisation croissante du capital s’accompagne de la montée de la « forme coopérative du procès de travail », « la centralisation des moyens de production et la socialisation du travail [atteignant] un point où elles deviennent incompatibles avec leur enveloppe capitaliste. On la fait sauter. L’heure de la propriété privée a sonné. » Et Marx ajoute : « la production capitaliste engendre à son tour, avec l’inéluctabilité d’un processus naturel sa propre négation. C’est la négation de la négation ». La tonalité effectivement déterministe de ces lignes va inciter bien des lecteurs à les extraire d’une analyse en réalité bien plus complexe. Le texte dont elles sont extraites, rarement cité en entier, est en réalité entrelardé de considérations qui réinjectent les luttes de classes et la conscience qui les accompagne au sein de la transformation sociale. En effet, Marx précise aussitôt que, du côté du capital, la logique de monopole s’impose progressivement et mécaniquement, alors que du côté des ouvriers « s’accroît le poids de la misère, de l’oppression, de la servitude, de la dégénérescence, de l’exploitation, mais aussi la colère d’une classe ouvrière en constante augmentation, formée, unifiée et organisée par le mécanisme même du procès de production capitaliste ».
Le communisme est non un projet lointain mais ce qui caractérise un certain type d’intervention politique. En ce sens, le communisme vise avant tout l’élaboration consciente de ses propres présuppositions concrètes (càd de conditions qu’il trouve mais surtout qu’il transforme à mesure) en même temps que l’élaboration d’une finalité en partie immanente au rétablissement de la « propriété individuelle fondée sur les conquêtes mêmes de l’ère capitaliste ». Mais cette immanence n’a rien de la transformation automatique du capitalisme décrite par Negri. Pour Marx, c’est précisément le réquisit de la conscience collective, comme composante de la lutte de classse, qui fait du communisme l’effort le plus gigantesque, sans précédent au cours de l’histoire humaine, en vue d’une maîtrise consciente par l’humanité de sa propre organisation sociale. Au delà de la question juridique de la propriété, la réappropriation se trouve élargie par Marx au-delà de la visée du rétablissement de la propriété individuelle, conçue comme droit d’accès garantie à des biens et à des services, en direction des conditions de leur production et de leur contrôle collectif, mais aussi en vue du développement des capacités individuelles. Cette réappropriation est un moteur de la lutte de classe, dans sa dimension foncièrement anticapitaliste et elle est à organiser comme telle : c’est cela la stratégie, qui ne peut être une théorie générale mais une intervention militante dans un contexte toujours singulier. Les producteurs associés ont à reprendre ce dont ils n’ont en réalité jamais disposé, mais qui leur fait désormais manifestement défaut : le contrôle collectif de leurs conditions de travail, de la production et de la répartition des richesses produites. Pour Marx, les rapports sociaux capitalistes appliquent par la violence leur forme à une activité dont les résultats mais aussi l’exercice se voient ainsi confisqués, cette dépossession fondamentale atteignant de plein fouet le sujet humain.
Une fois redéfinie l’ampleur de cette réappropriation, qui n’est pas retour à un état premier mais accomplissement de potentialités inédites, toute la difficulté est d’en faire un objectif politique crédible et mobilisateur, à placer au cœur de la stratégie révolutionnaire : or c’est précisément cette question qu’aborde Marx à la fois dans le Capitalet dans ses textes politiques, qu’ils soient d’intervention ou d’analyse, intriquant la question des finalités à celle des médiations. C’est donc au cœur du « laboratoire de la production » qu’il faut installer la question communiste : contre l’économie politique bourgeoise, Marx affirme donc haut et fort que « le travail est la substance et la mesure immanente des valeurs, mais lui-même n’est pas valeur », de sorte que « ce que le travailleur vend au capitaliste n’est pas une marchandise, mais sa soumission personnelle au capitaliste pendant la journée de travail » (Tran Hai Hac). Et c’est en ce point précis qu’exploitation et domination se nouent, et s’affrontent à la colère qu’elles suscitent, formant une contradiction aussi profondément économique que sociale et individuelle : « ce qui, sur le marché des marchandises, vient se présenter directement face au possesseur d’argent, ce n’est pas le travail, mais le travailleur « . Ce sont leurs capacités à la fois forgées et déniées, leur émancipation entrevue et confisquée, qui conduisent les producteurs à lutter pour la réduction de la journée de travail et, à terme, contre le capitalisme en tant que tel. La question de la propriété s’élargit à la question de l’émancipation et de la réappropriation, qui sont les ressorts de la mobilisation en même temps que ses buts. On est loin ici d’un programme extérieur et antérieur aux luttes et à leurs acteurs. Marx précisera cette analyse à l’occasion de la Commune de Paris mais aussi, de façon prospective, dans ses lettres à Vera Zassoulitch, concernant les paysans et le rôle de la commune russe traditionnelle, l’obchtchinaou mir. Dans tous les cas, c’est non pas la réalisation d’un programme social qui l’intéresse, mais la construction de la mobilisation politique révolutionnaire et la façon dont elle peut se traduit dans des mesures sociales affrontant la logique capitaliste, enclenchant un processus de transformation radicale, nécessairement long et heurté, révolutionnaire.
Cette analyse nous lègue la question des formes organisées de cette mobilisation, à ajuster aux réalités et aux aspirations individuelles et collective. De ce point de vue, le ressort fondamental de la résistance au capitalisme ne se trouve pas du côté de l’opposition anonyme entre travail vivant et travail mort accumulé, thèse qui est celle d’Antonio Negri, mais du côté de la contradiction sans cesse accrue entre l’achat et la vente de la force de travail d’un côté, et sa formation en tant qu’individualité concrète de l’autre. Aujourd’hui encore, la contradiction vient se nicher au cœur même de la subjectivité moderne, car la force de travail consiste avant tout dans la somme des travailleurs individuels, ou bien coordonnés extérieurement par le capital qui en dévore la force vive, ou bien collaborant consciemment à leur propre vie sociale rationnellement et démocratiquement conduite. Or la production ou plutôt la formation de cette force de travail résulte d’un travail improductif, qui vise à reproduire et entretenir, mais aussi à éduquer et à socialiser un ensemble de capacités humaines et de caractéristiques physiques, nerveuses, intellectuelles ou artistiques, en proie à leur captation capitaliste croissante, mais qui restent l’enjeu de l’émancipation collective, et tout spécialement de l’émancipation des femmes, prioritairement affectées aux tâches de la reproduction sociale. Si l’on s’appuie sur cette analyse, les luttes féministes, qui semblent rester à l’écart des questions de propriété, sont en réalité au coeur de cette perspective communiste de la réappropriation de soi et au coeur des médiations politiques qui en rendent la visée accessible. On se situe bien ici sur un plan stratégique, où il s’agit d’articuler le futur au présent et à ses contradictions les plus vives, en y organisant les luttes et les mobilisations. Pour autant, il ne s’agit pas de les subordonner à des luttes sociales jugées « plus essentielles », mais d’en mesurer l’essentialité propre, non divergente, par rapport aux luttes qu’on pourrait juger -mais à tort- être plus directement anticapitalistes.
De fait, les mobilisations antiracistes, féministes, dans les quartiers populaires, connaissent aujourd’hui un renouveau, en lien avec les régressions en cours et les enjeux élargis de la contestation sociale, laissant entrevoir plusieurs scénarios : ou bien des clivages fratricides fracturant davantage encore un paysage politique en crise profonde, ou bien la connexion souple de tous les secteurs clés de la relance stratégique et critique. S’y ajoute l’urgence de construire des organisations débarrassées de toutes les dominations, du sexisme, du racisme et qui sachent préfigurer la société démocratique et égalitaire que nous prétendons construire. Pour échapper au heurt des discours identitaires, anti-essentialistes, pseudo-universalistes ou anticommunautaristes, dont l’affrontement sans fin brouille la construction de l’alternative commune, l’articulation politique et stratégique de tous les combats contre l’exploitation et les dominations doit être à l’image leur cause même : des oppressions irréductibles et combinées, toutes reliées aux rapports sociaux capitalistes et à leur reproduction sociale. Si Marx n’a jamais traité ces questions telles qu’elles se présentent à nous, il fournit les outils indispensables de leur compréhension politique.
Conclusion
Bref, il est stratégiquement décisif de considérer que toutes les luttes sociales renvoient aux contradictions essentielles de la formation capitaliste à l’époque néolibérale, mais que la construction politique de leur unité ne va absolument pas de soi. Mais il faut ajouter que les dominations subjectivement subies et rejetées, en tout premier lieu le racisme et le sexisme, alimentant des colères aussi puissamment individuelles que globales, stimulant l’analyse et le débat collectif en même temps que de nouvelles solidarités, sont aujourd’hui au nombre des foyers les plus vivants de la riposte sociale et politique. Œuvrant à l’intersection de déterminations multiples, mettant concrètement en lumière les ramifications de la domination de classe et de l’exploitation du travail, ces luttes incarnent au plus haut point l’exigence de réappropriation individuelle et collective de la vie sociale dans sa totalité. Le féminisme et l’antiracisme politiques soulignent la nécessité d’une approche globale et dialectique, informée et militante, respectueuse des spécificités. Maintenir le caractère fondamental de la contradiction travail-capital ainsi que celui de l’exploitation et de l’accumulation implique précisément de ranger la prolifération des dominations au nombre des moyens de l’expansion et de la reproduction du capitalisme : une telle centralité logique ne conduit à aucune hiérarchisation stratégique mais impose la construction d’une unité autre que rhétorique, une solidarité en acte. C’est bien au cœur de cette réalité stratifiée et évolutive qu’est le mode de production capitaliste que doivent s’insérer, se propager et proliférer les forces politiques qui le combattent, de façon tout aussi buissonnante et articulée que lui.
21h – concert – CIE LUBAT État d’Engeance – Juliette Kapla (voix parlée chantée) Fawzi Berger (percussions) Fabrice Vieira (guitare voix) Bernard Lubat (piano, dire, chant)

22h – projection – LE 7ÈME SWING Un film de Yves Billon











































