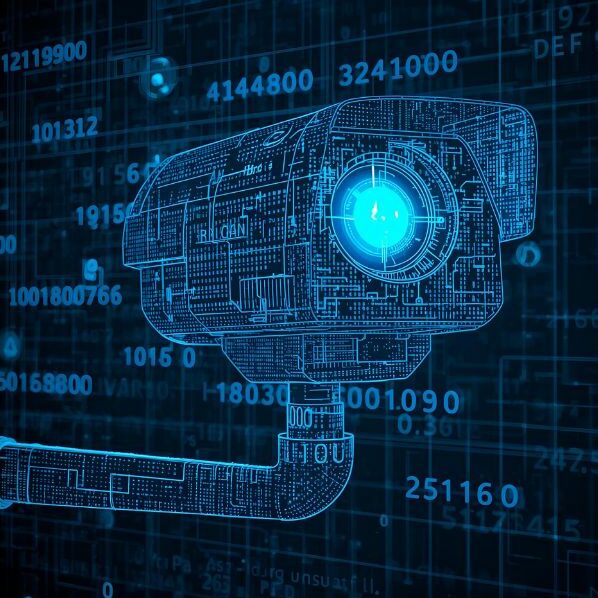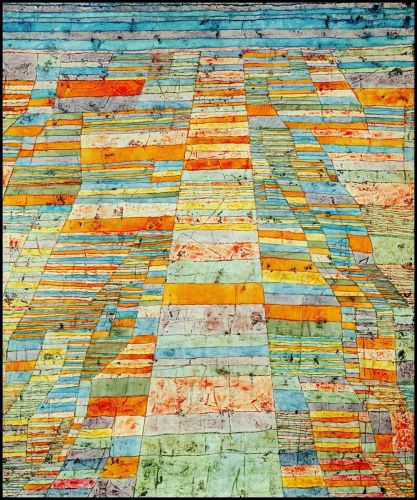Approches critiques et SIC — Séminaire GERIICO
Séminaire d’équipe (GERIICO) 2014-2015 – Approches critiques et SIC
Je souhaiterais bien évidemment commencer par vous remercier chaleureusement pour votre invitation. Il me semble avoir repéré être le seul intervenant non lillois de ce séminaire, je me sens donc d’autant plus invité ; un grand merci bien évidemment à Thomas, notamment pour avoir accepté de déplacer cette séance d’une semaine et mes excuses à l’assistance pour ce changement inopiné d’agenda.
Alors… je suis d’autant plus ravi de pouvoir échanger avec vous que le présent séminaire porte sur un sujet qui m’intéresse grandement et qui m’occupe depuis assez longtemps, à savoir tenter de penser la dialectique de la critique et des sciences sociales et plus particulièrement le rapport que peuvent entretenir les sciences de l’information et de la communication avec la critique ; intérêt de connaissance qui nécessairement se couple à la nécessité de penser la manière dont la critique peut travailler sur un ensemble de phénomènes sociaux que l’on pourrait qualifier de surcroît et en première approximation de « communicationnels », même si le terme me semble quelque peu galvaudé.
Comme support de dialogue avec vous, j’ai proposé à Thomas de revenir sur une contribution relativement récente que je me suis permis de commettre dans un ouvrage que j’ai co-dirigé avec mon camarade Éric George et qui a été publié l’an passé dans la collection MediaCritic des éditions Mare & Martin, sous le titre Critique, sciences sociales et communication et dont la photographie couverture a d’ailleurs était prise dans un skatepark de la région lilloise. Le titre de ma contribution était « La critique est-elle soluble dans les sciences de l’information et de la communication ? » et je crois savoir que Thomas en a fait circuler des copies.
Je vais donc me permettre de reprendre pour partie ce texte. Pour partie seulement, d’une part parce qu’il est excessivement long, d’autre part parce que vous êtes au moins quelques uns à l’avoir en partie lu. J’en garderai donc les parties me semble-t-il les plus essentielles s’agissant du thème du séminaire et de discuter ce qui dans les attendus du séminaire est défini comme « les enjeux actuels d’une démarche de recherche qui se donne pour tâche de produire des connaissances susceptibles de constituer un appui pour une action émancipatrice ».
Comme il s’agit de la dernière séance et que, de fait, je n’ai pu assister à l’ensemble des séances précédentes, peut-être… sans doute même… un certain nombre de choses que j’entends discuter aujourd’hui ont été abordées par mes prédécesseurs. Si tel est le cas, je vous prie évidemment de bien vouloir m’en excuser.
Alors l’idée du papier sur lequel je m’appuie était notamment d’essayer d’établir les « coûts transactionnels » qui s’imposent à celles et ceux qui, depuis les SIC, souhaitent développer une production scientifique critique.
L’hypothèse de base dudit papier était que l’appropriation du « référentiel critique » par les SIC nécessite d’opérer une série de « conversions » depuis la matrice épistémologique des SIC et que ces opérations de traduction ne vont pas nécessairement « de soi », dans la mesure où elles exigent des efforts particuliers qui relèvent de déplacements, d’ajustements, de prolongements, mais peut-être aussi de ruptures plus conséquentes avec ce que l’on peut appeler les topoï de la discipline (c’est-à-dire ce sur quoi il faut travailler) et son nomos (c’est-à-dire ce comment il faut y travailler).
En d’autres termes, l’existence de SIC critiques ne peut faire l’économie d’une démarche critique vis-à-vis de la discipline qui, aussi utile et nécessaire soit-elle, n’apparaît pourtant jamais aisée, ni même pleinement légitime.
Mon exposé se fera en 2 points :
-Dans une première partie, rapide, je vais revenir sur le répertoire des principaux repères épistémologiques sur lesquels sont censés faire fond les social scientists qui situent leurs travaux au cœur ou aux marges des SIC françaises. Ce bornage forcément grossier présuppose qu’il existe un accord minimal sur ce que sont ou devraient être les sciences de l’information et de la communication et les normes qui sont censées en faire un champ disciplinaire singulier et repérable en tant que tel, c’est-à-dire fondé sur ce que Bourdieu nomme, je cite : « un principe de vision et de division, un principe de construction de la réalité objective irréductible à celui d’une autre discipline » (Bourdieu, 2001a : 103). Force est de constater que cette entente principielle ne relève pas de l’évidence, mais il n’est pas impossible d’identifier un socle collectif (aux contours flous) qui permet aux SIC de poser notamment les exigences et les tolérances scientifiques régissant le droit d’entrée dans la discipline (i.e. les identités professionnelles compatibles), les conditions de son développement autoréférentiel, ainsi que celles de sa reproduction. Ces règles ne sont pas immuables et elles sont évidemment le fruit de luttes, souvent acharnées, qui dépendent de l’état du champ à un moment donné et qui ont précisément pour objectif d’établir les normes dominantes de la valeur scientifique en SIC, c’est-à-dire les « lois » auxquelles les chercheurs sont censés se soumettre.
-Dans une seconde partie, j’introduirai les exigences de la critique en envisageant les efforts nécessaires à la mise en œuvre d’une pensée critique à partir des SIC. L’idée est donc d’apporter une série de repères permettant, d’une part, de rappeler quelques-uns des principes de la critique et, d’autre part, de considérer les difficultés singulières qui leur sont attenantes dans le cadre particulier d’une mise en œuvre dans le champ des sciences de l’information et de la communication. Pour le formuler différemment, on pourrait dire que ma tentative sera d’établir un modeste tableau des attendus de la critique à la rencontre de la communication.
- Topoï et nomos des SIC
J’aborde donc maintenant ma première partie que je ferai courte dans la mesure où ce que j’ai à dire sur la question est je crois largement connu de toutes et tous, bien qu’il faille toutefois rappeler la chose, me semble-t-il, pour en suite considérer la rencontre des SIC et de la critique.
Alors il me semble que les manière de constituer les SIC en tant que disciplines oscillent entre trois options qui sont notamment des moyens par lesquels peut se construire une collusio dans l’illusio, c’est-à-dire, et je cite là évidemment Bourdieu : « une complicité foncière dans le fantasme collectif, qui assure à chacun des membres l’expérience d’une exaltation du moi, principe d’une solidarité enracinée dans l’adhésion à l’image du groupe comme image enchantée de soi » (Bourdieu, 2004 : 19).
Ces trois façons de définir les « règles du jeu » disciplinaires, c’est-à-dire « un capital collectif dont la maîtrise constitue le droit d’entrée tacite ou implicite dans le champ » (Bourdieu, 1984 : 129) sont me semble-t-il de trois ordres :
-Une première possibilité pour tenter de circonscrire ce que sont les SIC consiste à établir la liste des objets de recherche qu’il est légitime d’étudier. En ce cas, discipliner la communication, c’est répertorier des catégories de phénomènes censés relever de « l’information-communication » et desquels il s’agirait donc de ne pas trop s’éloigner, si ce n’est au risque d’affaiblir la singularité de la discipline. Cette construction des sciences de l’information et de la communication par la labélisation de classes d’objets à préempter rabat donc le principe de construction de la réalité disciplinaire sur une liste de thèmes hétérogènes, mélangeant des réalités sociales d’ordres différents, dont on peine à établir la cohérence scientifique. En guise d’illustration, je me permettrais de vous lire ce passage d’un rapport effectué Par Arnaud Mercier et Jean Davalon qui stipule ceci :
« L’AERES, tout comme le CNU de la 71ème Section, admettent que l’information-communication accueille des recherches sur des objets variés voire hétérogènes, et que ni les objets, ni même les matériaux de recherche ou les terrains observés suffisent à déterminer le rattachement à la discipline. Ainsi, au-delà des approches plurielles qui constituent le tronc de notre discipline, des ramifications existent, parmi lesquelles on peut retenir en priorité : les productions audiovisuelles ; les spectacles et les arts ; l’édition et les productions littéraires ; les musées, la mémoire collective et les archives ; les bibliothèques et l’informatrice ; les études sur les NTIC (e-learning, e-commerce, e-gouvernance…) et le Web sémantique ; l’intelligence économique, l’information scientifique et technique au sens large ; la société de la connaissance et la circulation des savoirs ; les identités culturelles et les cultural studies ; le traitement automatique de la langue ou encore les interfaces hommes-machines » (Mercier, Davallon, 2009).
Je ne détaille pas davantage, mais bien évidemment, et j’imagine que vous en conviendrez, l’idée de se rendre propriétaire des terrains de jeu singuliers et de prétendre à la jouissance exclusive de territoires réservés aux SIC est difficilement tenable.
-Une deuxième possibilité pour périmétrer les SIC comme discipline est d’essayer d’établir des propositions programmatiques qui reprennent les logiques de répertoire de la première option, mais qui ont cela de différent qu’elles s’efforcent de repérer les aspects plus spécifiquement « informationnels-communicationnels » des phénomènes sociaux dont elles sont censées faire leur miel. Cette manière d’organiser la discipline autour d’un plan de travail a pour corolaire de « qualifier », non plus des objets, mais des axes de recherche, au détriment d’autres qui ne sont pas identifiés. Ce type d’« épure » a notamment vocation à légitimer les recherches « canoniques » (en devenir) censées être parmi les plus profitables à la discipline et sans surprise, celles-ci sont généralement proches des travaux menés par ceux qui en dressent les listes. Cette démarche de la « to do list » s’avère bien évidemment travaillée par des logiques d’affermissement ou de prise du pouvoir dans le champ : je vous renvoie par exemple aux travaux de Miège et notamment à son dernier ouvrage qui de mon point de vue témoigne de l’épuisement de ce type d’approche.
-Enfin, une troisième possibilité pour fournir une carte d’identité aux sciences de l’information et de la communication a été d’essayer de tenir l’impératif d’avoir à questionner la nature de leur nomos spécifique, partant du fait que seule l’existence d’un tel principe serait en mesure de constituer les SIC comme discipline scientifique singulière. La recherche de cette typicité épistémique a notamment conduit certains chercheurs à revendiquer une raison communicationnelle dont la paternité ne pourrait être réclamée par d’autres disciplines.
Cet effort passe d’ailleurs bien souvent par le dénigrement d’adversaires de confort que sont les disciplines historiques des SHS et la construction de contentieux avec celles-ci qui parfois confinent à la détestation et déclenchent des replis communautaires sur la discipline assez dommageables.
Cette attitude a d’ailleurs parfois été prolongée par quelques velléités à faire jouer aux SIC un rôle prépondérant dans l’irrigation des disciplines voisines par la mise en cycle du savoir à partir de la communication. Daniel Bougnoux en vient par exemple à affirmer que la « raison communicationnelle » devrait servir, je cite « de cadre et d’ambition à nos actuelles sciences humaines » et que les SIC devraient assumer le fait d’avoir à exercer, je cite encore : « plusieurs ingérences dans d’autres disciplines où [elles] sont censées exercer un droit de suite » (1998 : 5). On peut lire également sous la plume de Jean Caune des allégations approchantes, espérant faire des SIC, « dans leur diversité et leurs références multiples, le fondement théorique et pratique des humanités contemporaines » (Caune, 1995 : 11). Autre exemple, pour Franck Cormerais (2008), les SIC devraient, je cite une nouvelle fois : « assurer la relève du programme [complet] des sciences humaines » : déplacer « les limites du connaissable » et, par là même, « contribuer à la mise en œuvre d’une ‘‘seconde modernité’’ ». Quant à Christian Gerini (2008), il n’écarte pas la possibilité de les considérer comme « une ‘‘méta science’’, une science qui fait ‘‘lien’’, qui éclaire les autres sciences, et qui les évalue et oriente là où ces dernières, enfermées dans les carcans de leur spécialisation, ne peuvent (ou n’ont pas les moyens de) le faire ».
Comme le signale Philippe Breton, « croire que tout est communication place les sciences de la communication dans la position intenable d’être la science de tout » (Breton, 1994 : 74).
La perspective que je défends s’éloigne de ces différents types de construction et s’articule autour de deux impératifs :
-a) le premier c’est d’installer, les sciences de l’information et de la communication au sein des sciences sociales et d’y réclamer à ce titre une place à part entière ;
-b) le second impératif, vous vous en doutez, c’est de faire répondre les SIC à l’ordonnance critique.
S’agissant du premier de ces points, je ne vais pas développer, mais j’aimerais juste préciser que pour ce qui nous concerne, les sciences de l’information et de la communication ne diffèrent aucunement des autres sciences sociales, ni par leur rapport à la production de connaissance, ni par leurs méthodes, ni même par la nature des paradigmes et modèles d’analyse qu’elles mobilisent ou édifient. Elles s’en dissocient d’autant moins que cette opération d’abstraction qui tend à faire de la communication un nouveau champ d’investigation ne saurait pleinement l’isoler et l’autonomiser d’autres référents comme le « social » ou la « culture ». Autrement dit, la spécialisation par la communication semble pour partie artificielle dans la mesure où, contrairement à d’autres disciplines autonomisantes construites autour du politique, de l’espace, de l’éducation, du langage ou encore du genre, la réduction à laquelle cette spécification conduit, maintient les SIC à un étiage qui est assez clairement celui d’une science synthétique s’attaquant au cours historique du monde.
Par ailleurs, réaffirmer que sciences de l’information et de la communication sont bien des sciences sociales permet d’en faire une une première fois des sciences critiques dans le sens où en tant que sciences sociales elles se doivent de se donner les moyens d’une production de connaissances objectivante et soucieuse des normes des sciences sociales (Robert, 2008). Il s’agit là, je crois, d’une condition indispensable pour leur assurer un exercice scientifique de qualité, mais celle-ci s’avère non suffisante pour les rendre totalement critiques. En rester là, reviendrait à prendre le risque de faire coïncider à moindre coût science, objectivation et critique, et ferait passer l’indispensable travail de discussion des modèles d’analyse (concepts, hypothèses, etc.) et de réflexivité comme suffisant au travail de la critique.
Notre position est qu’il n’est pas possible de considérer qu’une science est pleinement critique dès lors qu’elle se contente seulement de répondre à des exigences de vigilance épistémologique liées à la pratique scientifique. Nous ne sommes donc pas d’accord, s’agissant des SIC, de considérer, je cite qu’à l’instar de « toutes les autres sciences humaines, [c’est] en tant qu’elles tentent d’expliquer et/ou de comprendre des phénomènes, [qu’elles] sont critiques par nature » (Corbalan, 2002 : 373). Le doute méthodique, la référence au criticisme kantien, aux Lumières ou encore aux règles du Métier de sociologue sont des repères essentiels qui tiennent « à l’observation des règles du discours et de l’esprit scientifique », mais la critique scientifiquement fondée ne peut s’envisager seulement au travers de cet « ensemble formel de prescriptions méthodologiques » (Mœglin, 1992 : 132 – un « sens critique »).
La critique ne peut donc seulement se résumer à la critique épistémologique qui n’en est qu’un des piliers, mais qu’il s’agit de prolonger par un travail plus poussé, un travail du négatif, de déconstruction et de défétichisation de la réalité sociale. C’est, selon nous, cet autre type de positionnement qui autoriserait les SIC à être une seconde fois et, cette fois, pleinement critiques, c’est-à-dire en pleine capacité d’être réflexives vis-à-vis d’elles-mêmes, mais aussi de décrire, d’analyser, de comprendre et d’évaluer (Granjon, 2012). Idéalement, la critique s’incarne dans une production symbolique visant à fournir des armes théoriques, à la fois gnoséologiques (connaissance) et cognitives (raisonnement) permettant que se développe un mouvement de la pensée libéré de l’empirisme, du positivisme, des réductionnismes, des déterminismes, etc. Mené à son terme, cet ordre de critique doit effectivement permettre un dégagement de la doxa, de faire rupture avec certaines représentations, et de comprendre comment celles-ci nourrissent des dispositions ayant pour particularité de structurer des sens pratiques qui s’ajustent aux nécessités elles aussi pratiques du monde tel qu’il va. Le combat que mène le chercheur contre l’illusion du savoir immédiat trouve un écho, sous condition de la critique, dans les opérations de dessillement qui permettent non pas de se prémunir de certains désajustements épistémiques (i.e. sociologiques), mais, a contrario, de prendre conscience et éventuellement de se dégager des ajustements sociaux courants, lesquels ne sont aucunement contradictoires avec certaines formes de critique portées par les sujets sociaux eux-mêmes, ne serait-ce que parce que l’expérience d’être au monde produit potentiellement de la souffrance.
L’une des missions de la connaissance critique est ainsi de conférer une existence théorique aux pratiques émancipatoires pré-théoriques et, par là, de leur apporter une plus grande force. La critique est en cela une déconstruction-reconstruction de la facticité faite évidences et habitus (i.e. des manières d’être, de penser, de ressentir, etc.), laquelle obstrue le passage vers d’autres manières de penser et d’agir.
La critique permet donc d’appréhender la réalité sociale, notamment dans ses aspects communicationnels, sous les conditions de points de vue « nouveaux » qui autorisent la possibilité conceptuelle d’un dépassement (une maîtrise symbolique) et une projection du sujet social dans un « a(d)venir » potentiellement porteur d’autres réalités sociales qui admettraient davantage de possibilités émancipatrices. L’objectif de connaissance qu’elle porte tient d’abord à la révélation des différentes formes de domination qui s’exercent dans le cadre d’un ordre social qui pèse sur le présent et qui, la plupart du temps, font l’objet d’une méconnaissance (i.e. pas nécessairement d’une ignorance) de la part des sujets sociaux qui les subissent. Pratiquer les sciences sociales (au nombre desquelles les SIC) depuis une perspective critique est en cela une forme de participation au « travail collectif d’invention politique » (Bourdieu, 2001b) : donner des raisons d’agir, fournir les armes de l’indignation et, ainsi, contribuer à la libération des potentiels de mobilisation susceptibles de peser sur le réel. La critique ouvre possiblement à un « positif », à un progrès social qu’il s’agit d’actualiser dans des moments de radicalisation. Contre l’évidence du sens commun, elle a vocation à lever le voile sur la vérité des rapports sociaux qui ne se donnent jamais totalement pour ce qu’ils sont et se parent d’ornements symboliques qui les travestissent et concourent à leur mise en acceptabilité (e.g. via un travail médiatique). Elle participe donc à rendre la réalité et l’ordre social inacceptables et invite à agir sur cette réalité, sachant par ailleurs que la théorisation ne saurait être qu’une des multiples ressources du politique.
Les sciences sociales critiques ont ainsi vocation à armer la « critique ordinaire », à dénaturaliser l’arbitraire du monde tel qu’il va, à « défataliser » les déterminations sociales, à détruire les mythes justificatoires, à défaire l’idéologie et la violence symbolique ; bref à « énoncer des vérités utiles » selon l’expression de Gérard Noiriel, (2003 : 6). Elles participent en cela au politique, mais elles y contribuent depuis ce qu’elles sont en tant que pratiques sociales et ne peuvent donc investir la dimension politique qu’en étant parfaitement draconiennes quant à leurs manières de s’y mêler et de lui fournir quelques ressources pratiques dont la spécificité tient à la rigueur scientifique. La charge véritablement politique des sciences sociales s’avère intrinsèquement liée à une autonomie de la pratique, à une « realpolitik de la raison » scientifique selon une expression chère à Bourdieu et se trouve ainsi proportionnellement liée à leur sérieux épistémologique. Aussi, je crois qu’il faut insister sur ce point : les chercheurs critiques doivent se montrer particulièrement attentifs aux conditions de production des savoirs qu’ils façonnent. Notamment, toute activité scientifique engagée ne peut être découplée d’une réflexion première sur l’engagement du chercheur, au sein même du champ professionnel qui est le sien, sur les règles du jeu scientifique et académique, les rapports de pouvoir, ou encore les procédures de gouvernance des espaces de recherche. Pourquoi ? Eh bien comme le rappelait Bourdieu, parce que la lutte scientifique a pour enjeu le monopole de la représentation scientifiquement légitime du réel.
- Les SIC et la critique
J’aborde donc maintenant mon second point traitant plus spécifiquement des SIC et de la critique.
J’aimerais notamment proposer quelques pistes de réflexion à partir d’un nombre restreint de « charnières épistémologiques » qui vont me permettre de dégager un horizon critique provisoire pour les sciences de l’information et de la communication. Et pour ce faire, je vais passer en revue un ensemble de « dégagements » qui, prenant comme base de travail les principes faisant globalement consensus au sein de la discipline, en proposent néanmoins des aménagements conséquents pour les transposer sur une partition critique. Entendons-nous donc bien : il ne s’agit pas de prendre les SIC à revers mais bien de les prendre au sérieux en ce qu’elles sont discutables, c’est-à-dire méritent d’être discutées. Et pour discuter de cette rencontre des SIC et de la critique, je vais aborder successivement différents points à commencer par l’interdisciplinarité
Critique et interdiscipinarité
Je commencerais donc par partir de la question de l’interdisciplinarité. Il est devenu commun au sein des SIC de considérer qu’elles trouveraient une partie de leur cohérence et de leur autonomie dans la capacité supposée à établir des ponts entre des champs disciplinaires séparés à partir de domaines d’étude spécifiques (les médias, les TIC, etc. – e.g. Monnoyer-Smith, 2008). Autrement dit, l’interdisciplinarité y est consacrée comme heuristique primordiale et elle est envisagée comme fondement disciplinaire de ces « sciences carrefours » qui, nous dit-on par ailleurs, « ne sauraient […] viser à former une nouvelle discipline » (Miège, 1998). On reconnaîtra qu’il y a de quoi en perdre son latin, mais acceptons provisoirement le principe d’une discipline qui n’en est pas une, « tombant entre les disciplines » (selon la formule de Bougnoux) et dont la nature serait interdisciplinaire.
Ce sur quoi nous voudrions insister tient au fait que le principe interdisciplinaire ne saurait constituer une prérogative exclusive des SIC. Il est faux d’affirmer que les disciplines « traditionnelles » feraient œuvre de clôture, se contenteraient de porter un regard convenu sur des objets somme toute communs et produiraient des savoirs insulaires reflets de leur splendide isolement, tandis que les novatrices sciences de l’information et de la communication décriraient, elles, un espace inédit de connexion, de confrontation et de synthèse des divers apports des SHS.
Force est de constater que si les SIC, comme le suggère Daniel Bougnoux, exercent un quelconque « droit de suite » par rapport aux autres disciplines en leur empruntant le plus souvent leurs concepts et leurs cadres théoriques, ces dernières s’immiscent aussi sur le terrain des recherches en communication en s’intéressant aux objets que les SIC seraient tentées de revendiquer comme relevant de leur jouissance (exclusive). De surcroît, les sciences sociales développent aussi des épistémologies de la complémentarité qui prennent forme au sein d’un constructivisme prônant l’étude des médiations et des constructions sociales, plutôt que celle des choses, des essences et de « l’allant de soi » (Keucheyan, 2007). Cette attitude épistémologique est en effet partagée par beaucoup des « nouvelles sociologies » (Corcuff, 1995) avec lesquelles les sciences de l’information et de la communication entretiennent parfois des « conflits de territoire », mais sur lesquelles, rappelons-le, elles ont également pris appui pour émerger. La proposition de postures théoriques dépassant les antinomies traditionnelles entre idéalisme et matérialisme, micro et macro, collectif et individuel, sujet et objet, etc., ne peut être décemment présentée comme un trait caractéristique exclusif des SIC. Si l’approche des phénomènes de communication a tout à profiter d’une prise de distance avec des épistémologies binaires au profit d’un positionnement posant le primat de la relation sur les essences, ce principe ne saurait ni être exclusivement attribué aux SIC, ni évidemment leur être réservé. Aussi, affirmer, je cite que la « volonté de construire des objets complexes, caractérisés par une multiplicité de niveaux emboîtés, n’est pas présente chez les disciplines mères auxquelles les SIC empruntent » (Perret, 2009 : 127) relève soit d’une méconnaissance (feinte) des sciences sociales, soit d’une prophétie auto-réalisatrice.
Cette exigence interdisciplinaire est notamment portée par la critique qui réclame, pour sa part, le rassemblement de déterminations théoriques variées mais associables, refuse « les cloisonnements disciplinaires au nom même de la transversalité de tous les objets sociaux » et tend à généraliser « la démarche multiréférentielle et complémentariste » (Brohm, 2004 : 80) sous surveillance. Elle envisage donc ces nécessités à distance de l’hybridation théorique sans contrôle qui tend à multiplier les emprunts conceptuels et à juxtaposer des notions sans tenir compte des modèles d’analyse auxquels elles appartiennent originellement, tout comme des fondements axiologiques qui les portent. Par ailleurs, le principe interdisciplinaire de la critique ne se justifie pas tant par la complexité singulière (ici « communicationnelle ») des objets qu’il se donne pour objectif d’appréhender, que précisément par le regard critique qui le sous-tend, c’est-à-dire un projet scientifique axiologiquement fondé qui implique en effet de lutter contre la fragmentation des savoirs, c’est-à-dire leur confinement par spécialisation, leur réservation à l’espace académique et leur restitution par bribes (les formats des articles scientifiques ne cessent de rétrécir comme peau de chagrin), précisément parce qu’il s’agit de la seule manière de mettre au jour les ordres de détermination qui font système et auxquels la critique s’oppose.
« Ce que nous devons comprendre une fois pour toutes, précise par exemple Lucien Goldmann, c’est qu’il ne s’agit pas de mettre ensemble des recherches positivistes d’un secteur, qui ne tiennent pas compte du sujet, avec des études idéalistes qui partent du sujet individuel ou psychologique, qui ne tiennent pas compte de la réalité sociale et oublient la relation étroite entre fonctionnalité et structure (c’est-à-dire qui ne sont pas dialectiques) et de croire qu’on fait ainsi de l’interdisciplinarité avec trois ou quatre perspectives unilatérales ; cela ne fait pas une perspective scientifique. […] [Il s’agit plutôt] de tenir compte du sujet transindividuel en tant qu’acteur qui transforme la réalité » (Goldmann, 1971 : 153).
Ce sur quoi insiste Goldmann, c’est sur le fait que la critique suppose nécessairement une praxis, c’est-à-dire une logique de l’action qui, pour être efficace, doit reposer sur de multiples prises, notamment normatives. C’est relativement à l’aune de cette nécessité que doit être relevé le défi des dialogues scientifiques transfrontaliers pour rétablir des ordres relationnels indûment découpés, lutter contre la spécialisation des sciences humaines et sociales et s’opposer ainsi au « fractionnement du processus de compréhension ».
Penser la totalité sociale, ses appuis communicationnels et leurs différents moments nécessite de comprendre les phénomènes sociaux (de communication) comme des réalités dynamiques structurées, aux raisons plurielles, changeantes, contradictoires mais solidaires, dépendantes les unes des autres et qu’il convient d’appréhender de manières différentes et à des moments divers. La variété des sciences sociales et humaines peut alors se concevoir comme une base pluridisciplinaire à partir de laquelle doivent être conduites des recherches critiques en capacité de saisir les difficultés dialectiques de la réalité sociale en tant qu’elles participent d’une totalité. Un dialogue cadré des différentes « logies » peut permettre à la critique de saisir dialectiquement le singulier, le particulier et le général ; à l’évidence par un commerce privilégié entre la sociologie et l’histoire (Passeron, 1991), mais aussi par des collaborations entre d’autres disciplines (philosophie, psychologie, sciences de l’information et de la communication, sciences du langage, science politique, etc.) qui peuvent avoir leur mot à dire et proposer des « éclairages par complémentarité réciproque » (Gurvitch, 1962 : 294).
Ce qui caractérise les recherches critiques sur les faits sociaux de communication, c’est peut-être qu’elles appréhendent des classes de phénomènes jouant pour certains (e.g. les faits médiatiques) un rôle évident dans l’ajustement des existences aux impératifs des sociétés contemporaines. Mais plus encore (car ce rôle est assez largement distribué : le politique, l’éducation, etc.), la singularité du « communicationnel » tient peut-être aussi à ce qu’il participe toujours, d’une manière ou d’une autre, à l’établissement de cette facticité, d’un pseudo-concret (Kosik, 1988 – et donc potentiellement à son dépassement). Il y a presque 25 ans, Pierre Moeglin écrivait ceci : « l’objet de la recherche critique n’est pas d’étudier la communication dans ses contextes. Il est d’en traiter comme d’une composante au sein de situations qu’à travers elle, elle prend globalement en compte » (Mœglin, 1992 : 135). L’invite centrale de cette remarque essentielle est ainsi d’envisager la communication en lien avec les conditions de production et de reproduction des rapports sociaux qui en fixent les cadres. S’intéresser par exemple aux médias, aux TIC ou aux industries culturelles convie à mettre en regard ces réalités dites « communicationnelles » avec d’autres dynamiques sociales plus larges. Dans une perspective critique, la communication n’est donc pas foncièrement différente du culturel ou du social.
Dialectique, totalisation et raison communicationnelle
Outre l’interdisciplinarité, une des autres charnières à partir de laquelle ont peut envisager la rencontre des SIC et de la critique est celle qui défend l’existence d’une approche communicationnelle comme nomos de la discipline, à l’instar par exemple d’un Daniel Bougnoux, pour qui le primat de la relation sur la substance ou les termes de cette relation serait une singularité des SIC. Pour lui, mais aussi bien d’autres, il y aurait donc, je cite la Meyriat, « une problématique propre à l’information et à la communication », problématique qui aurait donc tous les atours d’un paradigme, c’est-à-dire d’une théorie de portée globale, censée être prééminente par sa puissance épistémologique.
Cette problématique n’est toutefois jamais clairement présentée au-delà de quelques-uns de ses aspects, lesquels recouvrent, grosso modo, les nécessités d’un constructivisme qui une fois encore ne peut en rien être conçu comme un privilège ou une prépotence des recherches en communication. Pourtant, d’aucuns semblent vouloir lui attribuer le rôle d’arbitre des élégances disciplinaires, sans doute parce qu’ils considèrent qu’il s’agit là de l’unique manière possible de qualifier les SIC comme discipline scientifique autonome.
L’originalité épistémologique des SIC tiendrait, nous dit-on, « à la nécessité dans laquelle elles se trouvent de devoir construire leur objet de recherche comme objet scientifique en adoptant une posture vis-à-vis de l’objet concret qu’elles étudient ». Fort bien, mais encore ? Que la recherche en SIC « ne traite pas d’objets scientifiques préconstruits comme c’est le cas dans les sciences traditionnelles comme la sociologie par exemple, où l’objet est ‘‘problématisé’’ [sic] » (Davalon, Jeanneret, 2006 : 205-204), mais s’occupe en revanche « de l’inter, de la médiation, de la mise en perspective, de l’articulation, des relations […], de concepts, de théories, de problématiques, d’instances (émission/production et réception), de dimensions (économiques, techniques, politiques, langagières, etc.), d’échelles (micro, méso, macro), de dispositifs, d’enjeux sociaux… ce que les autres disciplines ne font pas, en tout cas de façon systématique » (Boure, 2005 : 26). Une fois de plus, il ne manque plus que les ratons laveurs… À cette aune, il n’est pas très étonnant de constater que, scientifiquement parlant, le « paradigme communicationnel » peine à se fixer dans des propositions clairement identifiables et non revendicables par les « grappilleurs » des autres disciplines. Cette indétermination, Davallon considère par ailleurs qu’elle est un implicite valant postulat :
« Il existerait ainsi, chez les chercheurs de sciences de l’information et de la communication, une théorie implicite des objets communicationnels. Je veux dire par là que n’importe quel chercheur est capable de dire, s’il laisse un tant soit peu de côté les objets scientifiques, qui sont habituellement les siens, et les normes liées au cadre théorique qu’il utilise habituellement, ce qu’est une recherche dans le domaine des sciences de l’information et de la communication – ou à tout le moins ce qui n’en est pas » (2004 : 35).
Cet implicite, poursuit-il, « est continuellement mis en œuvre dans les instances scientifiques et disciplinaires de la communauté ; je pense aux colloques, au CNU ou encore aux journées doctorales, c’est-à-dire chaque fois que viennent au jour des pratiques, des questions et des échanges que le chercheur garde habituellement plutôt pour lui » (2004 : 35). On observe (avec angoisse et compassion pour les doctorants) qu’un « implicite », c’est-à-dire un principe qui ne s’énonce jamais complètement puisse faire partie de la table des lois déterminant le coût scientifique des SIC auxquelles les chercheurs sont censés se contraindre. Il pèse notamment sur les jeunes impétrants qui visent à rentrer dans le champ (i.e. s’y qualifier) et cherchent à montrer combien leurs travaux sont en conformité avec les valeurs de la communauté disciplinaire, laquelle saura reconnaître les siens, c’est-à-dire « les thèses procédant à une réelle analyse communicationnelle » (Davallon, Jeanneret, 2006 : 207). Cela explique sans doute les pages que l’on trouve dans la quasi totalité des thèses de doctorat, qui visent à faire la preuve de l’allégeance des auteurs aux sciences de l’information et de la communication (la recherche du label « communicationnel ») et dont on comprend bien qu’elles sont un exercice (des clauses) de style obligé(es), un laissez-passer institutionnellement indispensable, mais qui scientifiquement ne s’avère pas nécessairement de grande portée.
Miège propose par exemple de contraindre la recherche en SIC à développer « des méthodologies et des questionnements ‘‘à moyenne portée’’ » (1995 : 100) dans une veine empirico-théorique visant notamment l’identification de « logiques sociales de la communication autour desquelles les stratégies des acteurs sociaux, qu’ils soient dominants ou dominés, sont plus ou moins contraints de s’organiser et de se développer » (2004 : 124-125). Il s’agirait ainsi de donner une réelle épaisseur au « communicationnel », laquelle nécessiterait une forme de raisonnement dont la « raison communicationnelle » serait le modèle et qui permettrait de s’intéresser aux phénomènes éponymes au-delà de leur simple « dimension sectorielle » : articuler « productions de messages, production de sens et réception des discours », articuler « ce qui est offre [et] ce qui est demande, ce qui est production [et] ce qui est consommation, ce qui est énonciation [et] ce qui est réception » (Miège, 1999 : 28). Il s’agit alors, poursuit Miège s’appuyant raisonnablement sur Bourdieu, de considérer les phénomènes sociaux de communication comme des « mouvements structurants-structurés » de longue durée tombant sous le coup des déterminations de l’ordre social duquel elles sont issues, mais pouvant aussi participer de logiques sociales contradictoires, notamment émancipatoires.
La critique partage à l’évidence cette exigence, mais ce qui est en revanche discutable, c’est une fois encore : a) d’accrocher uniquement cette exigence à une épistémologie indigène qui serait l’invention exclusive des sciences de l’information et de la communication ; b) d’affirmer que cette exigence dialectique serait de facto « dominante » au sein des SIC, et enfin c) que la communication est un phénomène social total « qui ne pourrait être appréhendé au travers [du] découpage disciplinaire traditionnel » (Boure, 1999 : 54). Sauf à considérer qu’il n’y a que les phénomènes sociaux de communication qui relèveraient de phénomènes sociaux totaux et que personne ne s’y serait penché sous cet aspect, il est douteux de laisser à penser que les sciences sociales en général et la critique en particulier n’aient pas su mettre en place quelque dispositif théorique pour saisir ce type de complexité. Aussi, le « penser communicationnellement la communication » de Daniel Bougnoux (1993) ne recouvre pas autre chose que des nécessités dont il faut rappeler une nouvelle fois qu’elles n’ont pas attendu les sciences de l’information et de la communication pour exister et dont on peut par ailleurs souligner la compatibilité avec les attendus de totalisation de la critique.
La critique s’efforce en effet de mettre en évidence que les faits sociaux sont comme historiquement ancrés au sein d’un « général » et adopte un point de vue qui les recontextualise dans une structure sociale globale et les envisagent comme des singularités porteuses de cette structure du tout. La difficulté est alors, pour parler comme Jürgen Habermas, de prendre en compte avec un égal intérêt mondes vécus et système afin d’évaluer les déclinaisons variables des rapports qu’ils entretiennent dans un « général particularisé » qu’incarne toujours un objet de recherche. Malgré l’apparente variété et singularité des phénomènes sociaux, la critique doit en effet s’appliquer à reconstituer l’unité des multiples dimensions de la vie sociale, considérant potentiellement ces dernières comme les précipités de diverses formes de domination entretenant quelque relation entre elles : « la totalité concrète est comme le souligne Jean-Marie brohm, je cite, « non seulement le produit des sujets humains concrets, porteurs de la dialectique sociale, mais aussi le milieu au sein duquel se produisent et reproduisent ces mêmes sujets » (Brohm, 2003 : 229). Autrement dit, la critique se livre de facto à des montées en généralité fondées sur un principe de totalisation, c’est-à-dire envisage les faits sociaux comme participant à des totalités structurées de contradictions qui sont des ordres sociaux dont les diverses dimensions font système.
Si l’on s’accorde sur le fait que c’est le répertoire des liens variés qui unissent l’homo communicans aux sociétés capitalistes avancées qu’il s’agit de décrire, d’analyser, de comprendre et d’évaluer, il s’avère effectivement indispensable de se donner les moyens de rendre à la fois compte de conduites microsociales et d’orientations macrosociales, d’expériences personnelles et de structures collectives, d’usages techno-médiatiques et de politiques industrielles. Sans viser la construction d’une théorie critique intégrée de la communication, il faut néanmoins se mettre en capacité de relever le défi d’une unité intellectuelle dont l’ambition première est peut-être de mettre en lumière les formules génératrices des modalités médiatiques, industrielles et technologiques de domination sociale et symbolique, ainsi que leurs contradictions : « ce qui fait que les médias – et la communication – sont ce qu’il sont » (Mœglin, 1992 : 135). À cette aune, les phénomènes sociaux de communication sont à considérer comme pouvant participer du maintien ou du déplacement des conduites sociales, que ce soit dans le sens d’une réalisation ou dans celui d’une limitation des individus qui y participent d’une quelconque manière.
Histoire, structures et praxis
J’abord enfin mon dernier point qui tient à la nécessité historique. Au sein des sciences de l’information et de la communication, il est en effet de bon ton de considérer que les phénomènes sociaux dont on s’occupe doivent être restitués dans leur profondeur historique, or force est de constater que la chose est davantage revendiquée que pratiquée. Cette exigence fait pourtant bon ménage avec le logiciel critique qui considère lui aussi que les réalités sociales doivent être comprises à la fois dans leur genèse et dans leur structure (c’est également selon Charles Wright Mills le propre de l’imagination sociologique). Héritière directe du marxisme, l’approche structuralo-génétique considère que les faits sociaux sont des faits historiques ; ils se construisent par l’action humaine et portent donc en eux la marque de la société, c’est-à-dire les rapports sociaux de la totalité concrète). Se donnant pour principe de connaître scientifiquement le mouvement des totalités sociales réelles et historiques, la critique estime en effet que l’« essence » de l’homme relève de ses relations sociales, c’est-à-dire tient à l’ensemble des rapports sociaux qui le constituent comme sujet des sociétés humaines (Etienne Balibar parle à ce titre d’ontologie de la relation).
La dialectique pourrait être ainsi mobilisée comme une ressource essentielle, en tant que méthode d’intellection du concret qui ouvre à une appréhension descriptive, analytique, compréhensive et évaluative de la réalité sociale. De facto, la dialectique a pour objectif de penser l’historicité et les contradictions du processus historique. Autrement dit, la dialectique pose le futur comme un choix à potentiellement effectuer qui ne peut faire abstraction des forces/contraintes du présent et doit même inévitablement reposer sur elles. Avec la dialectique, le temps historique se trouve à la croisée d’un passé qui éclaire le présent, de l’objectivité présente des rapports sociaux et des horizons d’attente susceptibles de définir un futur. Autrement dit, elle permet que le présent immédiat cesse d’être une geôle pour la pensée. Celui-ci devient l’espace-temps où se chevauche le passé précipité et l’embryon d’un futur, étape d’un processus temporel qui place en responsabilité les sujets sociaux quant à leur avenir et à leur capacité à déplier le présent vers un ailleurs meilleur qui, d’une part, ne fera jamais du passé table rase et, d’autre part, aura à dépasser les contradictions majeures de la société capitaliste avancée.
Pour la critique la plus matérialiste, la dialectique se présente donc comme un dispositif permettant de saisir le monde tel qu’il va, condition de possibilité de la mise en œuvre d’une praxis qui tienne compte de la complexité des sociétés et de leurs contradictions. Elle est un moment épistémologique de saisissement des relations internes à un système (c’est-à-dire dégager des structures, des régularités, des formes, etc.), qui se prolonge dans la reconstruction intellectuelle de la réalité sociale constituée de ces liens d’interdépendance (c’est-à-dire articuler les concepts dans un va et vient entre abstraction et concrétude) et se termine dans une praxis qui vise un agir conscient sur le monde à des fins de changements progressistes.
L’approche critique couple ainsi la connaissance à l’action et vise le dépassement de la société actuelle (transformation historique) en liaison étroite avec le principe d’une émancipation à venir, susceptible de redonner quelque puissance de penser et d’agir aux sujets sociaux. Autrement dit, la critique se pose la question (en théorie) de sa réalisation pratique et suppose de faire fond sur une éthique sociale à la recherche d’effets pratiques. La pertinence ou la vérité d’une théorie critique se trouve ainsi placée dans la pratique qui est censée trancher à la fois sur la validité scientifique et sur la pertinence politique, c’est-à-dire sur sa capacité à participer au dégagement des illusions, dominations et réifications qui pèsent sur les sujets sociaux.
Comprendre pour transformer un présent pris en défaut, voilà le point d’achoppement et force est de constater que si, au sein des sciences sociales, les deux premières étapes de la méthode dialectique (i.e. l’investigation diachronique et l’exposition synchronique des structures) sont acceptables, voire recommandées, la troisième étape est, elle, le plus souvent perçue comme une hérésie. La possibilité d’envisager un « nouveau monde » en puissance, couvant au sein du monde tel qu’il va et de se donner le droit d’en évaluer les potentiels sont des attitudes perçues comme des embardées normatives dont le chercheur en sciences social aurait évidemment à se prémunir.
Dans une perspective critique, la démarche de distanciation n’est donc pas synonyme d’une absence d’engagement, mais, a contrario, elle se présente comme la conséquence directe de l’engagement. Cette distanciation constitue une entreprise de démystification de la neutralité axiologique qui oppose artificiellement scholarship et commitment, et présente tous les atours de l’idéologie professionnelle de chercheurs qui se pensent « sans attaches ni racines » et considèrent que la science qu’ils produisent doit et peut être exempte de « l’intrusion de perturbations, d’éléments étrangers au travail du pur logos décontextualisé » (Vincent, 2003 : 39).
Force est de constater que dans le cadre des sciences de l’information et de la communication, la dimension normative est peu pensée (bien qu’elle doive être tenue pour essentielle), et ce, y compris au sein des approches se revendiquant explicitement de la critique. Ici ou là, il peut s’écrire que les SIC, je cite là Robert Boure, « ne peuvent faire valoir de spécificité qu’en acceptant de se reconnaître comme une des sciences du politique » (Robert, 2006 : 554), mais ce type d’assertion est devenu bien rare et n’épouse pas nécessairement, de surcroît, tous les attendus qu’il devrait théoriquement porter.
Le temps où, dans la littérature du domaine, la communication pouvait être couplée assez directement aux problématiques de la lutte des classes ou de l’idéologie (e.g. Goldmann, 1971 ; Mattelart, Siegelaub, 1979 ; 1983 ; de la Haye, 1984, Beaud, 1984) semble être une période bel et bien révolue. Aussi n’est-il pas inutile de rappeler avec Miège que la communication est « autant un enjeu scientifique-institutionnel qu’un enjeu idéologique-politique » (2004 : 180) et qu’il est tout aussi important de comprendre que ces deux dimensions ne sont pas étrangères l’une à l’autre. Elles entretiennent des rapports complémentaires et contradictoires que la vulgate scientiste intime de ne considérer que sous l’angle de l’opposition entre science et engagement. De facto, s’il est un engagement qui prévaut au sein des SIC, celui-ci est essentiellement lié à une éthique et à un ethos disciplinaires, référents organisationnels plus qu’axiologiques qui ne sauraient remplacer la morale pratique de la critique parce qu’ils ne se fondent que sur les spécificités d’un espace social singulier, un sous-champ des sciences sociales, qui ne peut porter à lui seul les indignations et les prétentions pratiques d’une critique conséquente.
À l’instar de la sociologie au temps de Durkheim, les SIC semblent s’être plutôt reniées comme sciences politiques, peut-être pour gagner une légitimité académique qui semblait leur faire défaut. Pourtant, loin de fausser l’appréhension scientifique de l’objet d’étude, le travail d’objectivation « éthiquement fondé », c’est-à-dire reposant sur des normes de devoir-être, va dans le sens d’une clarification des tensions entre discussion scientifique des faits et raisonnement axiologique. Il permet de préciser les cadres généraux prévalant à la problématisation ainsi qu’à l’élaboration conceptuelle et balise dans un même mouvement la façon dont il pourrait être utile au-delà des frontières de la discipline et de la production scientifique stricto sensu.
Ce que la critique revendique, c’est donc une activité de production de savoir engagée, sous condition de la pratique scientifique et politique, n’opposant pas strictement la raison pure à la raison pratique, les jugements de fait et les jugements de valeur, l’éthique de responsabilité et l’éthique de conviction, le savant et le politique, l’engagement et la distanciation. Aussi, la question de l’engagement conduit assez directement à une autre interrogation qui lui est parente et vise à déterminer de manière consciente ce à quoi la critique doit servir : quels sont ses usages sociaux ? Comment s’articulent les processus scientifiques d’objectivation du monde social, les logiques d’appropriation de ces savoirs et les pratiques de subjectivation ? Autant d’interrogations qui ne semblent pas aujourd’hui préoccuper spécialement le champ des SIC.
Conclusion
En guise de conclusion, j’aimerais juste attirer votre attention sur ce que disais Jean-Michel Berthelot de la sociologie, qui selon lui ne tire son unité, je cite : « ni d’un consensus sur l’objet, ni d’un consensus sur la méthode, mais [d’]un consensus polémique sur la visée [cherchant à] élaborer un corpus de références scientifiques » (1998 : 1), les SIC pourraient se satisfaire d’un tel minimum, sans chercher à fédérer autrement que par cette voie, loin de tout communautarisme disciplinaire, des intimidations épistémiques de la « pensée communicationnelle » et des prolongements irrédentistes qui viennent parfois s’y greffer.
Y ajouter comme exigence la nécessité critique est une option qui, de notre point de vue, doit être tenue pour essentielle. Pourquoi ? Parce qu’elle permet de réobjectiver les objets de recherche à l’aune d’un cadre herméneutique qui ne se réduit pas à la production d’un « récit de communion » performatif autour du « communicationnel » (Mouchon, 2008). La critique constitue un vecteur épistémologique pour les sciences de l’information et de la communication et offre un double rempart : d’une part, contre les tendances expansionnistes de certains chercheurs qui voient fort abusivement dans les SIC le nouvel épicentre des sciences sociales ; d’autre part, contre, et je cite là Armand mattelart, « le risque de voir se restreindre le champ de la réflexion théorique sous l’effet du retour à l’empirisme, et pour tout dire, à une vision myope de la professionnalité où prime la raison de l’ingénieur [ou du consultant] » (Mattelart, 1996 : 22).
Ce positionnement dessine un espace de problématisation dont l’unité relative se trouve moins liée à une quelconque nature communicationnelle de ses objets ou des approches mobilisées pour mettre en énigme ces derniers (on peut ainsi lire sous la plume d’Isabelle Pailliart que la théorie bourdieusienne des champs serait « particulièrement communicationnelle » [sic] – 2009 : 11 –, tout comme les économies de la grandeur ou la théorie de l’acteur-réseau – Bouillon, 2008), qu’au référentiel critique lui-même (i.e. à ses attendus), qui redonne notamment ses lettres de noblesse à la totalisation (saisir les interdépendances qui tissent le monde social), à la dialectique envisagée comme constructivisme critique, ainsi qu’à une praxis qui ne relève ni du pragmatisme utilitariste (engineering social – Mattelart, Mattelart, 2004), ni d’un « pragmatisme relationnel » (conceptuel), mais qui se couple à une nécessité pratique (politique) faite de réponses concrètes théoriquement informées. Aussi, des sciences de l’information et de la communication critiques devraient-elles lutter contre l’académisme et ses logiques de champ (essentiellement tournées vers la reproduction disciplinaire), contre l’arrogance « encyclopédante » d’une certaine « raison communicationnelle », contre la division sociale du travail intellectuel qui tend à entériner la rupture entre la production des connaissances et le changement social, et contre l’hyperspécialisation qui ne conçoit de trouver les schèmes explicatifs de la réalité sociale qu’à l’intérieur même de la discipline, voire de ses sous-champs spécialisés.