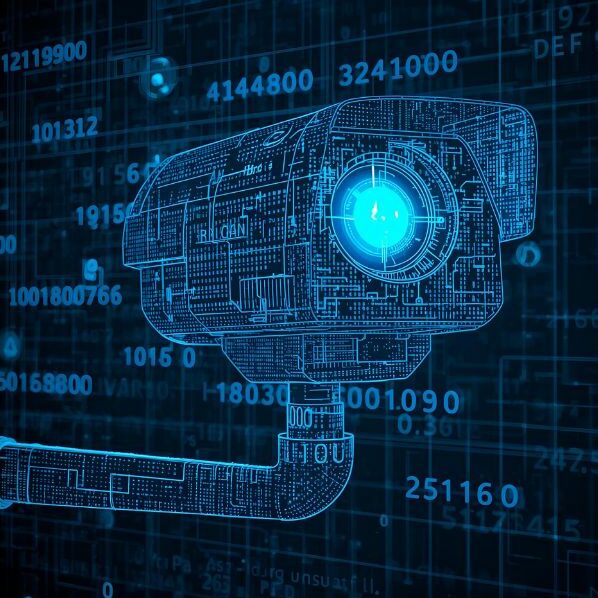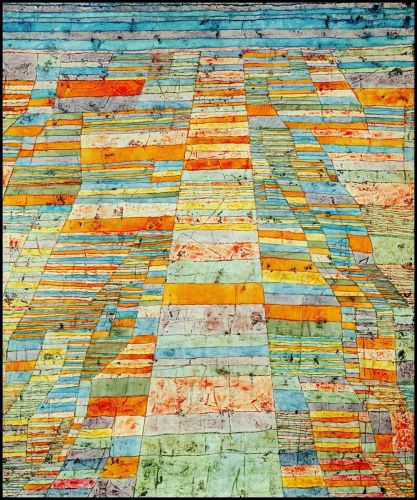Journée d’études — Discipliner la critique, critiquer les disciplines
Le mercredi 10 juin 2015 en D143 (Université Paris 8)
Journée d’études organisée dans le cadre et avec le soutien de l’école doctorale Sciences Sociales (ED 401)
Au sein des environnements institutionnels qui sont les nôtres, la production scientifique s’effectue, la plupart du temps, via un prisme disciplinaire. Aussi, les disciplines posent les exigences et les tolérances régissant le droit d’entrée dans la pratique et les identités professionnelles compatibles. Elles établissent les normes dominantes de la valeur scientifique auxquelles les chercheurs sont censés se soumettre en différentes régions épistémologiques et organisent ainsi la division sociale du travail scientifique.
Sous l’effet de la spécialisation disciplinaire, les intérêts de connaissance des chercheurs tendent à se segmenter et l’on assiste, volens nolens, à une balkanisation de la recherche, laquelle contribue, à l’évidence, à une perte « du sens des totalités sociales et des liens d’interdépendance qui existent entre des domaines différents de la pratique » (Lahire, 2012). À l’aune de cette disciplinarisation accrue de la recherche, il convient notamment de s’interroger sur la possibilité de maintenir une conception véritablement critique des phénomènes sociaux.
Programme :
« Critique et Interdisciplinarité » – Fabien GRANJON – Université Paris 8
Bienvenue à cette journée d’étude organisée par l’École doctorale Sciences sociales.
Comme nous n’avons pas prévu au programme de phase introductive, je me permettrais de ne prendre que le temps nécessaire pour vous présenter l’initiative et rendre quelques hommages modestes, mais appuyés et sincères.
Je souhaiterais commencer par rappeler que la présente journée Discipliner la critique, critiquer les disciplines est la troisième journée d’études organisée cette année par l’école doctorale Sciences sociales. Et j’aimerais remercier chaleureusement Alphonse Yapi-Diahou, André Filler et Mireille Morvan pour nous permettre d’organiser ce type d’événements, qui aussi modestes soient-ils, contribuent de belle manière à la formation doctorale et permettent d’ouvrir des dialogues fructueux, me semble-t-il, entre doctorants, entre chercheurs juniors et seniors, entre laboratoires et entre disciplines. Vous l’aurez compris, notamment au regard du titre de cette journée, la chose nous semble pour le moins importante. Ces espaces sont somme toute relativement rares, notamment parce qu’ils sont difficiles à construire en ce qu’ils nécessitent de dépasser les intérêts de connaissance strictement individuels, institutionnels et disciplinaires, et de s’aventurer sur les territoires plus inconfortables du dialogue critique transfrontalier. La direction de l’école doctorale a pris très au sérieux cette nécessité et je m’en réjouis.
En second lieu, je tiens bien évidemment à remercier les collègues de l’Université de Paris 8, mais aussi d’autres institutions, d’avoir accepté avec, je crois, un certain entrain, de participer à cette journée d’étude.
Aussi, je tiens tout particulièrement à remercier Razmig Keucheyan, sociologue à l’Université Paris 4 et Haud GÉGUEN, philosophe au CNAM, de venir nous faire bénéficier de leur lumière, ainsi que Christophe MAGIS et Maxime CERVULLE de bien avoir voulu jouer ce rôle toujours difficile de discutants, et à propos desquels je ne cesse de me dire que j’ai beaucoup de chance de les avoir comme collègues.
En troisième lieu, last but not least, j’adresse également mes plus vifs remerciements aux doctorantes et doctorants qui nous ont proposé des interventions et ont relevé le défi du dialogue interdisciplinaire sous les auspices de la critique. Merci donc à Pauline VILAIN-CARLOTTI, Léa LAVAL et Arthur de LEFÈVRE de leur volonté de participer et de leurs propositions fort intéressantes. Merci également à vous, membre de l’assistance pour le soutien que vous exprimez à l’événement de par votre présence et merci par avance pour la qualité des interventions que vous ne manquerez pas de faire lors des moments de discussion que nous allons avoir.
Avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, nos éminents directeurs souhaiteraient-ils dire deux mots ?
En guise de provocation introductive, je commencerais par vous soumettre une citation, celle d’un sociologue belge que j’aime bien, Claude Javeau, qui dans un ouvrage intitulé Des impostures sociologiques, publié en 2014 aux éditions du Bord de l’eau écrit ceci (slide) et je vous demande d’en effectuer une lecture en remplaçant les points d’interrogation rouges par l’intitulé de votre discipline.
« La première réduction consiste à ériger une muraille de Chine entre la X-ologie – dont on suppose qu’elle aurait une identité spécifique bien repérée – et les autres disciplines des sciences humaines et sociales. Le cloisonnement des disciplines enkystées dans des logiques administratives exclusivistes entraîne le repliement sectaire sur une supposée nature propre de la X-ologie qu’il conviendrait à tout prix de ne pas diluer ou métisser avec d’autres approches. Combien de fois, au CNU ou ailleurs, n’a-t-on pas entendu ces jugements péremptoires : « Ce n’est pas de la X-ologie», « cela ne concerne pas la X-ologie», « la méthode n’est pas X-ologique » ! […] Et malgré les innombrables proclamations officielles qui prétendent promouvoir l’interdisciplinarité, la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité, la X-ologie se calfeutre dans son bunker protégé par toute la piétaille qui peuple les diverses commissions, les équipes d’accueil, les sociétés savantes, les associations professionnelles ».
Le constat sévère que dresse Javeau et qui, comme vous venez d’en faire l’expérience, est un constat qui vaut assez clairement pour l’ensemble des sciences humaines et sociales, n’est toutefois pas une exception. Il est effectivement de bon ton quand on prétend être un social scientist réflexif, de dénoncer la parcellisation des SHS, la division sociale du travail scientifique et l’hyperspécialisation.
On trouve ainsi, dans des textes récents d’autres constats du même acabit. La chose occupe par exemple une surface non négligeable du Manifeste pour les sciences humaines et sociales rédigé par Craig Calhoun et Michel Wieviorka pour le premier numéro de la revue Socio (mars 2013, pp. 3-38, http://socio.hypotheses.org/147). Ils y affirment ceci : « De nombreux travaux en sciences humaines et sociales ont de façon délibérée une portée limitée, se donnant pour objectif de décrire un phénomène, un problème, une situation, un événement, une interaction, ou d’apporter une contribution à la connaissance des seules causalités du phénomène, du problème, de la situation, etc., au plus loin de toute ambition de synthèse ou de montée en généralité. […] Le savoir, ici, […] n’est pas fait pour s’inscrire dans une montée en généralité, il reste circonscrit à une question précise, sans être lié à des préoccupations d’ensemble. [Ce savoir] contribuera au mieux à légitimer son auteur, pour qui la règle du jeu demeure « publish or perish », il sera peut-être discuté par ses pairs, il fera peut-être l’objet d’une communication lors d’un congrès ou d’un colloque. Il correspondra à une division du travail dans laquelle des efforts parcellaires, limités, ne participent ni d’un projet ou d’une vision d’ensemble, ni d’un usage social de la production des sciences humaines et sociales. Et ils ajoutent : l’universalisme de la raison ne cède-t-il pas du terrain face à la poussée des spécialisations par domaine qui tendent à s’enfermer chacune dans son propre espace, sans communiquer avec l’ensemble d’une discipline et moins encore avec plusieurs ? »
S’il fallait donc résumer ces propos, on pourrait avancer qu’à l’instar du mouvement de fond accompagnant le développement des sociétés capitalistes avancées, le champ scientifique est pris lui aussi dans un mouvement de différenciation disciplinaire et de spécialisation de la recherche, recherche qui s’intéresse bien souvent à des microcosmes, des faits ou des objets sociaux parfois très spécifiques et la plupart du temps avec une grande précision, mais qui peine néanmoins à les resituer au sein de logiques sociales plus générales qui pourtant les produisent et auxquelles ils participent.
On pourrait même aller jusqu’à faire l’hypothèse que cette difficulté va croissante et que les sciences humaines et sociales auraient paradoxalement de plus en plus de mal à fournir des explications un tant soit peu globales des sociétés. Force est effectivement de constater que les intérêts de connaissance des social scientists se fragmentent, se segmentent et conduisent au final à une balkanisation de la recherche, laquelle contribue, dixit Bernard Lahire, à une perte « du sens des totalités sociales et des liens d’interdépendance qui existent entre des domaines différents de la pratique » (Lahire, 2012 : 322).
Dans son ouvrage Monde pluriel. Penser l’unité des sciences humaines et sociales, (Seuil, 2012), le même Bernard Lahire s’interroge sur cette pente inquiétante des sciences humaines et sociales : « Comment pouvoir dessiner une vue d’ensemble du monde social lorsque tout pousse chaque catégorie de chercheurs à garder le nez collé sur le fonctionnement de petites parcelles de ce monde ? Comment conserver une conception complexe des individus en société lorsque les découpages disciplinaires d’abord, les spécialisations internes ensuite, contraignent les chercheurs à travailler sur des dimensions à chaque fois spécifiques des pratiques individuelles ? Comment maintenir un haut niveau de créativité scientifique lorsqu’une conception étroite du professionnalisme conduit insensiblement vers une spécialisation poussée et une normalisation des recherches et des chercheurs ? » (Lahire, 2012 : 11).
Autant de question qui restent ouvertes et auxquels j’aimerais répondre globalement en posant en regard de cette division sociale du travail scientifique dont on a compris qu’elle scotomisait la recherche, une nécessité épistémique qui est celle de la critique. Mais avant d’ne venir à la critique, je voudrais revenir sur ce que l’on entend par interdisciplinarité…
Le premier constat que l’on peut dresser, c’est que si tout le monde semble apparemment d’accord sur le constat et propose peu ou prou de développer des formes d’interdisciplinarité pour lutter contre le repli disciplinaire, d’une part, et l’hyperspécialisation, d’autre part, l’interdisciplinarité postulée comme réponse idoine se résume néanmoins la plupart du temps, comme le souligne Dominique Vinck, à « un slogan pour inciter les spécialistes à ne plus borner leur domaine [et] à travailler aux marges, voire à circuler sauvagement dans l’ensemble de l’univers des savoirs » (2000 : 56). Toutefois, quand elle ne se résume pas seulement à cela, c’est-à-dire à un emballage marketing de la science, l’interdisciplinarité est en fait légitimée par différents types de nécessité, et je reprendrais là la catégorisation que propose Vinck. L’interdisciplinarité se justifierait donc :
-première possibilité, du fait de la complexité des objets étudiés : il y aurait des objets qui seraient en quelque sorte « par nature interdisciplinaires » qui renverraient à « des causalités multiples ». Il y aurait ainsi des objets plus ou moins complexes, nécessitant des regards pluriels censés s’additionner et dont le rassemblement permettrait d’avoir une vue d’ensemble vraie puisque complète. Selon cette option, c’est en fait la nécessité d’une pluridisciplinarité qui est posée, laquelle consiste « à juxtaposer des points de vue relevant de disciplines distinctes » en mobilisant des méthodes identiques ou complémentaires sur des objets communs ; ce qui, dans les faits, permet aux disciplines de conserver leurs pré-carrés et de s’allier sans avoir à modifier quoi que ce soit quant à leurs manières de faire science.
-L’interdisciplinarité peut aussi se justifier du fait de la nécessité d’indexer la recherche aux demandes économiques et sociales. C’est par exemple sous couvert de cette conception que, dans le plan d’action 2015 de l’Agence Nationale de la Recherche, la fameuse ANR, l’interdisciplinarité est clairement envisagée comme un levier de la compétitivité. Saisie dans une démarche de problem solving, l’interdisciplinarité vise alors, dans ce cas, à répondre aux demandes sociales portées par les innovateurs technologiques et économiques et notamment par la mythologique « classe créative » (gloubiboulgua pré-sociologique censé réunir universitaires, intellectuels, artistes et entrepreneurs), innovateurs donc… désireux de s’appuyer sur une production de connaissance ouverte leur permettant d’investir les contextes d’applications les plus rentables (économiquement, socialement, etc.) de leur domaine. Ici, l’interdisciplinarité est donc synonyme de recherche-action/appliquée/administrative. Cette entrée particulière a notamment pour particularité de remettre en cause la « condition scolastique » au nom des freins que cette dernière constituerait vis-à-vis d’une dynamique entrepreneuriale et libérale (prise de risque, mobilité, projets) qu’il s’agirait alors, évidemment, de prendre pour modèle. Aussi l’interdisciplinarité qui en découle est-elle aussi une forme d’hétéronomie. De celle qui faisait déjà dire à Marx que la valeur d’usage de l’économie politique était découplée de sa propre activité et se plaçait sous la coupe d’une dépendance externe travaillée par les intérêts du Capital.
-L’interdisciplinarité peut enfin se justifier du fait de ce que Vinck appelle la créativité scientifique-conquête, c’est-à-dire la nécessité d’une science indisciplinée qui n’aurait que faire des dogmes académiques et arpenterait plusieurs territoires, préférant se tenir aux marges et aux frontières et se donner ainsi la possibilité de « défricher de nouvelles terres », à l’écart des normes et des paradigmes les plus prégnants. Sous cet angle, l’interdisciplinarité est donc « une logique de la création [qui] ne reconnaît […] ni ne ratifie les frontières au moment même où elle les franchit ; elle les démantèle et les dissout, pour dessiner de nouveaux types d’appartenances intellectuelles » (de Lagasnerie, 2011 : 162). Ici, l’interdisciplinarité « suppose [donc] un dialogue, un échange ou une confrontation entre plusieurs disciplines » (Vinck, 2000 : 61-62), généralement par importations et traductions de problématiques et/ou de concepts. En ce cas, « le spécialiste essaye, du point de vue de sa science particulière et avec les méthodes qui lui sont propres, d’embrasser d’autres domaines et de réaliser ainsi l’unité de la connaissance par l’élargissement de sa propre sphère » (Jakubowsky, 1971 : 161). Poussez à son maximum, cette option devient celle de la transdisciplinarité, c’est-à-dire un dépassement des disciplines.
Dans les faits, les SHS vont rarement jusqu’à ce degré d’exigence qui me semble pourtant être le seul à véritablement tenir les attendus d’une remise en cause de la division sociale du travail scientifique. Et force est de contater que le plus souvent les disciplines restent considérées comme « point de départ à partir duquel on s’interroge sur les interactions entre disciplines ou sur la nécessité de dépasser la discipline » (Vinck, 2000 : 63).
Vous l’aurez sans doute compris, je voudrais défendre l’idée que seule une perspective critique permet réellement de remettre en cause les bastions disciplinaires et de conduire à ce que Douglas Kellner nomme dans son ouvrage Critical Theory, Marxism and Modernity (Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1989, pp. 230-231.), une supradiscipline, c’est-à-dire un point de vue consistant à prendre en compte simultanément plusieurs dimensions de la réalité sociale et leurs relations avec un système social dans son ensemble, ses contradictions et ses antagonismes, et ce durant une période historique spécifique. Depuis une perspective critique, la supradisciplinarité apparaît donc comme une nécessité émanant pour l’essentiel d’un impératif épistémologique qui n’est autre que celui de la totalisation, lequel vise à relier les phénomènes étudiés à des ordres sociaux qui en conditionnent l’existence.
Or force est de constater, et nous l’avons déjà rappelé, qu’au sein des SHS, le tout tend plutôt à être conçu comme la somme des différentes parties étudiées par les différentes disciplines et sous-disciplines. Mais comme le note Franz Jakubowsky, en prenant les choses ainsi, je cite : « se perd le lien des différentes parties entre elles et la relation des parties au tout. La totalité n’est plus une unité, elle n’est plus que la somme des domaines particuliers du Savoir. […] [Et] la dislocation n’atteint pas seulement le lien des différentes sciences entre elles, mais aussi leurs sphères intérieures mêmes qui se morcellent de plus en plus en différents domaines partiels » (Jakubowsky, 1971 : 162-163). Et Karel Kosik d’ajouter : « chaque aspect particulier de l’homme est isolé et aucun d’entre eux n’est capable, de son point de vue particulier, de fournir une notion de l’homme en tant que tout, concrètement et dans sa totalité » (Kosik, 2003 : 35).
A contrario, pour la pensée critique, à commencer par le matérialisme marxien dont Karl Korsh affirmait, je le cite, qu’il ne « ne se laisse ranger dans aucun des tiroirs habituels du système des sciences bourgeoises » (1979 : 7) et dont Jean-Marie Brohm note par ailleurs, je cite également, qu’il est « une théorie-praxis unitaire, globale, qui s’approprie la totalité de la réalité historico-sociale sans se fragmenter dans les différentes sciences sectorielles réifiées » (1974 : 38), la trans ou la supra disciplinarité se présente comme un impératif.
Pourquoi ? Eh bien parce que pour la critique, il s’agit de se donner les moyens de penser les « phénomènes sociaux » comme en mouvement. La critique suppose en effet d’abandonner « le ‘‘point de vue du laboratoire’’, intellectuellement rassurant, au profit du ‘‘point de vue de la totalité’’ […] qui implique de tenir compte de toutes les dimensions de la réalité, tout en abordant cette dernière dans la perspective déterminée [d’un problème particulier] – raison pour laquelle sa visée est totalisante sans qu’il recherche pour autant l’exhaustivité », précise Aurélien Berlan (2012 : 48-49).
L’idée de la critique, c’est de généraliser, ce que Jean-Marie Brohm appelle une « démarche multiréférentielle et complémentariste » (Brohm, 2004 : 80) qui s’oppose au « fractionnement du processus de compréhension » (Duchastel, Laberge, 1999 : 63). Autrement dit, ce que nous invite à faire la critique, c’est de penser la totalité sociale et ses différents moments, ce qui nécessite de comprendre les phénomènes sociaux comme des réalités dynamiques structurées et structurantes, aux raisons plurielles, changeantes, contradictoires mais solidaires, dépendantes les unes des autres et qu’il convient d’appréhender de manière différente et à des moments divers.
Sous les conditions de la critique, il s’agit donc d’envisager les phénomènes sociaux comme historiquement ancrés au sein d’un « général », en adoptant un point de vue qui les recontextualise dans une structure sociale globale et les appréhende comme des singularités porteuses de cette structure du tout, laquelle les éclaire sous un nouveau jour pour leur donner du sens en faisant tenir dans une totalité ce que la facticité empiriste et positiviste, mais aussi la mise en discipline de la science tendent à déli(t)er, disjoindre et naturaliser.
Dans son programme pour la Théorie critique, Horkheimer en appelait par exemple à la réalisation d’un matérialisme interdisciplinaire qu’il concevait comme la rencontre nécessaire, entre la philosophie sociale et la recherche empirique, notamment sociologique. Pour Horkheimer, dans les pas de Marx, il s’agissait donc de partir du « concret réel » et de procéder par abstraction, en faire un concret-pensé, c’est-à-dire en faire a minima l’histoire et la sociologie, en décomposant le tout en unités d’analyse pour l’appréhender de nouveau comme un tout, mais un tout recomposé par une médiation théorique qui l’éclaire sous un nouveau jour. Horkheimer proposait ainsi, dans les années 1930, de mettre en œuvre ce qu’il nommait une dialectique ouverte. Si sa proposition ne posait pas tout à fait l’ensemble des disciplines comme devant être mobilisées sur un même pied d’égalité (la philosophie devant exercer un magistère sur les sciences empiriques – Haud Guéguen y reviendra certainement cet après-midi), elle avait pour force de porter la nécessité d’une analyse sur matériaux des structures sociales, des sujets sociaux et des productions symboliques (science, culture, etc.) qui en sont le produit autant qu’elles les produisent.
Le matérialisme interdisciplinaire d’Horkheimer reconnaissait notamment le fait que sciences sociales et philosophie avaient intérêt à dialoguer pour éviter de tomber dans l’empirisme, l’idéalisme, mais aussi pour élaborer de concert et mettre au clair les ontologies, les axiologies et les gnoséologies au principe de leurs productions, lesquelles sont mobilisées le plus souvent sans être nécessairement explicités. Or la critique ne saurait être pleinement efficace sans une certain niveau de réflexivité qui nécessite l’apport d’approches aujourd’hui considérées comme disciplinaires, c’est-à-dire des savoirs aujourd’hui disciplinés et séparés les uns des autres alors qu’ils ont tout à faire ensemble. Dans le tome II d’un ouvrage intitulé La vocation actuelle de la sociologie, ouvrage paru à la fin des années 1960 (Paris, PUF), Georges Gurvitch précisait déjà que le rejet de la philosophie par la sociologie conduit, je cite « la majorité des sociologues à s’adonner à des philosophies implicites et inconscientes. Et précisait : La plupart des chercheurs empiriques font de la philosophie sans le savoir comme le bourgeois gentilhomme faisait de la prose » (1969 : 485-486).
Pour terminer ce point, je voudrais préciser que le principe de totalisation n’est pas synonyme de « tous les faits ». La totalité, et je cite là une nouvelle fois Karel Kosik : « signifie réalité comme ensemble structuré et dialectique, dans lequel – ou à partir duquel – des faits quels qu’ils soient (groupe ou ensemble de faits) peuvent être compris rationnellement. Rassembler tous les faits n’est pas encore connaître la réalité, et tous les faits (réunis) ne constituent pas encore la totalité. Les faits permettent une compréhension de la réalité, s’ils sont conçus comme faits d’une totalité dialectique, comme des parties structurants la totalité, et non comme des atomes immuables, indivisibles et irréductibles. Le concret ou la totalité ne signifie donc pas ‘‘tous’’ les faits, la somme des faits, l’accumulation de tous les aspects, de toutes les choses et de tous les rapports, puisqu’un pareil ensemble manquerait de l’essentiel : la totalité et la concréité. Si l’on ne comprend pas que les faits ont une signification et que la réalité est une totalité concrète, qui devient structure signifiante pour chaque fait ou ensemble de faits, la connaissance de la réalité concrète ne sera qu’une mystique ou une chose inconnaissable en soi » (Kosik, 1988 : 21).
La supradisciplinarité critique n’est donc pas un fétichisme holistique (Brohm, 2003), mais envisage les phénomènes sociaux comme participant à des totalités structurées. Comme le note Norbert Elias, je le cite : « l’investigation de structures provisoirement isolées n’a […] d’intérêt que dans la mesure où ces résultats sont constamment rapportés à un modèle de la configuration d’ordre supérieur. Les traits distinctifs des unités partielles ne peuvent pas être ici saisis de manière adéquate sans la règle procurée par un modèle théorique de l’unité d’ensemble » (1993 : 43).
J’aimerais pour terminer complètement dire deux mots sur le prolongement des nécessités que je viens d’exposer. Si l’on pousse un cran plus loin la remise en cause de la fragmentation des savoirs, leur confinement par discipline et par spécialisation à l’intérieur même des disciplines, l’on ne peut échapper, à un moment ou à un autre, à la remise en cause également de leur réservation à l’espace académique.
La lutte que prône l’irrédentisme critique contre ce que Jean-Marie Brohm nomme les « logiques administratives exclusivistes », ne peut, en effet, être pleinement efficiente si elle ne trouve pas écho dans une praxis bien plus large que celle de la sphère réservée et élitaire de la production théorique. Pousser la logique supradisciplinaire jusqu’au bout c’est essayer de repenser la « rupture épistémologique » chère à Bachelard, Bourdieu et à de nombreux marxistes, d’ailleurs pas nécessairement althussériens (le concept de « coupure épistémologique » étant central chez Althusser), en essayant de ne pas opposer radicalement la connaissance savante et la connaissance ordinaire, mais sans non plus les confondre. Un sociologue, un historien, un politiste, un géographe ou tout autre social scientist en tant que professionnel de la connaissance ne produit pas le même type de pensées ou d’analyses qu’un « profane » dont ce n’est pas le métier et qui n’a ni le temps, ni l’occasion, ni les ressources, ni les techniques, ni souvent l’envie de conduire une telle démarche. Pour autant ces deux sphères de production, scientifique et profane, ne s’opposent pas l’une à l’autre. Il existe des passages de l’une à l’autre : le scientifique est pris dans le monde au même titre que n’importe qui d’autre et le profane peut évidemment ne pas être ignorant des savoirs scientifiques. Sens commun, pré-notions, idéologies, représentations, savoirs scientifiques, concepts, théories, modèles d’analyse, sociologies professionnelles et spontanées ne sont évidemment pas complètement étanches les uns aux autres. Ce jeu des continuités/discontinuités est toutefois, en dernière instance, si vous me permettez ce clin d’œil, structuré par la division sociale du travail matériel et du travail intellectuel. Et pour dépasser le dualisme savant/ordinaire, sans doute faut-il prendre le problème sous l’angle du théorique, mais également depuis un point de vue pratique reconnaissant la nécessité de remettre en cause cette division sociale du travail.
Si la condition scolastique est assurément à défendre contre les attaques libérales qui vise à une indexation toujours plus grande, notamment de l’université, aux logiques économiques, il ne faut pas pour autant perdre de vue que ladite condition scolastique est aussi et contradictoirement « le produit de sociétés qui sont parvenues à dégager un surplus économique assez important pour que certains puissent être dispensés des exigences du ‘‘travail productif’’ » (Eagleton, 2000 : 16). Réviser radicalement ce grand partage, c’est nécessairement toucher aux rapports sociaux de production existants afin que puisse s’instaurer un rapport autre à la division sociale du travail et c’est de cette manière qu’il sera possible de soumettre la production théorique à d’autres types d’exigences que celles qui la déterminent aujourd’hui en tant que science.
Pour le dire autrement, la nécessité de la supradisciplinarité, c’est-à-dire la nécessité du point de vue de la totalité concrète, est aussi celle de la réconciliation du savoir et de l’action, lien qui du côté des chercheurs en sciences sociales a été rompu, notamment à grand renfort de neutralité axiologique. Or pour la perspective critique, il s’agit, comme le précise Karl Korsch (in Marxisme et philosophie) à propos du matérialisme historique, de, je cite, « comprendre théoriquement et [de] renverser pratiquement la totalité de la vie historique et sociale ». La pensée critique est en effet nécessairement émancipatoire, elle vise des changements sociaux pratiques concrets et ne saurait se laisse prendre à l’illusion de la force des idées qui, comme chacun sait, à moins de verser dans l’idéalisme, sont le produits de l’activité sociale et non l’inverse. S’il existe bien un « aspect intellectuel du processus historique d’émancipation » selon les mots d’Horkheimer, ce dernier ne saurait être réduit à des révolutions de papier. Aussi, pour Lucien Goldmann, penseur marxiste majeur mais aujourd’hui un peu oublié, la science ne pourra être, selon ses termes, « réellement interdisciplinaires que si l’on réintroduit le sujet créateur à l’intérieur de la vie sociale » (La création culturelle dans la société moderne, Paris, Denoël/Gonthier, 1971, p. 154), c’est-à-dire si l’on arrive à faire dialoguer plus directement les SHS avec « les groupes humains, les collectivités et les classes sociales » et faire ainsi en sorte que les idées deviennent forces matérielles.
Autrement dit, les armes de la critique ne sont assurément que de piètres pétoires sans la critique des armes, c’est-à-dire sans la nécessité de rendre pratique la théorie, théorique la pratique ; mais aussi, comme aimait à le rappeler Daniel Bensaïd, de rendre la raison autrement plus stratégique qu’elle ne l’est au sein de la sphère académique.