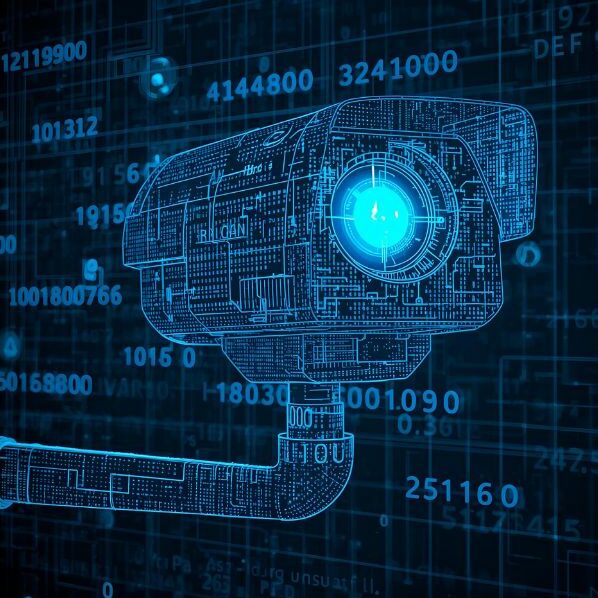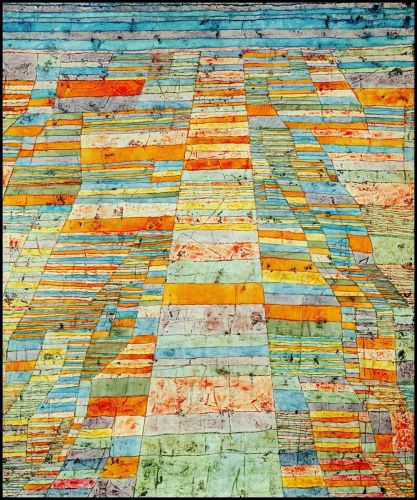Des inégalités sociales-numériques – Propositions pour une approche dispositionnaliste des usages de l’informatique connectée au sein des classes populaires
Le présent article propose une perspective singulière visant à mettre en regard usages de l’informatique connectée[1] et inégalités sociales. Cette jonction recouvre partiellement ce que la littérature scientifique identifie généralement comme relevant de « problématiques » dites de la « fracture » ou du « fossé numérique » (digital divide – Chandler et Munday, 2011). L’approche que nous proposons s’en détache toutefois nettement, notamment parce qu’une majorité des travaux conduits en ce domaine souffre, paradoxalement, d’une carence évidente dans la théorisation des inégalités sociales (van Dijk 2005). Dans la plupart des cas, quand ladite fracture numérique est thématisée comme relevant d’inégalité(s), c’est au nom des valeurs et des exigences pratiques dictées par le nouvel esprit et les nouvelles structures du capitalisme (Boltanski et Chiapello, 1999) : mondialisation et financiarisation des économies, recul des logiques de Welfare, dérégulation des marchés du travail, privatisation de la protection sociale, etc. ; le tout porté par une informatisation et une connectivité accrue des marchés, des entreprises et des consommateurs. Dans ce contexte, les technologies numériques d’information et de communication (TNIC), et au premier chef l’informatique connectée, pourvoient aux nécessités de la production, de la circulation et de la consommation (connectivité, mobilité, fluidité, etc.) et sont censées, par là même, apporter concorde et justice sociales.
Aussi, la fracture numérique est-elle fréquemment présentée comme l’un des nouveaux risques de la « modernité tardive », susceptible de rompre l’égalité des chances, de heurter les destins personnels et de provoquer entraves aux libertés et aux initiatives individuelles. Pourtant, les inégalités liées à l’usage de l’informatique connectée ne sont pas franchement inédites (i.e. de nature numérique), mais l’expression, dans le domaine des TNIC, d’inégalités sociales largement antérieures à l’expansion de la télématique (Golding, 2017). Aussi, nous semble-t-il plus censé de les saisir plutôt comme des conséquences[2](Yates et al., 2020) que de les envisager comme les causes de nouvelles formes de « pauvreté » (Lagrange, 2006), bien que certains chercheurs insistent sur le fait que les inégalités sociales produisent des différentiels d’usage qui font également retour sur celles-ci et les renforcent (van Dijk, 2020) en ce qu’ils amenuisent sensiblement la capacité de celles et ceux qui sont socialement, économiquement et culturellement les moins doté.e.s, à participer à une société de plus en plus technologisée (Ragnedda, 2017).
La proposition que nous déployons infra vise donc à renouveler, pour partie, la manière dont les « inégalités numériques » sont la plupart du temps saisies sous le label « fracture numérique » quelle qu’en soit par ailleurs la sophistication. Le déplacement que nous nous proposons d’opérer tient dans l’appréhension des pratiques télématiques comme relevant de dispositions qui en définissent non pas tant les aspects morphologiques que les actualisations concrètes.
De la fracture numérique
La notion de « fossé numérique » émerge dans un premier temps aux États-Unis, dans les années 1980, pour décrire les inégalités d’accès aux ordinateurs personnels (Compaine, 2001). Notion dans un premier temps confidentielle, elle gagne en visibilité au mitan des années 1990, notamment sous la plume des rapporteurs de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) de l’USDepartment of Commerce, Economics and Statistics. Le syntagme « digital divide » devient, alors, la catégorie descriptive consacrée pour rendre compte des forts écarts constatés dans les taux d’équipement et d’utilisation de l’informatique connectée entre les publics économiquement et scolairement les mieux dotés (information haves), et les populations les moins favorisées au regard de ces mêmes critères. Les rapports de la NTIA mettent en lumière les différences d’accès (à l’ordinateur et à Internet) selon des critères socio-économiques. En France, comme dans les autres pays membres de l’Union européenne, l’expression « fracture numérique » est également employée afin de décrire le déficit de pratiques numériques de certains groupes sociaux, que l’on envisage, conformément à un certain air du temps, comme de nouvelles formes d’exclusion. L’« e-exclusion » devient alors le nouvel épouvantail de la décohésion. Largement conduites par une recherche administrée (administrations et institutions d’État, fondations, associations et autres think tanks), les enquêtes menées sur le sujet s’appuient sur un utilitarisme dont l’impératif opératoire tient lieu de nouvel arbitre social. Pour l’essentiel quantitatives, elles montrent, sans surprise, que les critères discriminants quant à l’accès et à l’usage aux/des TNIC relèvent structurellement de variables diverses (a digital inequality stack – Robinson, 2020a) telles que la profession exercée, le rang de certification scolaire (Clark et Gorski, 2002), le niveau des revenus (Zillien et Hargittai, 2009), l’âge (Net generation – Hargittai, 2010), l’origine ethnique (Fairlie, 2004), ou encore la taille de l’agglomération fréquentée (Acharya, 2017).
Pour autant, la fracture numérique semble ne devoir se conjuguer qu’au singulier ; réduction symptomatique de la difficulté – voire du manque patent de volonté – à penser précisément la nature sociale des inégalités relevées (de quoi sont-elles le nom ?). Si l’on constate que la fracture numérique se distribue sur une série de clivages socialement déterminés (Witte et Mannon, 2010), cette variabilité des déterminants – dont on oublie, au passage, qu’ils font système – tend à être occultée pour ne considérer que ce qu’elle révèle, c’est-à-dire une complication provisoire (digital delay) quant aux processus de diffusion et d’adoption de l’informatique connectée que le marché (notamment par une extension de la concurrence et un abaissement des coûts – trickle-down principle) et les politiques publiques (qui le complètent sans s’y substituer)auront, pense-t-on, taux de pénétration à l’appui, tôt fait d’amplifier (standardization approach –Tondeur et al., 2011 ; Ragnedda, 2019). De facto, dès la fin des années 1990, les niveaux d’équipement et de consommation n’auront de cesse de croître (Thierer, 2000). Même si des écarts persistent quant aux taux d’équipement, les évolutions statistiques sont utilisées pour valider l’hypothèse grossière d’une forme de moyennisation de la « société digitale » et de son corrolaire : la nécessaire lutte contre l’exclusion numérique. À mesure que la diffusion des TNIC s’élargirait, leur possesssion viendrait à ne plus constituer un signe d’appartenance sociale et de cet affaiblissement des régimes de rareté, d’aucuns en déduisent, avec empressement et depuis une logique spécieuse, un affaissement des appartenances de classe (tandis que d’autres alertent, a contrario, sur l’émergence d’une « digital underclass » – Helsper et Reisdorf, 2017). Le numérique serait ainsi le parangon des dynamiques consommatoires, lesquelles seraient elles-mêmes un indicateur d’arasement de la diversité des positions sociales.
Différents niveaux de fracture numérique
Les premières enquêtes menées au titre de la fracture numérique mettent donc en lumière des « disparités numériques » imputées à des carences dans l’aménagement des territoires (Strover, 1999), dans l’équipement des ménages ou celui des institutions étatiques (Beauchamps, 2009). Elles postulent une forme d’égalitarisme spécifique (selon la formule de James Tobin) techno-solutionniste essentiellement vigilant quant à la répartition des infrastructures, des équipements et des services numériques. Celui-ci entend souligner combien certaines privations matérielles empêchent la participation à un destin commun dont on nous assène qu’il passe fatalement par le développement des usages des TNIC et de l’informatique connectée. S’intéresser à la fracture numérique s’est donc d’abord traduit par une attention portée aux inégalités d’accès (Novak et Hoffman, 1998) et de distribution des ressources numériques, mettant en regard celles et ceux qui sont équipé.e.s à celles et ceux qui ne le sont pas (ou le sont partiellement).
Une large partie des recherches menées sur la « fracture Nord/Sud » (et Ouest/Est – Ragnedda et Gladkova, 2020) ou l’évaluation générale des pratiques numériques des populations à une échelle nationale ou régionale (Chen et Wellman, 2003) relève de cette catégorie d’études. Ces dernières fournissent des éléments de cadrage commodes pour saisir les phénomènes de concentration de l’accès à l’informatique et à Internet, mais n’envisagent celui-ci qu’au travers de chiffres apportés par des taux de couverture, de pénétration ou d’équipement. Autant de critères dont le mérite est, certes, de proposer une vue d’ensemble des lignes de fracture qui ressortissent du technical access (first-level digital divide), mais dont la force explicative reste tout à fait partielle et mâtinée des travers classiques caractérisant les approches diffusionnistes. Toutefois, les travaux les plus récents montrent que, malgré la disponibilité accrue des TNIC et la réduction de leur prix, des écarts notables subsistent dans les taux d’équipement, les répertoires d’usage et les bénéfices qui en sont tirés (van Deursen et van Dijk, 2019). Des recherches récentes soulignent également que les dispositifs par le biais desquels les individus se connectent à Internet ont une influence sur les pratiques concrètes. Les smartphones (Nova, 2020) et les tablettes tendent, notamment pour de raisons ergonomiques, à brider certains usages (Muphy et al., 2016), tout en soulignant que les appareils les moins performants sont aussi ceux qui sont les plus mobilisés par les populations les moins armées vis-à-vis de l’informatique connectée (« mobile underclass » ; « second class netizen » – Napoli et Obar, 2017). Le lieu de connexion joue également sa part dans la configuration des usages, en termes de qualité du débit et de types de services et d’applications rendus, par là même, plus malcommodes à utiliser (Hassani, 2006).
S’agissant du cas de la France et toutes choses égales par ailleurs, il appert que le fait d’être jeune, diplômé de l’enseignement supérieur ou cadre favorise par exemple l’utilisation d’Internet. En 2005, on constate, ainsi, quatre fois plus d’utilisateurs chez les individus possédant un niveau de diplôme supérieur au baccalauréat (89 %) que parmi les peu/pas-diplômés (23 %). Et Régis Bigot (2006) de souligner que 75 % des cadres supérieurs disposent d’une connexion Internet à domicile, contre seulement 24 % des ouvriers, 15 % des retraités et 13 % des peu/pas-diplômés. Tous les individus n’ont donc pas accès (et de la même manière) aux dispositifs télématiques, tant s’en faut. Si, aujourd’hui, la part des utilisateurs d’Internet au cours des trois derniers mois atteint 82 % (65 % en 2009), il reste que 15 % des personnes de 15 ans ou plus ne l’ont pas utilisé au cours de l’année. Les individus les plus âgées (53 % des 75 ans et plus), les moins diplômés (34 % des sans diplôme ou titulaires d’un certificat d’études primaires), ceux qui disposent de revenus modestes (16 % de ceux issus d’un ménage du premier quintile de niveau de vie ; les chômeurs et les inactifs), qui vivent seuls ou en couple et sans enfant, ou résidant dans les DOM sont distinctement les plus touchés par le défaut d’équipement, ainsi que par le manque de compétences. 38 % des usagers de TNIC (seulement 2 % des internautes) affirment par exemple manquer d’au moins une compétence quant à la recherche d’information, les pratiques communicationnelles, l’utilisation de logiciels ou la résolution de problèmes techniques (Legleye, Rolland, 2019). Anne-Sophie Cousteaux (2019) révèle, ainsi, que 19 % des Français de 15 ans et plus n’ont aucune « capacité numérique » (71 % des 75 ans et plus, moins de 5 % des moins de 45 ans), tandis que 27 % disposent de compétences très élémentaires et, parmi eux, 55 % des jeunes de 15 à 29 ans – lesquels se distinguent également par un usage deux fois plus important des réseaux sociaux numériques et des services audiovisuels que dans l’ensemble de la population.
Ces approches s’intéressent donc plus particulièrement à celles et ceux qu’elles nomment tour à tour « e-exclus», « faibles usagers » ou « publics éloignés », dans la mesure où elles s’attachent à mesurer les processus de diffusion (mais aussià identifier les supposés besoins des futurs utilisateurs, ainsi que les freins à l’adoption), lesquels restent appréhendés comme des indicateurs pertinents d’usage ; amalgame abusif dénoncé comme tel par la recherche la plus sérieuse, conduisant par exemple les quantitativistes à amender leurs questionnaires pour s’intéresser davantage aux « compétences numériques » (van Dijk, 2013). Le penchant diffusionniste a, en effet, été soumis à de sévères critiques, notamment au sein des travaux appartenant au courant dit du social accesset, en particulier, émanant de chercheurs souhaitant souligner l’existence d’un autre type de fracture qu’ils qualifient « de second degré » (second-level digital divide– Hargittai, 2002 ; Ragnedda et Muschert, 2013). L’approche de la fracture numérique au second degré (usage gap) entend s’intéresser aux pratiques, en rendant compte d’inégalités quant aux motivations, ainsi que dans la distribution et la maîtrise de compétences, de savoirs et de savoir-faire s’agissant des pratiques numériques effectives (van Deursen et van Dijk, 2014), ou encore quant au rôle que joue le réseau relationnel comme ressource assistancielle (Yardi, 2010). Au fil du temps, la vision basiquement infrastructurelle, principalement focalisée sur des problèmes d’accès aux équipements et aux services s’est donc enrichie d’approches nettement plus attentives aux identités sociales des utilisateurs, aux processus d’appropriation et aux inégalités d’usage : « la question clé n’est plus celle de l’accès inégal aux ordinateurs, mais bien celle des modalités inégales d’usage des ordinateurs » (Warschauer, 2003 : 46). Dans cette perspective, le comblement de la fracture numérique est alors souvent envisagé sous l’angle d’un effort continu de formation à produire, afin de lutter contre l’illectronisme (illettrisme numérique – Correa, 2010) et la distribution socialement inégale d’une forme spécifique de capital qui engendrerait des disparités quant aux pratiques effectives et aux expériences des utilisateurs (Hilbert et al., 2010).
Les problématiques développées sous l’angle du social access interrogent par exemple les conditions de pérennisation des pratiques, s’intéressent à des catégories d’usagers tels que les primo-accédants dont les pratiques télématiques sont extrêmement récentes (Lelong 2002) ou les abandonnistes (Wyatt, 1999), c’est-à-dire les personnes qui, après utilisation, renoncent in fine à se servir de certaines TNIC. Elles envisagent, plus largement, les inégalités numériques comme la traduction d’inégalités sociales susceptibles d’avoir quelque conséquence sur des domaines aussi divers que l’entrepreneuriat, la participation politique, la santé, l’éducation, etc. (Sparks, 2013). Jan van Dijk (2005) estime que les usages du numériques sont d’abord indexés aux « vieilles » inégalités sociales, mais aussi que les TNIC sont susceptibles d’intensifier ces inégalités (Ragnedda et Mutsvairo, 2018), et même que de nouvelles inégalités se font jour (van Dijk, 2020). Les investigations menées selon des procédures d’enquête nettement plus qualitatives permettent de prendre en considération la diversité et la nature des répertoires d’usage mobilisés par les usagers et de repositionner ceux-ci dans les contextes sociaux qui sont les leurs, tenant compte d’éléments aussi divers que le capital social (Warschauer, 2003), l’évolution des modes de vie (Rice et Katz, 2003), les configurations familiales (Pasquier, 2018), ou encore le savoir-faire technique (Le Douarin et Lelong, 2009). Ernest Wilson (2006) identifient, par exemple, huit topiques (quatre pour van Dijk – 2005) où s’actualisent possiblement différents type d’inégalité, qu’il envisage comme autant de différentiels d’accèsau numérique (technique, financier, cognitif, productif, interactionnel, etc.), considérant ainsi, sur un même plan (celui de la capacité à atteindre des espaces de potentialités a priori éloignés) des domaines qui sont de nature différente, mais tous soumis à des variables communes, liées aux revenus, au genre, à l’éducation, à l’emploi occupé, au lieu de vie et à l’appartenance ethnique. Paul DiMaggio et Eszter Hargittai (2002) considèrent pour leur part d’autres dimensions, insistant sur l’autonomie des utilisateurs et la variété des usages. Au travers de ces divers modèles d’analyse, ce sont les parcours d’apprentissage, les processus d’acquisition de la maîtrise technique et la stabilisation des pratiques qui sont alors analysés au regard des milieux sociaux considérés, dont on estime logiquement qu’ils affectent, sous différents aspects, les formats de la pratique et, de manière plus globale, la « pleine participation » à la société.
Contrairement aux recherches de type « technical access », ce sont donc les usages des dispositifs techniques, ainsi que les utilisateurs, leurs places dans l’espace social, leurs situations concrètes de vie et les environnements qui structurent leur quotidienneté qui, dans l’approche dite du « social access », sont replacés au cœur de l’analyse (Min, 2010). La prise en compte de ces variables rend alors possible la mise en lumière d’une segmentation sociale des usages bien plus précise. Elle révèle un certain nombre de dissemblances dans l’utilisation des TNIC tenant à leur appartenance communautaire ou nationale (Tsatsou, 2010), leur implantation géographique (urbaine/rurale), aux rôles sexués ou à la position familiale que les usagers occupent dans leur groupe domestique, à l’économie morale du ménage (Wyatt, 2010), à la structure et au volume des capitaux, ou encore au rapport à l’écrit (van Dijk, 2013 ; Park, 2017). L’apport principal de ces sociologies tient à ce qu’elles rompent nettement avec le technodéterminisme suggèrant un passage naturel des ressources aux bénéfices tirés de leur mobilisation. En ressaisissant les pratiques numériques au regard des pratiques sociales ordinaires des utilisateurs et en restituant celles-ci vis-à-vis de leurs rationalités situées, elles ont apporté une complexité qui manquait cruellement aux premières enquêtes.
L’attention portée aux usages va alimenter une nouvelle génération de travaux qui vont s’intéresser davantage au rôle que jouent « les ressources numériques dans la détermination du champ des possibilités ou libertés ouvertes aux individus » (Beauchamps, 2009 : 109) et réinterroger les liens entre compétences numériques, usages d’Internet et débouchés hors ligne (van Deursen et Helsper, 2015). Dans la recherche anglo-saxonne, cette préoccupation a pu être désignée sous le syntagme de fracture numérique de troisième niveau (third-level digital divide – Ragnedda et Ruiu, 2019). Massimo Ragnedda lui a consacré un ouvrage (2017) où il définit celle-ci comme relevant certes d’inégalités quant à l’accès et aux usages de l’informatique connectée, mais estime surtout devoir lui adjoindre une attention aux capacités différenciées d’exploitation des opportunités ouvertes par ces usages. Les intérêts de connaissance sont orientés sur les profits (culturels, économiques, sociaux, politiques, etc. – tangible outcomes) qui peuvent être concrètement tirés des pratiques de l’informatique connectée, ainsi que sur les diverses manières dont ils sont susceptibles de pondérer ou de renforcer les inégalités sociales, non sans verser parfois dans certaines formes de naïveté.
Dès 2004, Paul DiMaggio et ses collaborateurs se posaient déjà la question de savoir si l’usage d’Internet permettait ou non de multiplier les opportunités d’amélioration de la vie courante et une série de recherches furent alors conduites dans cette optique, portant sur le marché du travail (Kuhn et Mansour, 2014), l’information politique, l’engagement civique (Son, Lin, 2008), les sociabilités (Muscanell et Guadagno, 2012), les opportunités marchandes (Bhatnagar et Ghose, 2004) ou encore dans le domaine de la santé (Khilnaniet al., 2020) ou de l’éducation (Robinson et Schulz, 2013). Elles montrent qu’il est en effet possible d’identifier des liens entre l’usage d’Internet et la probabilité de disposer d’occasions profitables. Internet est décrit comme pourvoyeur de certaines formes de bien-être, en permettant, par exemple, de lutter contre la solitude et la dépression (notamment chez les personnes âgées – Chopik, 2016), de faciliter le soutien moral (Helsper et van Deursen, 2017) ou encore de renforcer le sentiment d’auto-efficacité ou d’estime de soi (Francis et al., 2018). Mais d’autres enquêtes (Huang et al., 2015) soulignent aussi que les usages de l’informatique connectée sont loin d’être tous capacitants. Le numérique est un domaine depuis lequel se peut se développer des logiques de distinction (pour celles et ceux qui en ont la maîtrise), mais également naître des sentiments de honte ou d’infériorité. Les jeunes manquant de ressources numériques peuvent, par exemple, être victimes de stigmatisation ou d’isolement (Robinson, 2020b).
Surtout, la fréquence et l’intensité de ces bénéfices s’avèrent, en chacun de ces domaines, nettement corrélée aux conditions concrètes d’existences qui déterminent leur appropriation par celles et ceux qui peuvent/pourraient en jouir (van Deursen et Helsper, 2015). Par exemple, Emilie Renahy et ses collègues soulignent que « les gens qui auraient le plus besoin d’Internet pour s’informer sur des aspects ayant trait à la santé – pour compenser un manque d’information ou une sortie du système de soins (difficultés économiques, isolement social, problèmes de santé) – sont, de facto, ceux qui l’utilisent le moins » (2008 : 9). De nombreux autres travaux (Zillien, et Hargittai, 2009 ; van Deursen et van Dijk, 2014, etc.) insistent ainsi, sur le fait que les « applications les plus sérieuses » de l’informatique connectée restent globalement l’apanage des catégories sociales les plus socialement et culturellement favorisées, lesquelles savent plus aisément en tirer avantages sur les plans professionnels, éducatifs et citoyens que les usagers les plus populaires qui privilégient les usages ludiques, consommatoires et de babillage (van Deursen et al., 2014 ; Beauchamps, 2009). Laura Robinson (2009) a par exemple montré que les adolescents américains issus de classes socialement défavorisées font un usage d’Internet nettement moins orienté sur le travail scolaire que leurs pairs socialement plus aisés et davantage marqué par des difficultés liées à la recherche, à l’évaluation et à la hiérarchisation des informations trouvées en ligne. Plus ces usages s’ancrent concrètement dans la pratique, plus la capacité à envisager d’autres formes du faire télématique s’amenuise, tandis que chez celles et ceux de ces adolescents qui développent des pratiques plus « sérieuses » se développent une forme d’assurance qui les amènent à se représenter comme (plus) compétents (capital enhancing activities – Hargittai et Hinnant, 2008) et s’ouvrent également, offline, des chances de conversion de leurs habiletés numériques plus importantes. La plupart de ces travaux (Ragnedda 2017 ; Robinson et al., 2015, etc.) s’accorde pour mettre au jour que les inégalités sociales cadrent largement les pratiques numériques qui, globalement, sauf exception, ne s’avèrent pas en mesure de contrecarrer les injustices sociales et décrivent même un nouveau champ d’application de celles-ci (Kvasny et Keil 2006).
De la fracture numérique aux inégalités sociales-numériques
Le syntagme « fracture numérique » apparaît donc comme une commodité langagière permettant la désignation d’un ensemble d’inégalités. Pour autant que celles-ci se traduisent dans le domaine des pratiques du numérique, elles n’en restent pas moins des inégalités sociales (Fuchs, 2009). Dès lors, il ne s’agit plus de circonscrire les réponses différenciées du corps social à une norme sociétale qui tendrait à s’imposer à tou.te.s du fait de l’évolution de la sphère technocommerciale (faire usage des TNIC est une nécessité dans la « société du savoir », mais cet impératif n’est pas suivi par tou.te.s). Il n’est pas non plus de montrer que ces nouvelles règles comportementales sont l’objet d’une négociation complexe et permanente de la part de chaque individu (la diffusion des TNIC relève d’un mouvement de fond, mais il y a une individualisation des pratiques), que celui-ci participe « librement » de leur établissement ou qu’il soit, a contrario, contraint d’y adhérer. Ce que le caractère social des inégalités numériques nous invite à entreprendre, c’est à rapporter celles-ci à des processus générateurs historiquement et socialement construits. Et si, comme nous l’avons vu, les problématiques ont évolué dans le sens d’une meilleure prise en compte des complexités d’usage et de leurs liens avec les conditions concrètes d’existence des utilisateurs, il n’en reste pas moins vrai que les inégalités face au numérique ne concernent pas uniquement l’accès, les compétences et les bénéfices tirés de l’usage : « Bien qu’il existe une chaîne logique simple et compréhensible allant de l’accès via les compétences aux résultats, il s’agit d’un modèle intégré dans une vision très ‘‘technologique’’, centrée sur un utilisateur individuel des systèmes et des médias numériques » (Yates et al., 2020). Aussi, d’autres travaux, plus rares, ont porté leur attention sur les usages de l’informatique connectée sous l’angle des rapports sociaux et de leur intersectionnalité (de classe, de race, de genre – e.g. Noble et Tynes, 2016 ; Yates et Lockley, 2018 ; Reisdorf et Rhinesmith, 2018 ;Yates et al., 2020, etc.).
Il ont notamment montré que nombre des propositions s’agissant du comblement du prétendu « fossé numérique » oscille entre le principe de maximin, c’est-à-dire de maximisation des bénéfices attendus – en l’occurrence des usages minimaux requis pour une « bonne » insertion dans la société – et celui d’un stricte utilitarisme. Les questionnements posés sur un plan pratique quant à la manière la plus efficace de satisfaire à la résorption de cette « nouvelle fracture » évincent l’interrogation sur la nécessité même de ces actions. On peut pourtant se demander si les mesures dédiées, quels que soient les moyens mis en œuvre, contribuent réellement à l’amélioration des conditions de vie des plus défavorisés (i.e. à une égalisation même partielle de celles-ci et à davantage de justice sociale), ou bien si elles ne constituent, in fine, qu’une manière de maxi(mini)miser l’utilité capitaliste de l’informatique connectée dont les usages doivent être les plus larges possible ? Aussi peut-on penser que certaines des initiatives prises pour lutter contre la fracture numérique sont à l’image de celles qui visent aujourd’hui à « s’attaquer » plus généralement aux inégalités et aux exclusions sociales. Leur mise en œuvre effective ne profite guère ou fort mal aux publics les plus directement ciblés, tout en assurant leur participation renouvelée à la société qui a généré la situation inégalitaire dans laquelle ils se trouvent. La logique est alors de « favoriser l’inclusion », mais sans pour autant avoir comme horizon d’attente une forme d’égalitarisme social. Nous sommes, la plupart du temps, en présence de processus intégrateurs visant à laisser croire que les usagers de l’informatique connectée auraient donc une réelle chance d’améliorer leurs conditions d’existence du fait de leurs pratiques des TNIC, alors que les usages qu’ils en développent sont surtout susceptibles de contribuer, d’une nouvelle manière, au maintien du monde tel qu’il va, lequel est, répétons-le, la cause de leur situation sociale défavorable.
Pasquier (2018) rend compte, par exemple, d’un enquêté – homme à tout faire dans un hôpital où son épouse travaille comme femme de ménage – qui, habitué des brocantes et des vide-greniers, a trouvé sur Internet de quoi vendre ce qu’il chine au meilleur prix. Il s’y informe également, affine son expertise, apprend à valoriser sa marchandise, à entretenir sa clientèle, à renforcer les liens les plus lucratifs avec certains acheteurs étrangers (sans pouvoir ni n’avoir besoin de s’exprimer en anglais), etc. Au point que les vacances d’été de sa famille sont entièrement financées par les gains réalisés en ligne. Indéniablement, Internet a permis a ce couple (et ses trois enfants) d’arrondir ses fins de mois et d’étendre le réel plaisir qu’il retire de ces activités de négoce, notamment de pièces de maroquinerie de luxe. Pour autant, faut-il considérer qu’il s’agit, là, d’une pratique émancipatrice ? La recherche de bonnes affaires permet-elle à cette famille de s’arracher aux conditions concrètes d’existence qui sont les siennes et qui la fixent dans une modestie sociale, économique et culturelle ? La réponse ne peut être que nuancée. Des bénéfices concrets sont retirés de leur pratique de l’informatique connectée (plaisir, estime de soi, complément de revenus), mais ces bonis relèvent d’une amélioration de l’ordinaire sans pouvoir foncièrement modifier la nature de ce dernier et des contraintes qui le constituent. La facilitation par le numérique peut aussi conduire, comme le suggère Pierre Beckouche, au développement d’une « ‘‘France du bon coin’’ qui consisterait à fournir des services divers opérés de manière occasionnelle par des actifs ayant de statuts du type auto-entrepreneur ou précaires, ce qui peut conduire à un low cost à la fois dans la qualité de la prestation et dans la couverture sociale des actifs » (2017 : 160). Un autre exemple que Pasquier met en avant illustre plus encore ce processus contradictoire d’amélioration-déterrioration : une femme dont l’activité principale est de confectionner des bijoux, n’arrive pas à en vivre. Elle décide alors de s’intéresser aux médecines naturelles auxquelles elle s’acculture exclusivement par Internet et, finalement, se réinvente dans le métier de lithothérapeute (2018 : 54). On peut y voir une reconversion professionnelle épanouissante, un accomplissement de soi, un développement de compétences liées au caredans une logique d’empowerment, mais on peut aussi y déceler un certain opportunisme conduisant à la vente de prestations approximatives via la construction de relations marchandes par l’appariemment facilité d’une offre rare avec un public singulier. Ces possibles actualisés grâce aux TNIC sont-ils réellement sources d’épanouissement et de mieux-être ?
Internet favorise sans doute quelque profit à la marge, mais entre les mains de certains, il ne semble rendre possible que de menus ajustements dont on pourrait penser qu’ils agrémentent concrètement les capabilités, mais sans les élargir véritablement. Pierre Bourdieu insiste sur le fait que le rapport entretenu aux choses « enferme la référence tacite au système des possibilités et des impossibilités objectives qui définit et cette condition et les conduites compatibles ou incompatibles avec le donné objectif auquel [les individus entretant ce rapport aux choses] se sentent mesurés » (1965a : 35). Il nous semble que le « rapport au numérique » – imaginé et pratique – n’échappe pas à cette règle et se présente comme le précipité de situations objectives qui font de l’informatique connectée un « objet » comme un autre en ce qu’il peut être diversement apprécié et mobilisé, mais qui déterminent aussi cette variabilité.
Les mesures « de rattrapage » que ces exemples illustrent répondent à une logique qui s’approche de celle de la satisfaction des « besoins fondamentaux » d’une société néolibérale qui serait fondée sur la participation, le savoir, l’information et la communication : donner à chacun lesmoyenstechnologiques lui permettant de s’inscrire dans de nouveaux espaces de pratiques, en esquivant au passage une réflexion sur les utilités conférées à ces espaces, qui ne sont ni naturelles, ni mobilisables par tou.te.s. L’arrière-plan moral de ces visions pratiques est celui de l’« égalité des chances », c’est-à-dire de la volonté d’une égalité d’accès (technique ou social) aux dispositifs télématiques, faisant l’impasse sur les possibilités concrètes de conversion des virtualités techniques en bien-être et en liberté (Sen, 2000 – i.e. une certaine qualité d’existence), lesquelles ne tiennent pas seulement à des capabilités numériques. L’insistance est portée sur les (in)accomplissements effectifs (l’étendue des profits), plutôt que sur la possibilité réelle de s’accomplir. Le principium de ce pragmatisme tient donc à la nécessité d’être équipé d’un ordinateur (d’une tablette ou d’un smartphone) connecté à Internet, car il est considéré qu’il s’agit, là, d’une assurance minimale si l’on veut avoir, au sein de cette société fortement technologisée, des chances équivalentes à d’autres « concurrents ». Or comme le rappelle Geneviève Koubi, l’égalité des chances, quel que soit son domaine d’application, entérine les inégalités sociales : « l’appréhension des inégalités à travers l’égalité des chances signale la qualité de l’effort attendu ou fourni par les individus pour ne pas être en situation de vulnérabilité ». Et d’ajouter : « la chance [n’]est [seulement qu’]une ouverture sur […] la possibilité d’obtenir » (2003 : 125).
S’équiper équivaut de fait à une promesse qui ne donne pas un accès direct à des biens ou avantages concrets, mais seulement à lapossibilité d’accéder à ces derniers, possibilité qui est indexée à la réalité des dispositions, des goûts et des sens pratiques de chacun (i.e. d’un probable économiquement, socialement et culturellement cadré). Autrement dit, les pratiques de l’informatique connectée ne peuvent se résumer à des manipulations de contenus, d’objets et d’interfaces, car elles sont le produit d’un rapport à la pratique socialement constitué dans un style de vie, résultat d’un ajustement social cadré par des valeurs, des croyances, des représentations, un ethos, etc. Pour ceux qui ne disposent pas des penchants et appétences nécessaires à l’exploitation de cette « chance qui leur est offerte », les potentiels de l’informatique connectée ne peuvent, en réalité, s’actualiser en de réels avantages. Et Dominique Pasquier de rappeler, à propos de son enquête sur l’usage de l’informatique connectée au sein des familles rurales modestes : « Les gens que j’ai vus ne sortent pas de leur monde, sauf en ce qui concerne les connaissances, mais pas en matière de culture ni de sociabilité. Ils utilisent internet pour apprendre des choses qu’ils ne connaissent pas ou perfectionner des pratiques, comme le tricot, la cuisine, le jardinage… Mais ce n’est pas une ouverture sur des nouveaux goûts culturels » (in Guillaud, 2018).
Aussi parlerons-nous désormais d’inégalités sociales-numériques (Halford et Savage, 2010) plutôt que de « fracture numérique » (fut-elle de « troisième degré ») et proposons, de surcroît, d’envisager celles-ci comme s’insérant au sein de rapports sociaux de classe, à revers de la situation paradoxale notamment pointée par François Dubet : « Au moment où les inégalités se développent, la vision de la société à travers le régime des classes tend à s’estomper » (2014 : 9). Attentif aux positions occupées par les sujets sociaux dans les rapports de production, ainsi qu’à l’ensemble des conséquences qui en découlent, il nous semble en effet utile de porter attention à leur complexité dispositionnelle, laquelle ne saurait être rabattue sur un ethos de classehomogène supposé tout-puissant (i.e. faisant de nécessité vertu) et induisant une détermination identique pour tous les membres des classes populaires. Des travaux menés aux États-Unis montrent, par exemple, des différences notables d’usages et de gains obtenus entre les groupes africains-américains, hispaniques et blancs (Brown et al., 2016).
Il nous « appartient en effet de construire le système de relations qui englobe et le sens objectif des conduites organisées selon des régularités mesurables, et les rapports singuliers que les sujets entretiennent avec les conditions objectives de leur existence et avec le sens objectif de leurs conduites, sens qui les possède parce qu’ils en sont dépossédés » (Bourdieu, 1965b : 20). Ce système relationnel objectif-subjectif, il nous semble utile de l’envisager en ayant recours au concept de dispositions soulignant, par là, que les relations objectives sont cadrées par des rapports sociaux qui structurent des contextes, des situations, mais aussi des schèmes intériorisés, ajustés à ces conditions extérieures objectives. Les classes et les dispositions dessinent le « lieu géométrique » des déterminations sociales, « des probabilités calculables et des espérances vécues, de l’avenir objectif et du projet subjectif » (Bourdieu, 1965b : 22). Dans cette perspective qui permet « de ne pas réduire l’étude des inégalités à une lecture verticale et graduelle comme l’impliquent les échelles de revenus ou de patrimoine » (Hugrée et al., 2017 : 20), s’intéresser aux usages de l’informatique connectée par les classes populaires, c’est s’appuyer sur un principe de vision et de division du monde social permettant de saisir les rapports que lesdites classes populaires entretiennent avec leurs conditions réelles d’existence, lesquelles nous semble donc pouvoir se révéler par l’observation des pratiques numériques, sans pour autant considérer qu’il existe une homologie stricte entre positions dans l’espace social et usages de l’informatique connectée. Il s’agit alors de prêter attention aux normes variées et intériorisées d’appropriation, d’usage et de consommation du numérique et à ce qu’elles révèlent des classes populaires. Et de considérer la manière dont celles-ci configurent concrètement les pratiques de l’informatique connectée au regard des contraintes et des possibilités liées aux conditions sociales de travail et d’existence des utilisateurs.
Dispositionnalisme et inégalités sociales-numériques
Nous proposons de saisir les usages de l’informatique connectée comme des comportements de classe qui doivent, pour une large part, leurs caractéristiques au poids du passé incorporé. Nous envisageons, ainsi, le rapport aux TNIC comme médié par des appartenances de classe qui ne sauraient être restreintes à une homogénéité sociale de condition, laquelle se voit modulée par des types différenciés d’expérience et de parcours biographiques (intégration professionnelle, insertion conjugale, etc.). Tout en faisant fond sur une approche classiste (Fuchs, Mosco, 2012), il s’agit donc, aussi, de traquer l’hétérogénéité individuelle des pratiques, des manières d’être et de faire, d’envisager leur diversité et de se questionner quant à ce qu’elles engagent de la socialisation de celles et ceux qui les déploient. Notre ambition n’est donc pas tant de repérer ce qui pourrait s’apparenter à une culture numérique populaire (de fortes régularités d’usage – une unité, une affinité de style décrivant donc une économie des pratiques numériques spécifiquement populaire) que de considérer la structure des pratiques télématiques dans une perspective sensible à la pluralité des schémas d’expériences incorporées par les usagers qui, fussent-ils hétéroclites, restent néanmoins le produit de transferts de penchants de classe au domaine technologique. Aussi, les différents régimes d’usages observables se présentent comme des traductions praxéologiques de rapports sociaux, etles inégalités sociales-numériques comme les conditions concrètes rendant difficiles, pour les classes populaires, l’acquisition de capa/cités/bilités compétencielles (i.e. répondant aux exigences d’une situation par la mobilisation volontaire de savoirs et savoir-faire spécifiques) et dispositionelles[3](inclinations à agir, croire, penser, sentir, etc.) à saisir les prises positives de l’informatique connectée.
Sous ces auspices, on comprend notamment que la fracture numérique ne saurait n’être appréhendée qu’au travers de situations caractérisées par un faible niveau d’accès, de maîtrise technique ou encore des répertoires de pratiques qui se manifestent comme indigentes ou déficientes (i.e. censément nuire au bon fonctionnement numérique de l’« organisme sociétal »). Car si derrière les pratiques numériques, nous nous accordons à penser qu’il y a bien quelque chose comme des rapports sociaux de classe, cela n’équivaut pas à considérer que les usages populaires de l’informatique connectée ne se déploient que sur des régimes d’usages peu stabilisés, peu nombreux et peu sophistiqués, voire qu’ils ne sauraient témoigner d’un niveau d’habileté technique conséquent. Contrairement à ce qui est généralement avancé dans la littérature (Ragnedda et Mutsvairo, 2018 ; Robinson et al., 2015), celles et ceux qui développent des pratiques en ligne considérées comme conséquentes (digitally included), ne tirent pas automatiquement bénéfices de leurs usages ou si, tel est le cas, les profits peuvent être sensiblement distants de ce qui était initialement visé (van Deursen et Helsper, 2015). Envisager cette possibilité ne revient pas non plus à penser que ces modalités pratiques de mobilisation du numérique signent la disparition d’inégalités de capabilité.Formulé autrement : la morphologie des usages – surtout déterminée par des opérations de quantification – ne dit rien de leur fonction sociale, laquelle ne peut être arrêtée que par l’entremise d’une hypothèse susceptible de replacer les pratiques dans un ordre social qui en détermine le cadre, lequel a de grandes chances de se voir renforcé (conformation) ou, plus rarement, de se trouver déplacé (désajustement) par les pratiques qu’il co-produit. Et en faire l’hypothèse ne revient pas à verser dans le misérabilisme si l’attention est autant portée sur la manière dont les usages s’inscrivent au sein de rapports sociaux qui les structurent et les contraignent, que sur la façon dont ils s’en échappent et produisent des pratiques atypiques du point de vue de leur appartenance de classe. Mais il nous semble évident que l’inclusion numérique n’est pas synonyme à tout coup d’inclusion sociale et de vivification de la démocratie.
Tout en ayant donc le soin de prendre en compte la diversité des formats d’usages parfois frappés du coin de l’inventivité – laquelle conduit certains chercheurs à considérer tout type d’usage comme nécessairement habilitants, voire à relativiser le poids des inégalités sociales –, l’orientation de recherche que nous proposons saisit la variété de surface des usages numériques comme ne pouvant dire, seule, quelque chose des profits et des utilités sociales qui en sont tirées par celles et ceux qui les mettent en œuvre. Car, répétons-le, la compréhension des logiques d’usage et des modes différenciés d’appropriation nécessite la mise en regard de ceux-ci avec des dispositions incorporées produites par les structures objectives de la société. Précisément, l’approche dispositionnaliste permet de « passer des classes, en tant que totalités objectivées ou, si l’on veut, en tant que structures, aux comportements, aux interprétations et même aux sentiments des agents qui remplissent ces classes » (Boltanski, 2014 : 31). Les étapes de socialisation et d’apprentissage inculquent des manières de faire et des schèmes de perception (dispositions corporelles et cognitives) qui conditionnent les modes de familiarisation aux outils télématiques, l’acquisition des habiletés nécessaires (sensori-motrices et cognitives), ainsi que la place attribuée à l’utilisation des machines dans la construction de soi, des identités de genre, d’âge, de classe ou encore de métier. Les usages des TNIC dépendent ainsi de ressources sociales-culturellesinégalement distribuéesdans l’espace social, qui pèsent sur les moyens financiers et les habiletés techniques, mais aussi, plus fondamentalement, sur les accomplissements pratiques pris en tension entre le probable et le possible. Pour être pleinement analysés, ils doivent donc être appréhendés dans leur cohérence avec les conditions de production des expériences sociales des utilisateurs et les contraintes externes qui cadrent leurs investissements. Car « les agents sociaux, et aussi les choses en tant qu’elles sont appropriées par eux, donc constituées comme propriétés, sont situés en un lieu de l’espace social, lieu distinct et distinctif qui peut être caractérisé par la position qu’il occupe par rapports à d’autres lieux » (Bourdieu, 1997 : 161).
Faire sien ce principe, c’est prendre au sérieux le fait que, selon leur appartenance sociale, les utilisateurs ne saisissent pas les mêmes attributs décisifs de la télématique et ils n’en définissent ni d’identiques propriétés utiles, ni les mêmes usages effectifs. Ainsi y a-t-il une correspondance entre l’espace des pratiques numériques et l’espace des positions sociales, sans que celle-ci ne soit de l’ordre de l’uniformité. Les usages sociaux de l’informatique connectée sont liés aux représentations, envies, appréciations, intérêts, goûts et sens pratiques de ceux qui les mobilisentet se présentent comme les produits intériorisés de la socialisation passée et, notamment, de formes de domination sociale. La croyance dans la neutralité de la télématique qui ne porterait aucun rapport de classe et nivellerait les inégalités sociales, permet précisément de faire l’économie d’un certain nombre d’interrogations portant sur la diversité des publics visés, leurs caractéristiques socioculturelles, leurs compétences, leurs motivations, leurs besoins, leurs intérêts, leurs résistances et les difficultés d’appropriation qu’ils peuvent rencontrer (van Dijk, 2013).
Car l’égalité supposée devant l’outil, les informations et les connaissances auxquelles il permet d’accéder relève d’une mystification visant à dissimuler le fait que la technique est partie prenante d’un dispositif de domination. Les TNIC, tout particulièrement, sont les prothèses d’une gouvernementalité au service d’une normalisation, c’est-à-dire, de la production d’attitudes conformes aux exigences fonctionnelles de l’économieet des rapports sociaux dominants: « Chaque objet technique est la pétrification de rapports sociaux qu’il contribue à la fois à instaurer, à perpétuer et à modifier, et c’est précisément en cela qu’il est possible d’apercevoirla caractéristique sociale essentielle de la technique » (Roqueplo, 1983 : 32). Les pratiques numériques sont l’actualisation d’un ajustement complexe entre une histoire sociale incorporée (schèmes de perception et d’action des usagers) et la mobilisation d’un artefact technique (une histoire faite chose via des objets, interfaces, services, texts, etc.) qui est lui-même constitué d’une combinatoire de mondes sociaux et culturels inscrits dans des programmes d’action et des contenus qui prescrivent appropriations et réceptions. Ces inscriptions-incitations (propriétés sociales objectivées dans la technique) commandent des ajustements pratiques et façonnent aussi, à la longue, des manières d’agir, de penser ou de sentir (propriétés sociales incorporées dans les personnes) dont il est évident que certain(e)s d’entre eux/elles servent les processus de production, de circulation, de consommation et de satisfaction de besoins prescrits par la logique néolibérale, réattestant les structures de domination des sociétés capitalistes avancées. Mais d’autres peuvent potentiellement conduire, a contrario, à un désalignement des nécessités de l’intégration marchande.
Prendre les usagers populaires de l’informatique connectée comme des sujets socialement situés porteurs de capitaux différenciés plus ou moins volumineux et de dispositions singulières, c’est se donner les moyens de rendre compte des diverses jonctions possibles entre positions de classe, dispositions sociales, sensibilités, modes d’appartenance au monde et contextes sociotechniques (Morley, 2008). Saisir l’intérêt d’un dispositif ou d’un contenu, lui imputer du sens, s’en accommoder, en assurer la conversion éventuelle en gains d’autonomie et en accomplissements de « bien-être » (DiMaggio et Hargittai, 2002) sont des opérations qui, certes, s’inscrivent dans une matérialité numérique, mais dont l’ontologie sociale relève de rapport sociaux traduits, d’une part, en agencements techniques et, d’autre part, en systèmes dispositionnels qui en définissent le déploiement (background of our own social, cultural, political and personal capital – Ragnedda, 2017 ; van Dijk et al., 2014).
La mise en œuvre de l’approche dispositionnaliste
Nous proposons de mettre en œuvre une perspective dispositionnaliste qui suppose des logiques d’action largement non conscientes, des inclinations pré-réflexives. Elle n’évince pas pour autant la possibilité d’une intentionnalité consciente (i.e. une disposition réflexive fut-elle pour partie méconnaissante des rapports pratiques à la pratique) susceptible de rentrer en concurrence avec certains penchants dispositionnels, mais ne saurait seulement relever de motivations. Sous cet angle, le concept d’habitus désigne un ensemble de manières de penser, de se représenter, de sentir, de ressentir, d’agir, etc., qui, tout en étant le produit de déterminations sociales, permettent néanmoins des improvisations réglées qui peuvent être créatives. Il s’agit donc de saisir les pratiques « au croisement des propriétés sociales des acteurset despropriétés sociales des contextesdans lesquels ils inscrivent leurs actions » (Lahire, 2012 : 21). Cette « matière sociale » qui relève d’une genèse qu’il est possible de situer et de reconstruire, au moins partiellement, a pour particularité d’être actualisable car incorporée et portée par le sujet. Elle tient aux compétences pratiques (capacités à répondre aux exigences d’une situation par la mobilisation volontaire d’un savoir et un savoir-faire spécifiques) et de dispositions (inclinations à agir, croire, penser, sentir, etc.) qui, dans le cours de l’action, vont toujours à la rencontre d’une autre matérialité, celle du contexte (objets, institutions, personnes) dont l’informatique constitue aujourd’hui l’un des pans. Lahire décrit cette seconde forme de matérialité comme relevant de contraintes spécifiques (synchroniques) à chaque contexte d’action et, au sein de ce contexte, on trouve évidemment des technologies de toutes sortes. Dans une perspective diachronique, sans doute peut-on avancer qu’aux trajectoires socialesse superposent des trajectoires d’usage qui y puisent leur « raison d’être » (inscription), mais peuvent également avoir, sur elles, quelque effet balistique. Les TNIC équipent les existences, leur donnent des moyens, mais elles peuvent également, de par leur omni-présence (appropriation), devenir des cadres dispositionnels et participer (modestement – pas d’omni-potence) au maintien, au renforcement ou à l’infléchissement des caps des parcours biographiques.
Quand une partie de la littérature dédiée récente (e.g. Ragnedda et Ruiu, 2020) s’intéresse à montrer que des conditions sociales d’existence favorables et qu’un volume conséquent de différents capitaux acquis offline ne conduisent pas automatiquement à développer des répertoires d’usages permettant le maintien ou l’extension d’avantages sociaux, économiques ou culturels – insistant ainsi sur l’importance d’un « capital numérique » spécifique –, nous aurions, pour notre part, plutôt tendance à nous intéresser aux pratiques étendues et chevronnées qui n’équivalent pas nécessairement à des gains de bien-être, insistant plutôt sur l’importance, non de compétences à proprement parler numériques, mais de dispositions sociales qui cadrent leur production. Si la plupart des enquêtes s’intéresse surtout aux débouchés positifs de l’usage de l’informatique connectée, certaines ont néanmoins pointé les dommages qui lui sont parfois corrélés (negative outcomes) et ne se répartissent pas socialement de manière équivalente (Blank et Lutz, 2018). Par ailleurs, l’intérêt pour l’épaisseur sociale au principe des pratiques numériques ne détourne pas du fait que l’informatique connectée, en tant que dispositif socionumérique, décrit elle aussi un espace varié de socialisation à partir duquel peuvent se forger de nouvelles dispositions ou en « redisigner » d’anciennes et dont il faut évaluer autant que faire se peut la portée. Internet constitue, en effet, un espace social à part entière, particulièrement foisonnant, dont certains territoires peuvent évidemment être le siège de logiques de socialisation et, par là, pourvoyeurs de mises en disposition. Contexte de déploiement de pratiques et d’inégalités sociales-numériques indexées à des penchants hérités, Internet est également une source à partir de laquelle s’incorporent des inclinaisons qui redessinent et complexifient le répetoire des dispositions préalablement acquises. La chose semble par ailleurs d’autant plus importante à prendre en considération que certaines études montrent que les utilisateurs des classes populaires (et plus particulièrement les moins éduqué.e.s) passent un temps en ligne sensiblement supérieur à celui des autres classes sociales (van Dijk, 2020). L’approche dispositionnaliste a pour avantage de déplacer tout un pan de la littérature qui ne résonne qu’en termes de compétences et de savoir-faire et tend, par là même, à maintenir la saisie des inégalités davantage du côté du numérique que du social (des classes sociales) tout en évitant de considérer que les bénéfices susceptibles d’être tirés de l’usage de l’informatique connectée (to increase and improve life chances) puissent être réellement bridées. Le couplage opportunités socionumériques-capabilités sociales[4] ne relève pas d’une dialectique susceptible d’égaliser les chances, mais dépend foncièrement de déterminations de classes.
Méthodologiquement, cet intérêt pour les dispositions à un niveau individuel et pour les classes sociales à un niveau collectif, invite à déployer des appareils de preuve proches de ceux qu’ont mis en œuvre Bernard Lahire et ses étudiant.e.s dans leurs Portraits sociologiques (2002). L’objectif n’est d’enquêter sur la complexité des nombreuses variations sociales des comportements individuels, la transférabilité des dispositions, mais de mettre le cherheur en capacité de pouvoir relier le caractère collectif de l’existence des utilisateurs de l’informatique connectée à leurs dispositions individuelles, et celles-ci à des conduites instrumentées par les TNIC. La tâche est difficile et passe par la mise en place de dispositifs d’enquête qui consistent à mener auprès de personnes issues des classes populaires, des séries d’entretiens à « propos de leurs pratiques, comportements, manières de voir, de sentir, d’agir dans des domaines de pratiques (ou des sphères d’activité) différentes ou dans des micro-contextes (à l’intérieur de ces domaines de pratiques) différents » (Lahire, 2002 : 25). Les sphères familiale, professionnelle, scolaire, amicale et du loisir doivent être systématiquement passées au crible, dans l’idée de repérer la force et la nature des matrices de socialisation qui leur sont attachées (un « passé incorporé »), ainsi que l’importance des moments de bifurcation et de rupture (Bessin et al., 2009). Il s’agit de reconstituer, à travers leurs parcours biographiques, les modèles de référence auxquels les usagers ont été confrontés et auxquels ils ont emprunté. Ce bornage du répertoire des dispositions – forcément les plus manifestes – doit se coupler, de surcroît, à un repérage du commerce des enquêté.e.s avec l’informatique connectée dans une perspective à la fois diachronique (cycle de vie, biographie) et synchronique (contextes, domaines de pratiques) : « Dans ces cas, l’enquêteur n’[a] pas pour objectif de savoir si l’enquêté [met] en œuvre telle ou telle disposition définie préalablement, mais de recueillir un matériau verbal suffisamment riche pour pouvoir reconstruire a posteriorides manières de voir, de sentir et d’agir » (Lahire, 2002 : 38).
En l’espèce, le matériau oral peut être enrichi de confrontations des enquêté.e.s à certaines traces de leurs usage (e.g. posts, commentaires, « like », signets, historiques de navigation, etc.) permettant d’envisager concrètement (la matérialité de l’immatériel) les manières possibles dont les dispositions bornent les pratiques télématiques et en déterminent la portée. Les matériaux récoltés empruntent donc formellement, à la fois, à des récits de vie et des récits de pratiques numériques, double mouvement qui permet « de saisir les logiques d’action dans leur développement biographique et les configurations de rapport sociaux dans leur développement historique (reproduction et dynamiques de transformation) », mais également de considérer « qu’à travers les pratiques [numériques], on peut commencer à comprendre les contextes sociaux au sein desquels elles se sont inscrites et qu’elles contribuent à reproduire ou à transformer » (Bertaux, 1997 : 8). Plus encore, les modalités d’usage de l’informatique connectée renseignent sur les schèmes d’action qui prévalent à sa mobilisation et en déterminent la portée pratique. Il faut, ainsi, tenter de repérer certaines formes de régularité ou de disjonction dans la manière qu’ont les individus d’organiser et d’appareiller leurs manières d’être et de faire. Cette attention aux formats technologiques d’action considérés comme actualisation des dispositions entend répondre à cette ambition analytique qui pousse, d’une part, à prendre en considération les trajectoires individuelles de classe (une descente progressive de la classe aux fractions de classe et de celles-ci à l’individu) et, d’autre part, à s’intéresser aux relations que les singularités dispositionnelles[5] (« invisibles de loin » précise Lahire – 2002 : 403) entretiennent avec les pratiques numériques. Pour rendre compte de ces associations techno-dispositionnelles on peut, par exemple, choisir d’avoir recours à la forme-portrait. Cette dernière est un des moyens parmi les plus adéquats pour tenter de décrire de manière ressemblante (en accord avec le régime de véridicité des sciences sociales – une vue dépendant d’un point de vue) en cherchant à rendre explicite (présent) ce qui est absent à l’observation directe des individus et de leurs usages, caché dans les plis singuliers d’un social à la fois dispositionnel et technologique. Le portrait pictural a vocation à transcrire le caractère d’une personne, sa façon d’être, le portrait sociologique a lui aussi pour mission de traduire la singularité des histoires faites corpset de placer ce « tempérament » en regard des pratiques télématiques qui en sont les précipités, mais peuvent également en être des instances de réforme.
———————————– RÉFÉRENCES ———————————–
ACHARYA (Bahnu B.), « Conceptual evolution of the digital divide: A systematic review of the literature over a period of five years (2010-2015) », in Vartanova (Elena L.) ed., World of media, Moscou, Lomonosov Moscow State University, 2017, pp. 41-74.
BHATNAGAR (Amit), GHOSE (Sanjoy), « segmenting consumers based on the benefits and risks of internet shopping », Journal of Business Research, vol 57, n° 12, 2004, pp. 1352-1360.
BEAUCHAMPS (Margot), « L’accessibilité numérique. Transformer le risque de renforcement des inégalités numériques en opportunité », Les Cahiers du numérique, vol. 5, n° 1, 2009, pp. 101-118.
BECKOUCHE (Pierre), « La révolution numérique est-elle un tournant anthropologique ? », Le Débat, n° 193, 2017, pp. 153-166.
BERTAUX (Daniel), Les récits de vie, Paris, Nathan, 2001.
BESSIN (Marc) et al. (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte, 2009.
BLANK (Grant), LUTZ (Christoph), « Benefits and harms from internet use: a diffentiated analysis of Great Britain », New Media & Society, vol. 20, n° 2, 2018, pp. 618-640.
BOLTANSKI (Luc), « Croissance des inégalités, effacement des classes sociales ? », in Dubet (François) dir., Inégalités et justice sociale, Paris, La Découverte, 2014, pp. 25-47.
BOLTANSKI (Luc), CHIAPELLO (Eve), « Inégaux face à la mobilité – entretien », Projet, n° 271, 2002, pp. 97-105.
BOURDIEU (Emmanuel), Savoir faire. Contribution à un théorie dispositionnelle de l’action, Paris, Seuil, 1998.
BOURDIEU (Pierre), Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997.
BOURDIEU (Pierre), « Culte de l’unité et différences cultivées », inBourdieu (Pierre),Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, 1965a, pp. 31-106.
BOURDIEU (Pierre), « Introduction », in Bourdieu (Pierre), Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, 1965b, pp. 17-28.
BROWN (Anna) et al., Digital Divide Narrows for Latinos as more Spanish Speakers and Immigrants Go Online, Washington, Pew Research Center, 2016, https://www.pewresearch.org/hispanic/wp-content/uploads/sites/5/2016/07/PH_2016.07.21_Broadbank_Final.pdf.
CHANDLER (Daniel) MUNDAY (Rod), A dictionary of media and communication, New York, Oxford University Press, 2011.
CHEN (Wenhong), WELLMAN (Barry), « Charting Digital Divides: Comparing Socioeconomic, Gender, Life Stage, and Rural-Urban Internet Access and Use in Eight Countries », NetLab, Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto, 2003.
CHOPIK (William J.), « The benefits of social technology use among older adults are mediated by reduced loneliness », Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, vol. 19, n° 9, 2016, pp. 551-556.
CLARK (Christine), GORSKI (Paul), « Multicultural education and the digital divide: Focus on socioeconomic class background », Multicultural Perspectives, vol. 4, n° 3, 2002, pp. 25-36.
COMPAINE (Benjamin M.), The digital divide: Facing a crisis or creating a myth?, Cambridge, MIT Press, 2001.
CORREA (Teresa), « The participation divide among “online experts”: experience, skills and psychological factors as predictors of college students’ web content creation », Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 16, n° 1, 2010, pp.71-92.
COUSTEAUX (Anne-Sophie), « Des ménages et des entreprises de plus en plus connectés, mais des disparités persistantes », Insee Références, 2019, https://www.insee.fr/fr/ statistiques/4126596.
DIMAGGIO (Paul), HARGITTAI (Eszter), « From the “Digital Divide” to “Digital Inequality”: Studying Internet use as penetration increases », working paper, Princeton University Center for Arts and Cultural Policy Studies, 2002.
DUBET (François), « Introduction », in Dubet (François) dir., Inégalités et justice sociale, Paris, La Découverte, 2014, pp. 7-21.
FAIRLIE (Robert W.), « Race and the digital divide », Contributions in Economic Analysis & Policy, vol. 3, n° 1, 2004, pp. 1-40.
FRANCIS (Jessica) et al., « Catalyst to connection: When technical difficulties lead to social support for older adults », American Behavioral Scientist, vol. 62, n° 9, 2018, pp. 1167-1185.
FUCHS (Christian), « The role of income inequality in a multivariate cross-national analysis of the digital divide », Social Science Computer Review, vol. 27, n° 1, 2009, pp. 41-58.
FUCHS (Christian), MOSCO (Vincent) eds., Marx is back – the importance of Marxist theory and research for critical communication studies today– TripleC, vol. 10, n° 2, 2012.
GOLDING (Peter), « Citizen detriment : Communications, inequality, and social order », International Journal of Communication, n° 11, 2017, pp. 1-18.
HALFORD (Susan), SAVAGE (Mike), « Reconceptualizing Digital Social Inequality »,Information, Communication & Society, vol. 13, n° 7, 2010, pp. 937-955.
HARGITTAI (Eszter), « Digital na(t)ives? Variations in Internet Skills and uses among members of the ‘‘net generation’’ », Sociological Inquiry, vol. 80, n° 1, 2010, pp. 92-113.
HARGITTAI (Eszter), « Second-Level Digital Divide: Differences in People’s Online Skills », First Monday, vol. 7, n° 4, avril 2002, http://firstmonday.org/issues/ issue74/hargittai/index.html.
HARGITTAI (Eszter), HINNANT (Amanda), « Digital Inequality: Differences in Young Adults’ Use of the Internet », Communication Research, vol. 35, n° 5, 2008, pp. 602-621.
HASSANI (Sara N.), « Locating digital divides at home, work and everywhere else », Poetics, vol. 24, n° 4-5, 2006, pp. 250-272.
HELSPER (Ellen J.), REISDORF (Bianca C.), « The emergence of a ‘‘digital underclass’’ in Great Britain and Sweden: Changing reasons for digital exclusion », New Media & Society, vol. 19, n° 8, 2017, pp. 1253-1270.
HELSPER (Ellen J.), van DEURSEN (Alexander J.), « Do the rich get digitally richer? Quantity and quality of support for digital engagement », Information, Communication & Society, vol. 20, n° 5, 2017, pp. 700-714.
HILBERT (Martin), LÓPEZ (Priscila), VASQUEZ (Cristian), « Information societies or “ICT equip-ment societies”? Measuring the digital information processing capacity of a society in bits and bytes », The Information Society, vol. 26, n° 3, 2010, pp.157-178.
HUANG (Kuo-Ting) et al., « Mind the emotional gap: The impact of emotional costs on student learning outcomes », Communication and Information Technologies Annual, n° 10, 2015, pp. 121-144.
HUGRÉE (Cédric), PENISSAT (Étienne), Spire (Alexis), Les classes sociales en Europe. Tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent, Marseille, Agone, 2017.
KATZ (James), RICE (Ronald E.), Social Consequences of Internet Use: Access, Involvment and Interaction, Cambridge, MIT Press, 2002.
KVASNY (Lynette), KEIL (Mark), « The challenges of redressing the digital divide: a tale of two U.S. cities », Information Systems Journal, vol. 16, n° 1, 2006, pp. 23-53.
KHILNANI (Aneka), « The COVID-19 pandemic: New concerns and connections between eHealth and digital inequalities », Journal of Information, Communication & Ethics in Society, vol. 18, n° 3, juin 2020, pp. 393-403.
KOUBI (Geneviève), « Égalité, inégalités et différences », in Michaud (Yves) dir., Égalité et inégalités, Paris, Odile Jacob, 2003, pp. 117-143.
KUHN (Peter), MANSOUR (Hani), « Is internet job search still ineffective ? », The Economic Journal, vol. 124, n° 581, 2014, pp. 1213-1233.
LAGRANGE (Hugues), « Introduction. Un monde inégal », in Lagrange (Hugues) dir., L’épreuve des inégalités, Paris, PUF, 2006a, pp. 1-20.
LAHIRE (Bernard), Dans les plis singuliers du social. Individus, institutions, socialisations, Paris, La Découverte, 2013.
LAHIRE (Bernard), Monde pluriel. Penser l’unité des sciences sociales, Paris, seuil, 2012.
LAHIRE (Bernard), Portraits sociologiques. Dispositions et variations individuelles, Paris, Nathan, 2002.
LE DOUARIN (Laurence), LELONG (Benoît), « Entraide technique et conjugalité », in Granjon (Fabien) et al., dir.,Inégalités numériques. Clivages sociaux et modes d’appropriation des TIC, Paris, Hermès/Lavoisier, 2009, pp 119-138.
LEGLEYE (Stéphane), ROLLAND (Annaïck), « Une personne sur six n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque de compétences numériques de base », Insee Première, n° 1780, octobre 2019.
MIN (Seong-Jae), « From the digital divide to the democratic divide: Internet skills, political interest, and the second-level digital divide in politicla internet use », Journal of Information technology and Politics, n° 7, 2010, pp. 22-35.
MORLEY (David), « Analyse comparée des décodages différentiels selon les groupes », in Glevarec (Hervé) et al.(dir.), Cultural Studies. Anthologie, Paris, INA/Armand Colin, 2008, pp. 138-154.
MUPHY (Hilary C.) et al., « An investigation of multiple devices and information sources used in the hotel booking process », Tourism management, n° 52, 2016, pp. 44-51.
MUSCANELL (Nicole), GUADAGNO (Rosanna), « Make nex freinds or keep the old: Gender and personality differnces in social networking use », Computers in Human behavior, vol. 28, n° 1, 2012, pp. 107-112.
NAPOLI (Philip), OBAR (Jonathan A.), « The emerging mobile internet underclass: A critique of mobile internet access », The Information Society, vol. 30, n° 5, 2014, pp. 323-334.
NOBLE (Safiya U.), TYNES (Brendesha M.), The interscetional Internet: Race, Sex, Class, and Culture Online,New York, Peter Lang, 2016.
NOVA (Nicolas), Smatphones. Une enquête anthropologique, Genève, Métispresses, 2020.
NOVAK (Thomas), HOFFMAN (Donna), « Bridging the Digital Divide: The Impact of Race on Computer Access and Internet Use », Vanderbilt University, 1998, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.7261&rep=rep1&type=pdf.
PARK (Sora), Digital capital, Londres, Palgrave MacMillan, 2017.
PASQUIER (Dominique), L’Internet des familles modestes. Enquête dans la France rurale, Paris, Presses des Mines, 2018.
PASQUIER (Dominique), « L’internet des familles modestes : les usages sont-ils les mêmes du haut au bas de l’échelle sociale ? Entretien avec Hubert Guillaud », InternetActu, 2018, http://www.internetactu.net/2018/09/21/linternet-des-familles-modestes-les-usages-sont-ils-les-memes-du-haut-au-bas-de-lechelle-sociale/.
RAGNEDDA (Massimo), « Conceptualising the digital divide », in Mutsvairo (Bruce), Ragnedda (Massimo) eds., Mapping Digital Divide in Africa. A Mediated Analysis, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2019, pp. 27-44.
RAGNEDDA (Massimo), The Third Digital Divide. A Weberian Approach to Digital Inequalities, Oxford, Routledge, 2017.
RAGNEDDA (Massimo), GLADKOVA (Anna) eds., Digital Inequalities in the Global South, Cham, Palgrave Macmilan, 2020.
RAGNEDDA (Massimo), MUSCHERT (Glenn W.) eds., The digital divide: The Internet and social inequality in international perspective, New York, Routledge, 2013.
RAGNEDDA (Massimo), MUTSVAIRO (Bruce) eds., Digital Inclusion. An International Comparative Analysis, Lanham, Lexington Books, 2018.
RAGNEDDA (Massimo), RUIU (Maria Laura), Digital Capital: A Bourdieusian Perspective on the Digital Divide, Melbourne, Emerald Publishing, 2020.
RAGNEDDA (Massimo), RUIU (Maria Laura), « Social capital and the three levels of digital divide », in Ragnedda (Massimo), Muschert (Glenn W.) eds., Theorizing Digital Divides, Londres, Routledge, 2019, pp. 21-34.
REISDORF (Bianca C.) et al. « Mobile Phones Will Not Eliminate Digital and Social Divides: How Variation in Internet Activities Mediates the Relationship Between Type of Internet Access and Local Social Capital in Detroit »,Social Science Computer Review, mars 2020.
RENAHY (Emilie) et al., « Health information seeking on the Internet: a double divide? Results from a representative survey in the Paris metropolitan area, France, 2005-2006 », BMC Public heakth, n° 8, 2008, https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-8-69.
RICE (Ronald E.), KATZ (James), « Comparing Internet and cellphone usage: Digital divides of usage, adoption and dropouts », Telecommunications Policy, vol. 27, n° 8-9, 2003, pp. 597-623.
ROBINSON (Laura), « A taste for the Necessary: A Bourdieuian approach to digital inequality », Information, Communication & Society, vol. 12, n° 4, 2009, pp. 488-507.
ROBINSON (Laure) SCHULZ (Jeremy), « Net time negotiations within the family », Information, Communication & Society, vol. 16, n° 4, 2013, pp. 542-560.
ROBINSON (Laura) et al., « Digital inequalities and why they matter », Information, Communication & Society, vol. 18, n° 5, 2015, pp. 569-582.
ROQUEPLO (Philippe), Penser la technique. Pour une démocratie concrète, Paris, Seuil, 1983.
SEN (Amartya), Repenser l’inégalité, Paris, Seuil, 2000.
SON (Joonmo), LIN (Nan), « Social capital and civic action: A network-based approach », Social Science Research, n° 37, 2008, pp. 330-349.
SPARKS (colin), « What is the “the digital divide” and why is it important? », Javnost/The Public, vol. 20, n° 2, 2013, pp. 27-46.
STROVER (Sharon), Rural Internet Connectivity, Columbia, RPRI, 1999.
THIERER (Adam). « Is the digital divide a virtual reality? », Consumers’ Research Magazine, vol. 83, n° 7, 2000, pp. 16-21.
TONDEUR (Jo) et al., « ICT as cultural capital: the relationship between socioeconomic status and the computer-use profile of young people », New media & society, vol. 13, n° 1, 2011, pp. 151-168.
TSATSOU (Panayiota), « Pourquoi certains n’adoptent-ils pas l’internet ? L’influence de la vie quotidienne et de la culture de résistance en Grèce », Questions de communication, n° 18, 2010, pp. 63-88
van DEURSEN (Alexander), HELSPER (Ellen), « The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online? »,Studies in Media and Communications, vol. 10, 2015, pp. 29-52.
van DEURSEN (Alexander), vanDIJK (Jan), « The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access », New media & Society, vol. 21, n° 2, 2019, pp. 354-375.
van DEURSEN (Alexander), van DIJK (Jan), « The digital divide shifts to diffrences in usage », New Media and Society, vol. 16, n° 3, 2014, pp. 507-526.
van DEURSEN (Alexander), vanDIJK (Jan), TEN KLOOSTER (Peter M.), « Increasing inequalities in what we do online. A Longitudinal Cross Sectional Analysis of Internet Activities among the Dutch Population (2010 to 2013) over Gender, Age, Education », Telematics and Informatics, vol. 32, n° 2, 2014, pp. 259-272.
van DIJK (Jan), The Digital Divide, Cambridge, Polity Press, 2020.
van DIJK (Jan), « A theory of the digital divide », in Ragnedda (Massimo), Muschert (Glenn W.), The digital divide: The internet and social inequality in international perspective, New York, Routledge, 2013, pp. 28-51.
van DIJK (Jan), The deepening divide. Inequality in the information society, Thousand Oaks, Sage, 2005.
van DIJK (Jan), van DEURSEN (Alexander), Digital skills. Unlocking the Information Society, New York, Palgrave MacMillan, 2014.
WARSCHAUER (Mark), Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide, Cambridge, The MIT Press, 2003.
WILSON (Ernest J.), The Information revolution and Developing Countries, Cambridge, MIT Press, 2006.
WITTE (James C.), MANNON (Susan E.), The Internet and social inequalities, New York, Routledge, 2010.
WYATT (Sally), « Les non-usagers de l’internet. Axes de recherche passés et futurs », Questions de communication, n° 18, 2010, pp. 21-36.
WYATT (Sally), « They Came, They Surfed, They Went Back to the Beach: Why some people stop using the internet », communication à la Society for Social Studies of Science conference, San Diego, 1999, http://virtualsociety.sbs.ox.ac.uk/reports/surf.htm.
YARDI (Sarita), « A Theory of Technical Capital », Position paper, TMSP Worskshop, 2010.
YATES (Simeon J.), LOCKLEY (Eleanor), « Social media and social class », American Behavioral Scientist, vol. 62, n° 9, 2018, pp. 1291-1316.
YATES (Simeon J.) et al.« Who are the limited users of digital systems and media? An examination of U.K. evidence », First Monday, vol. 25, n° 7, 2020, https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/10847/9565.
ZILLIEN (Nicole), HARGITTAI (Eszter), « Digital Distinction: Status-Specific Types of Internet Usage », Social Science Quaterly, vol. 90, n° 2, 2009, pp. 274-291.
[1]I.e.tout dispositif technique constitué, a minima, d’un système d’exploitation informatique et d’une connexion Internet (smartphone, tablette, ordinateur, etc.).
[2]Si les inégalités sociales ceignent les pratiques, cela n’équivaut pas, pour autant, à considérer qu’elles en déjouent tous les développements positifs (Katz et Rice, 2001).
[3]Les pespectives dispositionnalistes donnent les moyens d’analyser conjointement l’inscription de l’individu dans la société et de la société dans les individus. Elles permettent d’envisager les contextes et les sujets sociaux comme des faits et des individus historiques, construits par l’action humaine et portant en eux la marque de la société (les rapports sociaux de la totalité concrète). Parmi les continuateurs éclairés de Bourdieu, Bernard Lahire est de ceux qui ont discuté le plus habilement et minutieusement les apports de la théorie de l’habitus. Sa sociologie reprend le principe structuralo-génétique/constructiviste visant à considérer les pratiques sociales comme la combinatoire entre des schèmes dispositionnels incorporés dont l’origine tient à l’existence de cadres socialisateurs antérieurs à l’action (« l’agir présent est hanté par la mémoire involontaire de l’expérience passée » – Lahire, 2013 : 139) et des contextes pratiques singuliers qui appellent, permettent, suspendent ou proscrivent avec plus ou moins de vigueur la mise en œuvre des diverses dispositions dont sont porteurs les sujets sociaux prenant part à l’action : « ce que l’acteur perçoit, voit, sent ou se représente de la situation présente et ce qu’il y fait ne se saisit qu’au croisement des propriétés (objectivables) de la situation en question et de ses propriétés incorporées (dispositions mentales et comportementales plus ou moins cohérentes ou contradictoires formées au cours des expériences socialisatrices passées) » (Lahire, 2012 : 31).
[4]La notion de capabilité renvoie évidemment aux travaux d’Amartya Sen, mais nous l’employons également, ici, dans une acception proche du sens que donne Gilbert Ryle au concept de capacité, par rapport à laquelle Emmanuel Bourdieu précise qu’elle est « une disposition faible, c’est-à-dire une disposition dont les effets non seulement ne sont pas nécessaires, mais sont seulement possibles. En effet, en droit, la possibilité qu’implique une capacité peut ne jamais s’actualiser et rester éternellement contrefactuelle. Définir les capacités comme des dispositions faibles, ce n’est donc pas seulement affaiblir le conditionnel dispositionnel, c’est-à-dire en faire un conditionnel non déterministe ; c’est lui donner la forme conditionnelle la plus faible qu’il puisse avoir, à savoir celle d’une inférence simplement possible. En d’autres termes, une capacité n’est pas une tendance indéterministe ; une capacité n’a absolument rien de tendanciel ou de propensionnel. […] Une tendance est une disposition qui produit, nécessairement, des effets ou, au moins, une certaine proportion d’effets actuels, sur le long terme. Une capacité est une disposition telle que le fait que quelqu’un la possède peut ne faire aucune différence dans le comportement de ce dernier, même sur le long terme » (1998 : 53-54).
[5]Lahire insiste sur le fait que ces singularités dispositionnelles ne sauraient être seulement considérées commes le fruit de conditions d’existence de classe. Et d’ajouter « C’est le cas de toutes les dispositions incorporées par l’enfant du fait de la position qu’il occupe dans la configuration familiale [ou] de la nature des relations d’interdépendance dans lesquelles il est amené à agir. […] Si le volume du capital culturel et économique possédé, ainsi que la pente de la trajectoire, sont des facteurs centraux de la constitution d’une partie des dispositions des patrimoines de chaque individu, en aucun cas on ne peut dire que ce sont les seuls, ni même que ce sont ‘‘en général’’ les plus importants » (2002 : 406). La remarque apparaît judicieuse en ce qu’elle invite à ne pas rapporter systématiquement et paresseusement les comportements individuels à des déterminations de classe relevant d’une formule génératrice global, mais celle-ci ne doit pas conduire à vouloir éliminer avec autant de systématicité l’origine de classe de certaines singularités. La classe n’est pas un tout homogène subsumant toutes les composantes de l’existence, mais environnement susceptible de marquer de son empreinte sans pour autant définir en totalité les dispositions. Aussi, pour reprendre l’exemple de Lahire, la place dans la famille peut très bien être redevable de conditions de classe (financement des études de l’aîné et non des cadets) et conduire à des dispositions qui, sans pouvoir être qualifiées « de classe », n’en sont pas moins liées à des conditions sociales d’existence particulières qui en définissent certaines des caractéristiques (e.g. les comportements agressifs des cadets vis-à-vis de l’aîné considéré comme le « préféré », celui à qui ont a réservé le privilège des études).