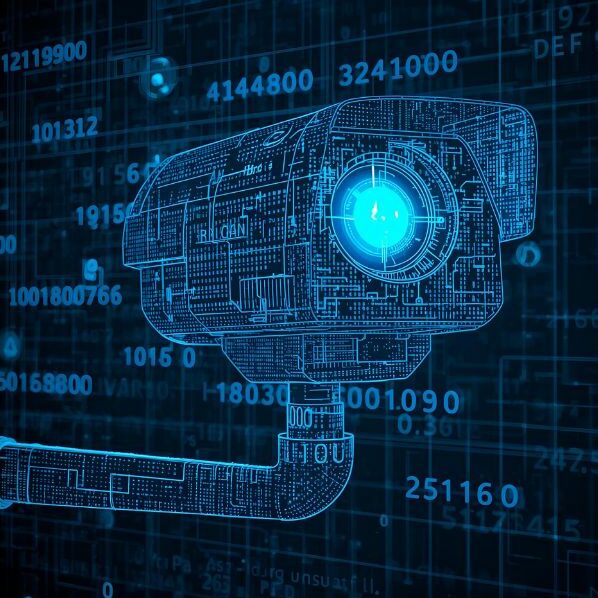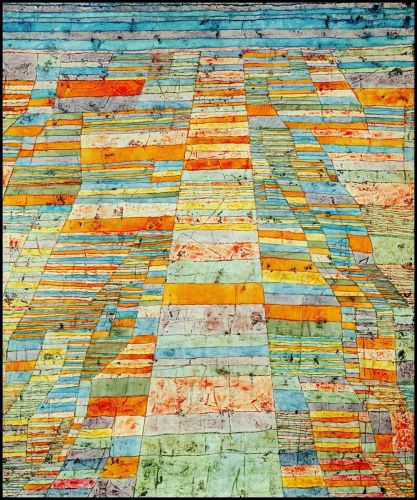Journée d’étude « L’EMI au prisme des inégalités numériques » – Usages et enjeux de l’inclusion numérique – ENSSIB
Pourquoi avoir choisi d’intervenir plus particulièrement sur ce thème de l’inclusion numérique au sein de cette journée portant sur l’EMI au prisme des inégalités numériques ? Parce qu’il me semble que l’« inclusion numérique » est devenue une sorte de MacGuffin institutionnel. Le terme de MacGuffin appartient au champ cinématographique ; on l’attribue généralement – apparemment indûment – à Alfred Hitchcock qui désignait par ce vocable un objet vague mais servant de point d’appui à des développements scénaristiques importants. Le parallèle me semble opportun dans la mesure où l’inclusion numérique est prétexte au développement de divers scénarios de résorption des inégalités dites numériques qui, certes, s’appuient sur des faits avérés – à commencer sur le fait que l’usage des technologies numériques d’information et de communication tend à devenir une injonction pratique dans différentes sphères de l’existence –, mais des scénarios qui, par ailleurs, se fondent sur des solutions qui répondent à des nécessités qui ne disent pas tout à fait leur nom.
Je défendrai donc l’idée que l’inclusion numérique peut, certes, être une heureuse attention aux inégalités et à la nécessité de l’extension du domaine de la justice sociale, mais qu’elle est malgré tout, la plupart du temps, une formule qui relève moins de la recherche d’un égalitarisme radical, cherchant à aller à la racine des causes de l’inégalité que d’une volonté intégrative à une société de plus en plus technologisée et notamment traversée par une instrumentation numérique généralisée.
L’objectif de cette communication pourrait donc bien être de vous convaincre que quand on parle d’inclusion numérique, le terrain est quelque peu piégé : le piège le plus courant tient, me semble-t-il, au fait de faire passer les inégalités dont l’inclusion numérique est censée s’occuper comme étant de nature « numérique », alors que les inégalités dites numériques sont bien évidemment des inégalités avant tout sociales et le produits de rapports sociaux. Un autre piège fréquent tient à l’ambiguïté du vocable « inclusion » à qui l’on peut imputer des sens variables, ambivalence qui permet de cacher, derrière son acception la plus progressiste, des visées qui le sont nettement moins.
Je me propose donc de traiter un peu plus en détail ces deux points, qui me permettront d’aborder, dans un troisième et dernier temps, la question de la médiation numérique : domaine de l’action publique et secteur professionnel à part entière dont le but est précisément de veiller à l’inclusion numérique et dont on verra qu’il nécessiterait peut-être d’être pensé autrement que ne le font les politiques publiques dédiées.
De l’inclusion
Donc en premier lieu, j’aimerais commencer par dire quelques mots sur la notion même d’inclusion. Au regard du sujet qui nous occupe ce matin, il est utile de rappeler que l’inclusion a gagné son titre de notion-phare des discours politiques, médiatiques et même scientifiques, en tout cas à l’échelle européenne, au tournant du XXIe siècle, plus précisément au moment de la mise en place de ce qu’on appelle la Stratégie de Lisbonne, qui vise à faire de l’Union européenne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ».
La notion d’inclusion a ensuite été confirmée dans son importance par diverses institutions dont notamment la Commission européenne qui, dans sa stratégie Europe 2020, affirmait viser une « croissance intelligente, durable et inclusive ». Selon la Commission européenne, l’inclusion sociale est donc « un processus qui permet aux personnes en danger de pauvreté et d’exclusion sociale de participer à la vie économique, sociale et culturelle, et de jouir d’un niveau de vie décent. Ces personnes doivent être impliquées dans les prises de décision qui affectent leur vie et bénéficier d’un meilleur accès à leurs droits fondamentaux ».
Comme le note Brigitte Bouquet (2015), l’inclusion est, petit à petit, devenue un référentiel global qui implique de permettre à l’ensemble des individus de développer un rapport actif à leur environnement et ce, dans tous les aspects de la vie sociale et depuis la diversité et la singularité de leurs besoins. En théorie, le principe d’inclusion se caractérise donc par une prise en compte des situations singulières des personnes fondée sur un principe d’équité (à chacun selon ses besoins) et cherchant à lutter contre les processus d’exclusion, de désaffiliation (Castel, 2009) ou de disqualification (Paugam, 2012) qui menacent « les possibilités ou capacités qu’ont des individus à tenir leur place dans la société, à y être reconnus et à y trouver les moyens de satisfaire leurs aspirations ou leurs attentes ». Et d’ajouter : « Le critérium de construction du « parcours » [inclusif] est l’accès aux institutions communes et le maintien dans le droit commun en excluant le plus possible les formes « spécialisées » de prise en charge » (Lafore, 2020 : 31 et 41). Or dans les faits et tel qu’il est envisagé, notamment en France, le modèle inclusif se mélange avec un autre modèle normatif que Robert Lafore, identifie comme caractérisant plus spécifiquement la période des Trente Glorieuses et qu’il appelle l’ordre normatif « réparateur » et qui postule que « La modernisation produit des « inadaptations », et donc des « inadaptés » et il convient de les prendre en compte en compensant les déficits constatés par des prises en charge assurées par la collectivité » (2020 : 35). C’est, nous semble-t-il, ce mélange de modèles normatifs, à la fois réparateur et inclusif qui, aujourd’hui, vient étayer les attendus de l’inclusion numérique. Le numérique est envisagé comme un développement de la modernité qui crée de nouvelles inadaptations au principe desquelles se trouvent des « déficiences » qui ne sont pas tout à fait identiques d’un individu à l’autre et qu’il s’agit de traiter par le biais, notamment, de dispositifs d’assistance et des modes de prises en charge ad hoc qui ne relèvent cependant pas d’établissement centraux spécialisés.
Par ailleurs, sous l’angle de l’inclusion, le numérique peut être envisagé comme un moyen au service de politiques d’inclusion sociale, ou bien comme objet et finalité de politiques d’inclusion dédiées au numérique. Si l’on prend, par exemple, le cas de l’éducation dite inclusive, la loi du 8 juillet 2013 « pour la refondation de l’école de la République » indique que « L’école inclusive doit s’adapter aux besoins de tous les élèves et aux besoins de chacun d’entre eux, dans un environnement scolaire prenant en compte les spécificités de chaque parcours ». Dans ce cadre, le numérique apparaît à l’évidence comme un répertoire de moyens susceptibles d’être mobilisés, précisément pour « aller chercher » la particularité individuelle afin de mettre en œuvre une pédagogie différenciée à l’intérieur de processus qui restent a prioricollectifs. Si l’on veut prendre un autre exemple, celui du handicap psychique ou physique, le numérique est, là encore, envisagé comme un outil utile dans une perspective de réadaptation, de soutien à la participation sociale et d’élimination de toute discrimination pratique, notamment d’accès (Saba Ayon, 2016). L’inclusion repose, ici, sur la possibilité effective de participer aux interactions et aux activités sociales favorisant l’épanouissement des individus quelles que soient leurs singularités. Derrière la notion d’inclusion il y a donc un principe d’équité par rapport auquel le numérique est envisagé comme une opportunité susceptible de répondre à cette attente normative.
Toutefois, le numérique peut aussi être pensé non plus comme solution technico-pratique, mais comme obstacle à la concrétisation de l’idéal d’égalité (ou d’équité). La plupart du temps, quand on parle d’inclusion numérique, on entend en effet plutôt que la numérisation accrue des sociétés pose un problème d’inclusion pour celles et ceux dont on a pris l’habitude de dire qu’ils/elles seraient « éloigné.e.s du numérique » (comme on parle de « personnes éloignées de l’emploi » dans les plans d’insertion professionnelle). De fait, force est de constater l’omniprésence des dispositifs numériques au sein des différentes sphères d’existence. On assiste notamment à un remodelage du modèle d’action publique qui se fonde sur un recours accru au numérique et sur une dématérialisation des services publics qui ne vont pas sans poser problème, tant ils bouleversent les pratiques professionnelles des agents de l’État, les usages des ressortissants et les rapports à l’État de toutes et tous. La « transformation » par le numérique rencontre en effet des obstacles que certaines enquêtes objectivent par la production de statistiques : en France, en 2019, 15 % de la population n’a pas utilisé Internet au cours de l’année. Le Baromètre du numérique de 2017 atteste que 33 % des Français se qualifient de « peu ou pas du tout compétents » pour utiliser un ordinateur. Pour l’INSEE, « Une personne sur quatre ne sait pas s’informer et une sur cinq est incapable de communiquer via Internet ». Le rapport du sénateur Vall (2020), met en avant que « près de la moitié de la population française [serait] touchée par l’illectronisme ». Quant au GIS Marsouin, il avance qu’il y aurait, en France, 13 millions d’exclus du numérique. On pourrait discuter du sérieux de certaines de ces assertions, mais toujours est-il que l’instrumentation numérique généralisée à laquelle nous faisons face n’est pas un long fleuve tranquille pour tout un chacun, par exemple pour les plus de 70 ans, les peu diplômés, certains jeunes issus des classes populaires ou encore les ménages dont les revenus sont moindres.
Aussi, cette difficulté à faire entrer le plus grand nombre dans la « modernité numérique » a-t-elle été rapidement identifiée par les politiques, les institutions étatiques et certains acteurs de la société civile. Elle a notamment donné lieu à la production de nombreux discours cherchant à rassurer, mais aussi à tout un train de mesures visant à résorber ce qui a d’abord été désigné comme un phénomène de « fracture numérique », puis aujourd’hui signalé comme relevant de mesures d’inclusion. Si l’on ne s’en tient qu’aux mesures les plus récentes, il faut sans doute citer la loi pour une République numérique portée par la secrétaire d’État chargée du numérique et de l’innovation, Axelle Lemaire. Promulguée en 2016, cette loi entend mettre le numérique au service de toutes et tous. Et s’agissant plus précisément des politiques d’inclusion, le Conseil national du numérique (CNNum) se félicite notamment d’un chapitre réservé « à l’accès des publics fragiles » porteurs de handicaps et salue le principe du maintien de la connexion Internet pour les personnes en incapacité de paiement. Il préconise par ailleurs la création d’un statut professionnel de médiateur numérique (cf. infra) et souhaite l’importation du droit d’accès au numérique pour les détenus. Citons également l’Agence du Numérique qui pilote, à partir de février 2015, trois politiques publiques : La French Tech, le Plan France Très Haut Débit et le programme Société Numérique. Lors de ces deux premières années d’existence, cette agence va s’employer à fédérer les technopoles et les écosystèmes de start-ups, va monter un programme premium d’accompagnement public des « pépites » de la French Tech, va superviser le développement du très haut débit sur « les territoires » et va également lancer la MedNum, une coopérative d’intérêt collectif réunissant les acteurs de la médiation numérique. Donc globalement, ce sont les acteurs de l’économie numérique qui bénéficient le plus des efforts étatiques et il est bien clair que « la montée en compétences numériques de tous » doit d’abord favoriser la croissance et l’emploi (CNNum, 2015), notamment, nous dit-on, en formant « une main d’œuvre capable de contribuer à une économie informationnelle dont on attend beaucoup en termes de croissance » (CNNum, 2013 : 4). En 2017, Mounir Mahjoubi, alors Ministre chargé du numérique déclare toutefois dans une interview donnée à Thinkerview, je le cite : « Sur l’e-inclusion, ça va pas bien. Faut qu’on fasse quelque chose pour les treize millions de Français qui n’utilisent pas le numérique ». Grand commis de la Start-up Nation, il lance alors, comme ces prédécesseurs, un plan national pour un « numérique inclusif » qui reprend peu ou prou les attendus des premières feuilles de route nationales mises en place depuis 25 ans. Dans ce plan dit « de sauvetage », se trouve notamment un Pass crédit formation délivré par Pôle Emploi, la Caisse d’allocations familiales, l’Assurance maladie, les villes, les agglomérations ou encore les départements, censé permettre l’accès gratuit à un accompagnement au numérique au sein de lieux labellisés. Les compétences ainsi acquises doivent, d’ici dix ans, servir à créer « 1,6 milliard d’euros de bénéfices par an ». Le rapport de France Stratégie publié en 2018, intitulé Les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique est à cet égard éloquent : l’autonomie dont il est question dans le titre tient essentiellement au développement du e-commerce et au développement de « réflexes » d’achat en ligne et de services de plateforme (y compris d’État), c’est-à-dire au fait d’assurer les conditions de possibilité sociotechniques de développement des secteurs où les bénéfices semblent les plus faciles à générer, la croissance plus aisée à dynamiser et la gestion des coûts et de la dette plus commodes à envisager. L’inclusion numérique ne semble donc surtout valoir qu’au regard de ce qu’elle peut apporter à l’économie et aux profits financiers, même si elle est présentée comme étant d’abord question « d’équité, d’égalité des droits et de cohésion sociale ».
Fidèle à l’idéologie des partenariats public/privé, le gouvernement d’Édouard Philippe va ainsi faire de la société numérique inclusive, l’un des terrains de jeu du développement des collaborations entre structures étatiques et (grandes) entreprises du numérique. Pôle Emploi a par exemple passé un accord avec Mark Zuckerberg, afin de former au numérique 50 000 personnes « éloignées de l’emploi » et des pratiques numériques. Et avec Google, il a notamment été organisé des journées de formation proposant aux chômeurs de se connecter à leur « Wi-Fi intérieur » et leur conseillant l’acquisition d’un ordinateur Chromebook. Les missions de service public sont ainsi pensées comme devant avoir recours aux acteurs du marché.
L’inclusion est théoriquement une « nouvelle conception des services rendus aux différents publics » visant à moduler l’accompagnement en fonction des bénéficiaires. Mais dans la pratique et quand ladite inclusion est attachée au numérique, force est de constater qu’elle tend surtout à ouvrir de nouveaux marchés à des partenaires considérés au plus haut niveau de l’État comme des « briques essentielles » à la compétitivité nationale. C’est sur ce principe économico-centré qui ne dit toutefois guère son nom que le Crédit Agricole, les Réseaux de BNP Paribas, Veolia Eau France, la Fondation Orange et bien d’autres grands groupes affirment se mobiliser contre l’illettrisme numérique – aussi appelé « illectronisme » – et vouloir former des centaines de milliers de personnes, via des structures locales qu’ils soutiennent financièrement. Ces mesures ont par ailleurs été renforcées dans le cadre du Plan de relance de l’économie suite au confinement lié à l’épidémie de Covid-19. La « transition numérique » est censée se trouver au cœur d’un nouveau pacte social, produire « un choc d’appropriation par la population française des nouveaux usages et outils numériques » et « accélérer la reprise économique du pays qui reposera largement sur l’économie numérique ». De fait, la somme globale allouée sur la période 2021-2022 semble relativement conséquente (sept milliards d’euros), mais, sans surprise, la part du lion (ou « de la licorne » faudrait-il dire) revient à l’écosystème de la French Tech (3,7 milliards) et seulement 800 millions (c’est-à-dire tout juste un peu plus de 20 %) sont alloués en faveur de « l’accès au numérique pour tous » vial’ouverture ou le développement de lieux de proximité dédiés.
Cette idée d’un numérique qui relève finalement moins d’un « inclusif émancipateur » que d’un « intégratif capitaliste » a été relevé dans de nombreux travaux de l’économie politique la plus critique. On retrouve par exemple cette idée dans les thèses avancées par Shoshana Zuboff à propos du capitalisme de surveillance, nouvelle phase de développement d’un capitalisme passé maître dans le profilage individuel des usagers du numérique… Fâcheuse ironie à constater que l’idéal de prise en compte de la diversité sur lequel fait fond le principe d’inclusion est aujourd’hui particulièrement bien assuré par les acteurs du capitalisme de surveillance. Aussi trouve-t-on dans la bouche ou sous la plume des grands industriels du secteur numérique des discours faisant dudit numérique la solution aux grands problèmes de ce monde, à l’instar de Brad Smith (Vice-Président de Microsoft) qui avance dans une interview récente, je le cite : « La technologie a un rôle important à jouer, non seulement pour stimuler la croissance économique, mais aussi pour soutenir le développement durable et aider à façonner des communautés plus inclusives » (2021). L’inclusion à la sauce des acteurs majeurs du numérique, n’est en fait rien d’autre que la construction de leur hégémonie industrielle et marchande, laquelle nécessite effectivement d’enrôler le plus grand nombre de personnes. À cette aune, être inclus, n’est donc pas autre chose que de participer d’une manière ou d’une autre à l’extraction de la plus-value. Et quand les Nations Unies mettent en place un Groupe de haut niveau sur la coopération et l’inclusion numériques, on en confie, sans trop de surprise, la présidence à… l’entrepreneur chinois Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba, et à Melinda Gates, de la Fondation Gates… Si l’on voulait reprendre et détourner une formule célèbre de Marx, on pourrait dire que l’inclusion numérique est devenue une thématique dominante parce qu’elle est une thématique importante pour les classes dominantes.
Les inégalités numériques sont des inégalités sociales
Aussi n’est-il pas étonnant de constater que la rhétorique de l’exclusion soit si présente au sein des discours portant sur le domaine du numérique, présenté comme le niveau de détermination de nombre de phénomènes sociaux de la modernité technologique. Sauf qu’au regard de ce que nous venons d’avancer, l’exclusion numérique pendant négatif de l’inclusion numérique est une sorte de cache-misère au sens littéral de l’expression, dans le sens où elle oblitère la nature véritable de cette exclusion qu’elle résume à une déréticulation, à une « déliaison » numérique, c’est-à-dire à une décohésion du système technique conçu comme la totalité organique à partir de laquelle est censée s’organiser la connexion au monde. De la même manière que l’exclusion sociale a été pensée comme une perte du lien social, l’e-exclusion est entendue comme une perte du lien numérique qui est appréhendé comme ce qui permet le fonctionnement du tout et assure sa reproduction. Dans cette perspective, l’inclusion numérique vise à réintégrer les potentiels inemployés des marges dont on craint toujours qu’elles puissent perturber le système dans son ensemble ou, à tout le moins, désoptimiser son rendement.
Il s’agit donc de lutter contre ce qui est présenté comme de « nouvelles formes d’inégalités » qui dépendent pour l’essentiel de deux grands types de déficience : d’une part, une déficience en équipement postulant en creux et à tort qu’une population équipée et connectée est une population nécessairement insérée et, d’autre part, une déficience en compétences à proprement parler numérique, le « fameux » illectronisme que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme définit comme « une maîtrise insuffisante des compétences numériques de base, nécessaires à toute personne pour effectuer de manière autonome les actes de la vie courante » (2019). L’approche sous l’angle des compétences et de l’acquisition de savoir-faire relevant d’une littératie numérique indexe l’inclusion numérique à la possibilité de bénéficier de programmes d’apprentissage tout au long de la vie et de mettre à jour – comme on met à jour un système d’exploitation – ce qui est présenté comme une « culture numérique » dont la Commission au Parlement Européen estime qu’elle est essentielle pour… « accroître sur les plans qualitatif et quantitatif les compétences en matière de TIC et de commerce en ligne, c’est-à-dire les compétences numériques nécessaires à l’innovation et à la croissance ».
Sans remettre en cause frontalement le bien-fondé de ces examens (ne pas avoir la maîtrise a minima de l’informatique connectée est sans aucun doute un handicap dans une société largement informatisée), ce type de cadrage n’envisage le plus souvent les inégalités dites numériques que sous l’angle de figures de l’extension du domaine de la dépossession, visant à fabriquer un « nouveau » problème public qui emprunte, comme dans le cas de l’illettrisme d’ailleurs, au registre de la plainte publique notamment caractérisée, selon Bernard Lahire, par « une tendance à la surinterprétation des effets positifs de l’entrée [dans la pratique], ainsi que des effets désastreux de la non-maîtrise » (2005 : 47). Sous cet angle, l’exclusion du numérique a tendance à être réifiée et présentée comme connectée à d’autres problèmes sociaux par des liens de causalité (le numérique produit des inégalités), alors qu’ils sont plus sûrement associés par le fait d’être des conséquences de causes identiques : les inégalités sociales. De fait, l’illectronisme est une catégorie qui disqualifie les personnes qui ne s’inscrivent pas dans les logiques de compétence du monde numérique. À l’instar de son grand frère l’illettrisme, l’illectronisme devient un « lieu commun discursif de nombreux fantasmes sociaux […], un mythe social collectivement entretenu [qui] devient une catégorie dominante de perception du monde social et, malgré son flou, impose tout de même une manière de voir le monde, et notamment sous un angle essentiellement culturel (vs. économique, politique…) » (Lahire, 2005 : 122).
Si cette manière de considérer les inégalités numériques depuis la nécessité d’acquisition d’une culture technique apparaît plus raisonnable que la simple approche infrastructurelle en termes d’accès à des matériels, elle en vient pourtant en certains de ses développements, à envisager que les inégalités de compétences se distribueraient selon des variables qui ne seraient plus celles qui structureraient les inégalités sociales. En l’espèce, l’argument de la complexité est très souvent avancé pour donner à penser que les inégalités numériques redistribueraient les places dominées et dominantes dans l’espace social. Or ce que les données empiriques montrent, c’est par exemple que le niveau de certification scolaire ou l’appartenance de classes restent des facteurs explicatifs des usages et non-usages développés au sein de certains groupes sociaux. À la photo de classe révélant la structuration sociale des usages, on préfère substituer certains portraits atypiques comme les SDF connectés, les ouvriers hackers ou les entrepreneurs réfractaires aux réseaux sociaux en oubliant qu’il s’agit là de cas singuliers qui n’ont, la plupart du temps, aucune valeur représentative générale. La diversité qui résonne particulièrement avec la notion d’inclusion peut alors conduire, comme le souligne Antoine Printz dans un article de la revue Mots, à « une esthétisation de la différence, qui peut mener à la mise en œuvre d’une action publique formelle et minimale qui se limite à incorporer la différence tout en l’acceptant, voire en la sacralisant » (2020 : 88-89).
Un point de vue plus ancré dans la réalité est sans doute de considérer que ces prétendues nouvelles inégalités viennent renforcer les inégalités sociales et limitent encore plus la pleine et entière participation à la société. L’inclusion numérique est alors appréhendée comme la nécessité de ne pas venir aggraver les situations des plus précaires et les faire tomber dans l’exclusion ou la désaffiliation. On l’aura compris, l’inclusion numérique devient synonyme d’inclusion sociale parce que nous serions dans une société et une économie où le numérique joue un rôle essentiel. Et le Conseil National NUMérique d’en déduire qu’« Il n’y a pas une « e‐inclusion » d’un côté et une « inclusion » [sociale] de l’autre [parce que] les deux se confondent ». Cela paraît plus raisonnable et plus ancré dans la réalité, sauf qu’en l’espèce nombre de ceux qui défendent cette position ne font pas tant du numérique une question sociale que du social une question numérique sous couvert de l’équivalence qu’il pose. Dans un rapport de 2005, un groupe d’experts réuni par la Commission européenne affirmait par exemple, que « l’e‐inclusion n’est rien d’autre que l’inclusion sociale et économique dans une société de la connaissance ». Comme le fait remarquer Guillaume Lahoz dans un récent papier pour la revue de la Caisse nationale d’allocations familiales (2022), si « Les questions de lutte contre la pauvreté, de non-recours aux droits et d’accès aux services publics ne sont pas récentes, elles sont [toutefois] de plus en plus souvent appréhendées à travers le prisme de la numérisation ».
De fait, les « marges sociales », nous l’avons déjà souligné, ont vocation à être rétablies dans leur utilité minimale au monde connexionniste ; monde connexionniste que l’on imagine par ailleurs toujours davantage devoir produire le « social », notamment en lieu et place de l’État. C’est un numérique-providence qui est ici promu comme nouvel intégrateur social dont la dissociation (l’éloignement) est alors présentée comme l’équivalent d’une radiation interdisant les bénéfices individuels. Sous cet angle, le sujet social, économiquement et culturellement déterminé s’efface pour laisser place à la figure d’un individu qui se définit d’abord comme sujet numérique porteur d’un niveau de performance minimal, disposé à son intégration à une configuration sociotechnique hégémonique, déterminant sa participation (continue) à l’activité productrice et de consommation, normalisant son inscription dans les standards communs d’existence (conditions de vie) et assurant finalement son intégration à la vie sociale et politique. À l’instar de l’idée d’exclusion sociale, celle d’exclusion numérique, structure selon Périne Brotcorne, « un univers de vulnérabilité pour tous les individus, leur renvoyant la responsabilité de leur existence. Cette valorisation de la responsabilité individuelle et de la capacité à agir à partir de soi a progressivement redessiné les modalités de l’intégration sociale. En effet, dans la mesure où l’idée d’un individu autonome et autoréalisé devient la norme, l’intégration à la société se conçoit comme une participation active et volontaire de ses membres ; elle repose sur leur volonté de contribuer à son fonctionnement. Dès lors, la cohésion sociale est fondée sur la capacité des individus à prendre place dans la société en tant que sujet responsable. Le vivre ensemble repose alors sur l’idée d’une société de participation volontaire » (2010 : 64).
Aussi, les « difficultés numériques » sont également souvent présentées comme des « handicaps », des « infirmités », qu’il faut traiter dans le cadre d’un « care technologique », supposé lutter contre les discriminations et les mises à l’écart dont seraient frappés les e-exclus (« naufragés du numérique ») qu’il s’agit donc d’aider à assurer une performance moyenne et à ne pas rompre avec la modernité numérique. Mais, l’empan de l’e-exclusion s’avère également plus étendu que celui de l’exclusion à proprement parler sociale et nombre de propos tenus à son propos rappelle qu’il touche aussi des publics « jusqu’alors parfaitement intégrés » (Deydier, 2018). L’exclusion numérique est alors envisagée comme une menace de surcroît dont la particularité est qu’elle conditionnerait d’autres formes d’exclusion. Et inversement, l’inclusion numérique est pensée comme un préalable à l’insertion sociale. Elle est envisagée comme le moyen de résorber les inégalités sociales dans une visée techno-solutionniste, que l’on retrouve par exemple dans le rapport du Conseil National du NUMérique daté de 2013 et adressée à la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique. Il y est écrit que le numérique est un « moyen pour faire société » et réaliser l’inclusion sociale : « Et si, au‐delà de chercher à éviter que le numérique n’accroisse les inégalités, on s’appuyait sur lui pour les réduire ? ‘‘L’e‐inclusion’’ doit désormais prendre un sens positif, offensif. Le numérique peut se mettre au service d’une société plus équitable, plus juste, plus solidaire, plus participative. […] Aussi s’agit-il de s’appuyer sur le numérique comme véritable levier de transformation individuelle et collective ».
Ici, le numérique passe d’un statut de cause potentielle de « nouvelles » inégalités à celui de solution aux problème sociaux, mais dans une version évidemment peu précise, éloignée de toute perspective en termes de rapports sociaux, préférant faire fond sur des approches en termes d’empowerment ou de puissance d’agir qui ne s’intéressent guère ou pas du tout aux conditions structurelles de possibilité de déploiement de cette puissance d’agir. Pour quelles raisons ? Parce que ce sont les dispositifs numériques qui ontologiquement apporteraient les nouvelles capacités utiles au sujet social. S’il est alors de bon ton de rappeler que « l’inclusion numérique ne se résume plus à l’utilisation des outils du numérique » (CNNum 2013), il est tout de même avancé que l’inclusion désigne « la capacité à fonctionner comme un citoyen actif et autonome dans la société telle qu’elle est » postulant ainsi que sans le numérique la chose ne pourrait être effective. On est là face à une sorte d’« animisme numérique » qui fait fi des conditions concrètes d’appropriation. Le numérique permettrait ainsi, pour le Conseil National du NUMérique de « reconquérir l’estime de soi, sortir de l’exclusion, retrouver des sociabilités, stimuler des comportements créatifs, inventer des actions solidaires et des reconfigurations démocratiques, outiller des projets personnels ou collectifs, recréer de la proximité et du lien humain sur les territoires. […] Le numérique devient, non plus la fin, mais le moyen, le truchement par lequel se réinventent des formes collectives, contributives, et se révèlent les moteurs de ce que pourrait être une démocratie réellement inclusive. L’inclusion numérique est devenue une condition indispensable du plein épanouissement de l’individu, mu par le désir d’apprendre et d’entreprendre, et comme la condition d’émergence d’un nouveau « vivre ensemble » ».
Bref, le numérique serait la nouvelle panacée… solution à tous les maux. Or force est de constater que l’instrumentation numérique généralisée que l’on observe au sein des sociétés capitalistes avancées accompagne un creusement considérable des inégalités sociales attestée par de nombreux travaux statistiques, notamment au profit de milliardaires qui font précisément fortune grâce à… leur participation à l’industrie du numérique. Mais outre ce fait, on oublie aussi que les usages ne tiennent pas seulement aux programmes d’action inscrits dans les artefacts, mais qu’ils relèvent de la rencontre de scripts techniques visant à guider les conduites, avec des usagers et leurs dispositions, c’est-à-dire avec leurs manières d’agir, de penser, d’évaluer (et pas seulement de manipuler). C’est la rencontre entre les objets techniques et les personnes qui configurent les potentiels d’usage.
Toutefois, si les dispositions saisissent les dispositifs par les prises constituées par leurs programmes d’action, ce rapport pratique à la pratique des artefacts joue également en sens inverse et on peut considérer que ce sont aussi les scripts qui viennent chercher certaines dispositions incitant les sujets à entrer dans l’usage. Pour le dire autrement, les instruments numériques sont à la fois agis par les usagers et leurs dispositions et agissants sur les usagers, c’est-à-dire qu’ils mobilisent, mais aussi éventuellement produisent des dispositions. Ils sont donc à la fois des instances socialisées et socialisatrices. Si l’on utilise par exemple Facebook à la mesure de ce que nos dispositions nous permettent d’envisager de ses fonctionnalités, il est non moins évident que si l’on y passe trois heures par jour, le réseau social devient une instance de socialisation – fort complexe dans la mesure où il nous met en relation avec des scripts, des contenus et des personnes – , mais dont il n’est pas délirant de penser qu’elle configure des dispositions sociales et cognitives et participe donc à l’incorporation individuelle du social.
De la médiation numérique
*
Pour conclure rapidement, j’aimerais reprendre à mon compte la provocation d’Hubert Guillaud qui dans une tribune datée de 2021, se demandait si une politique numérique de gauche était réellement possible, tant la numérisation du signe participe du projet capitaliste et étend son hégémonie. Aussi, il nous semble que pour qui se préoccupe radicalement des injustices et des inégalités sociales, l’inclusion numérique ne peut occuper dans l’agenda des combats à mener qu’une place relative. Ne pas y être vigilant conduirait, certes, à se rendre aveugle à certains des mécanismes parmi les plus efficaces de pénétration des existences par le capitalisme. Mais lui octroyer une attention exclusive et nous voilà sourds aux sirènes qui nous alertent plutôt sur les processus généraux qui prévalent à la raison d’être de ces essors technologiques et à l’intérêt de leur rendement au sein des différentes sphères sociales. Les champs d’application du numérique, toujours plus nombreux tendent à diffracter ses remises en cause en indexant celles-ci à des « localités » ayant leurs propres règles du jeu et, ainsi, font finalement prévaloir des logiques d’aménagement et de compromis sur de possibles logiques de récusation plus globale. Une critique conséquente du caractère technologique de notre être-au-monde nécessiterait, d’une part, de penser dialectiquement les fins et leurs moyens – les unes et les autres étant enchâssés dans des dispositifs de justification réciproque –, d’autre part, de tirer toutes les conséquences utiles liées au fait que les rapports au numérique sont indexés à des sens pratiques socialement déterminés et, enfin, de considérer que le numérique renouvelle les ressorts de la domination en agissant peut-être plus directement et plus largement sur le guidage des conduites que ne le faisaient les technologies antérieures.