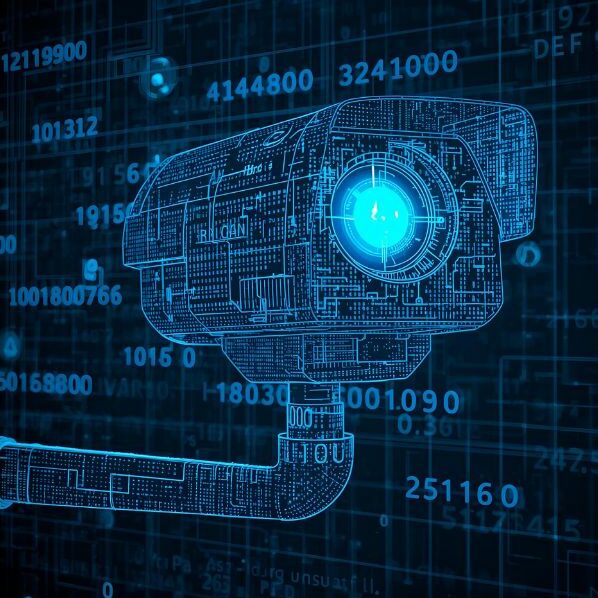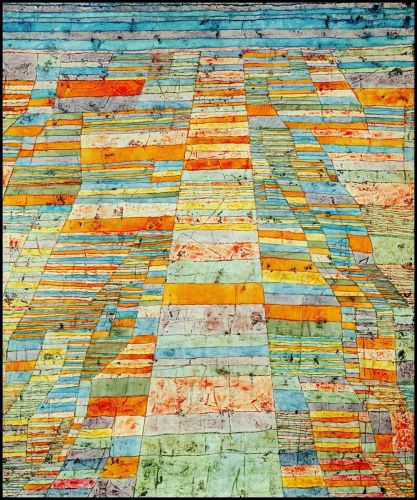Entretien — L’université au pied du mur — Révolution permanente
Révolution Permanente ___ Quel est ton sentiment sur la période actuelle et la place de l’université en son sein ?
Fabien Granjon ___ Avec le mouvement contre la loi « Travail », celui des Gilets jaunes et, aujourd’hui, la mobilisation pour les retraites, la France traverse, depuis 2016, une ample séquence de conflictualité sociale à laquelle le monde universitaire a fort diversement pris part. Quand elles se sont mobilisées, les universités l’ont été pour l’essentiel du fait de l’initiative des étudiant.e.s et la proportion des personnels engagés, administratifs et enseignant.e.s-chercheur.e.s, est toujours restée modeste. Pourtant, les mécontentements dus aux politiques de casse des conquis sociaux menées par les gouvernements consécutifs dans différents secteurs sont du même tonneau que les mesures successives de mise à mal du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche : la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, le dispositif Parcoursup, la mécanique Bienvenue en France, etc. Si la sphère universitaire n’a pas été atone face à ces mesures, elle n’a pas non plus fait montre d’un dynamisme remarquable. Aussi, les politiques « de réforme » continuent à aller bon train. La deuxième vague de création des Écoles universitaires de recherche dans le cadre des « investissements d’avenir » ratifie, un peu plus encore, l’idée d’un enseignement supérieur à deux vitesses ; l’instauration de la rupture conventionnelle pour la fonction publique (le décret est entré en vigueur le premier janvier 2020) va dans le sens d’une flexibilisation et d’une précarisation des carrières ; quant à la Loi de programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR), elle étend les principes de concurrence généralisée et de performance, censés être la grande leçon donnée par le privé au public et la condition sine qua non d’une recherche « hautement compétitive ». Je ne reviens pas dans le détail sur la LPPR, le travail de contre-expertise a été parfaitement effectué par nombre de collectifs, mais entre autres choses, elle entérine une amplification de l’évaluation et de la compétition par la modulation des services et des traitements individuels, lesquels, en tout état de cause, devront être adaptés à la « réalité du métier », c’est-à-dire aux situations concrètes d’exercice, ce qui ne laisse guère de doute sur la direction que prendra l’adaptation des obligations de service. L’approfondissement de l’autonomie et la logique d’excellence sont des machines managériales discrétionnaires de production d’inégalités, ou, comme ils disent, de la « gestion de la diversité », qui contenteront sans doute quelques « premier.es de cordée » académiques, mais floueront la très grande majorité des enseignant.e.s-chercheur.e.s. La recherche deviendra alors un privilège accordé par un cénacle de managers qui ne seront pas tou.te.s des pairs, loin s’en faut, lequel aura la haute main sur les parcours professionnels, les infléchissements de carrière et les préséances locales (promotions, primes, sanctions), favorisant encore un peu plus les logiques de népotisme, d’allégeance et de docilité.
RP ___ Tu déplores une sorte de prudence coupable de la part des universitaires ?
FG ___Je déplore le fait que la LPPR n’est que le prolongement logique de mesures qui ont été déployées, à bas bruit, depuis des années et par rapport auxquelles, les universitaires n’ont que très faiblement réagi dans la mesure où certain.e.s d’entre eux.elles y ont vu une manière de se placer, d’en tirer des avantages, des subsides, etc. Il fallait être aveugle pour ne pas voir que les Labex et autres « Deus EX machina » étaient des machines à évaluer et à précariser qui, pour les besoins de leur mise en acceptabilité, ont pu être présentées comme de copieux gâteaux à se partager. Sauf que tout le monde n’est pas invité à la table et ceux.celles qui s’y sustentent ne sont pas ceux.celles qui font le service. Les primi piattide la tambouille libérale ont contenté les carriéristes et les narcisses ambitieux.ses qui considèrent l’université comme une structure d’opportunités susceptibles de participer de leur splendeur. On en trouve du côté des hauts personnels administratifs, mais on les rencontre surtout dans les rangs des enseignant.e.s-chercheur.e.s raccordé.e.s au « tout à l’égo », lesquels prennent l’université pour un bassin de décantation de leurs excrétions narcissiques. L’homo econo-acade-micus de l’ère macronienne, DRH de son auto-petite-entreprise a pour caractéristique d’agir principalement pour infléchir positivement sa trajectoire professionnelle en termes de traitements et/ou de reconnaissance sociale. Il s’agit par exemple, pour lui.elle, de faire enfler son curriculum vitae qui consignera la moindre de ses activités, même la plus anodine,de faire bedonner son capital symbolique en se montrant toujours compatissant.e et prêt.e à soutenir la hiérarchie, c’est-à-dire se trouver en appui de celles et ceux qui, en retour, espère-t-il.elle, sauront le.la rétribuer à hauteur de son « sincère » soutien : primes, congés de recherche, avancements, allocations, aides à la publication, etc.
Ces années pré-LPPR et leur lot de « bidulEX » ont invité, un peu plus encore, les universitaires (qui n’en avaient pourtant guère besoin) à jouer des coudes et à gérer leur entreprise d’élévation personnelle par l’affirmation de leurs « singularités ». Et, sans surprise, ça fonctionne plutôt bien dans un milieu où les places sont chères et les possibilités somme toute restreintes. La précarité et la concurrence accrue ne produisent pas que des renoncements, elles créent également, chez celles et ceux qui ont réussi à intégrer le champ, des défiances exacerbées et un « ordre moral »qui ne vise pas tant à dé-hiérarchiser la sphère universitaire, qu’à la subordonner à la mesure de leurs soifs carriéristes selon le principe de ce qu’Yves Michaud nomme la « générosité du Moi d’abord ». Il ne s’agit pas de rééquilibrer les positions et les légitimités d’un champ au nom de principes de justice ou d’un commun à construire de concert, mais de s’arroger celles qui leur permettent d’exercer ce fameux « pouvoir » qu’ils.elles décrivent tour à tour comme diffus et/ou concentré, selon ce qui les arrange à un moment ou à un autre.
RP ___ Quelles conséquences sur le mouvement actuel ?
FG ___Force est de constater que la majorité des universitaires fait montre d’un engagement, disons… mesuré, notamment quant à la nécessité de faire grève. On ne peut évidemment généraliser, mais il semble que plus les collègues estiment appartenir, pour parler comme Weber, à un groupe de statut bénéficiant d’un certain prestige social, plus ils.elles rechignent à entrer pleinement dans le mouvement. L’un des arguments qui révèle cette prudence coupable comme tu dis, c’est, par exemple, celui maintes fois entendu, quant à cette supposée forme de résistance qui consisterait à surtout ne pas faire grève et à maintenir les cours, lesquels seraient ce que nous aurions de mieux à offrir aux étudiant.e.s dans la période actuelle. J’y vois là une forme de populisme paternaliste, mais également l’expression d’un égotisme car, évidemment, ce qui est important dans le maintien du « business as usual », ce sont moins les cours que le statut de celui ou celle qui les dispense. Or dans cette séquence de luttes, il est évident que les « sachants » auraient beaucoup à apprendre de celles et ceux, à commencer des étudiant.e.s, qui se mobilisent. L’entretien filmé que vous avez récemment fait de Yohan Sepolni illustre parfaitement ce point. Entre la grève par procuration – laissons la plèbe bloquer le pays – et la non grève par distinction – ne laissons pas nos ouailles sans nos lumières –, le cœur de l’université balance. Le collègue rappelle, à juste titre, qu’il y a comme un mépris de classe qui s’exprime parfois dans ces postures, notamment quand elles font fi des mobilisations d’autres catégories de personnels au sein de l’alma mater(Biatss et étudiant.e.s) qui, elles, se battent pour se sortir de conditions d’existence précaires, voire miséreuses. L’ordinaire universitaire, il faut le rappeler, c’est aussi des personnels avec de très petits salaires à qui l’on refuse une augmentation ou un coup de pouce pour les repas, tandis que des primes parfois mirobolantes sont octroyées à d’autres qui pourraient pourtant s’en passer. L’indécence sociale du libéralisme qui creuse les inégalités, encense les « premiers de cordée » et fustige les « premiers de corvée » est aussi le monde de l’Université.
La tribune publiée ces derniers jours par le collectif des précaires de l’ESR en Île-de-France est également parfaitement clair à ce sujet puisqu’ils.elles en appellent à l’arrêt total des activités administratives, d’enseignement et de recherche au motif qu’on ne « soutient » pas la grève : on la fait ou on l’empêche. Le ballet des motions de laboratoires, de revues, de départements, d’UFR, etc. révèle certes une prise de conscience de la communauté quant à l’avenir que nous réserve la LPPR, y compris chez les « bâtisseurs d’empire » dont nous parlions tout à l’heure et qui ont peur de devenir, à leur tour, les Schmürz de l’affaire, mais à y regarder d’un peu près, nombre de ces expressions sont assez frileuses. Quel sens cela peut-il avoir, à ce stade, d’en appeler à la vigilance ou de se dire « inquiet.e.s », dans un réflexe corporatiste ouaté, sans même penser nécessaire de devoir évoquer les personnels les plus précaires de l’ESR et la réforme des retraites ? Certaines de ces motions sonnent comme de splendides isolements statutaires, y compris dans les rangs de la supposée critique. Certaines radicalités de campus qui se vivent pour l’essentiel dans le confort des théoricismes amphigouriques et la chaleur des bibliothèques ne sont pas spécialement enclines à s’engager promptement au sein du mouvement, si ce n’est par ces contributions a minimaet n’entendent évidemment pas faire grève.
RP ___ Et du côté des Présidences des universités ?
FG ___Je n’ai pas une vue d’ensemble de la chose, mais force est de constater que, grosso modo, les prises de position sont, au mieux, pour le moins timides. L’idéologie macroniste, le « ni droite ni gauche », la vision jupitérienne d’une « élite » au pouvoir qui, élue, décide pour tou.te.s sans avoir à en rendre de compte à qui que se soit, sont des topiques qui ont bien infusé au sein des universités. Elle est la pensée dominante chez les bureaucrates patenté.e.s porteurs de ce que Pierre Bourdieu qualifiait de « capital scientifique politique », qui doivent à peu près tout à l’appareil institutionnel et qui portent des attentes et des intérêts personnels congruents avec ceux de l’institution qui les protège et leur apporte le statut qu’ils.elles ne pourraient obtenir autrement. Ces apparatchiks académiques se distinguent généralement par un éloignement caractérisé de la recherche qui, chez les plus culpabilisé.e.s, cherche à être comblé par un investissement, décrit par leurs soins comme extrêmement prenant, dans certaines charges et responsabilités administratives dont ils se servent comme d’une caution pour justifier leur désertion de la mission originelle qui est pourtant la leur : celle de devoir produire des connaissances. Ils sont évidemment les premiers à se gonfler d’être des intellectuels, à défendre ladite recherche et à déclarer vouloir la réussite des étudiant.e.s. Mais, dans les faits, ils n’hésitent jamais à jouer la carte de l’inertie, de la routine pédagogique, à rejeter toute proposition novatrice, à mettre à mal la formation par la recherche, ainsi qu’à vilipender celles et ceux qui y prennent réellement (leur) part, surtout quand ces dernier.e.s leur apparaissent comme d’agités « hérétiques » remettant en cause les logiques prévalant au maintien des règles du jeu (illusio, hiérarchies, légitimités, places, avantages, etc.) sans lesquelles ces bureaucrates seraient bien nu.e.s.
Bref, ce n’est certainement pas du haut et des appareils de gouvernance que viendra l’aide nécessaire à la construction d’un mouvement social gagnant, y compris au sein même du champ. Cela dit, il existe des « styles » de gouvernance et d’accompagnement des luttes sensiblement différents. À l’Université de Rennes 2 où j’interviens en tant que chargé de cours, le Président fait opposition aux forces de l’ordre qui veulent rentrer sur le campus, balise les journées de mobilisation nationale pour que les personnels et les usagers de l’université puissent manifester sans contrainte, participe lui-même aux cortèges, reporte les examens et son conseil d’administration de prendre explicitement position contre la réforme des retraites. À Paris 8, la situation est autre. La Présidence ne souhaite pas prendre position, en appelle à une gestion « intelligente » du conflit et entend prendre en compte la diversité des points de vue de la communauté. Autrement dit, il s’agit de ne surtout pas se mouiller. Quant aux rapports aux forces de l’ordre…le directoire de Paris 8n’a pas hésité, en 2018, à livrer à la préfecture plus d’une centaine de migrant.e.s réfugié.e.s dans les locaux de l’université. Avec leurs soutiens ils.elles ont sans doute crû à la promesse mensongère d’une régularisation massive dont il leur avait été précisé qu’elle devait se dérouler en catimini. Mais le « deal » s’est vite transformé en guet-apens : examen des situations individuelles, tris des « bons migrants » susceptibles de demander le droit d’asile et des « mauvais migrants » dublinisés qui devaient donc quitter le territoire et, finalement, une évacuation de l’université dans la violence.
RP ___ Pourtant, Paris 8 est l’héritière des expériences vincennoises et entend défendre cet héritage.
FG ___Paris 8 est effectivement l’héritière du Centre universitaire expérimental de Vincennes (CUEV), institution créée dans le sillage de mai 1968 pour conglomérer, à l’écart de Paris, les tenants d’une pensée critique radicale. Elle a fêté dernièrement son cinquantenaire, qui, de mon point de vue, fut à bien des égards l’expression formatée d’un marketing académique qui ne dit pas son nom. Ce jubilé a été l’occasion de rappeler, somme toute assez paresseusement, ce qu’est censé être l’esprit vincennois, dont on nous dit, avec une conviction toute publicitaire, qu’il irriguerait toujours Paris 8. On peut, bien évidemment, continuer à se réjouir d’un riche héritage en prenant la pause, mais à y regarder de plus près, le legs, pourtant estimable, n’est pas franchement assumé. Il nourrit surtout un simulacre. Si le cœur critique du CUEV bat encore au sein du corps universitaire dionysien, force est de constater qu’il n’est pas sans montrer quelque signe de bradycardie. La pensée critique telle que mise en avant dans le cadre de ces festoyances forcées ne semble plus guère habitée. Elle n’est devenue, à certains égards, qu’une vulgaire étiquette servant à singulariser l’institution sur le marché de l’enseignement supérieur.
RP ___ Selon toi, quelles sont les raisons de ce jeu de dupes ?
FG ___Il y a, je crois, concernant la période présente, deux raisons susceptibles d’expliquer la présence accrue de ces formes de duplicité : l’une interne et l’autre externe. La raison endogène tient au fait que la sphère académique est un champ au sein duquel les procès de catégorisation et la construction symbolique des faits se révèlent d’une grande importance. Ce sont des opérations nécessitant une certaine maîtrise du langage dont les plus cyniques n’hésitent pas à se servir pour construire des discours d’accompagnement et de mise en acceptabilité de leurs renoncements et de leurs activités de substitution, ou bien, pour d’autres, afin de construire leur plan carrière. Par ailleurs, le paradigme constructionniste qui irrigue nombre des modèles d’analyse contemporains en sciences sociales a, certes, permis d’importantes avancées heuristiques, mais il sert aussi de terreau et de caution à des travers que Renaud Garcia a fort bien consignés dans son ouvrage LeDésert de la critique et dont l’un des traits principaux relève de cette tendance fictionnelle à estimer que la réalité étant erratique, elle n’aurait finalement que la consistance des interprétations que l’on en fait et pourrait même se réduire aux constructions symboliques dont elle est l’objet. Bref, la réalité serait, pour l’essentiel, une affaire de points de vue, de pouvoir s’incarnant dans des jeux de langage et des chaînes de significations et d’équivalence.
La raison exogène, parfaitement en phase avec ce dévoiement du constructionnisme, me semble tenir à un « air du temps » qui tend àfaire des vérités factuelles un encombrement dont il s’agit de se défaire, notamment pour celles et ceux dont le seul objectif est d’exercer un pouvoir dont ils/elles semblent ne vouloir se passer. Les universités n’échappent pas à ces penchants falsificateurs du pouvoir, aux contre-vérités fallacieuses et à une novlanguequi essaie de faire passer des vessies idéologiques pour des lanternes critiques. D’évidentes opérations de confiscation de la démocratie peuvent ainsi, sans ciller, être présentées comme une autre manière de faire du commun, une référence en matière de participation et d’émancipation citoyenne, ou encore relever de l’inventivité d’une démocratie créative. Aussi, la réalité tend à disparaître dans le marigot des discours mensongers qui déplacent les arbitrages utiles sur les faits vers des guerres d’interprétation portant sur des régimes de légitimité qui, à la moindre déstabilisation, se crispent sur l’institué qui les fait exister, c’est-à-dire le pouvoir institutionnel. On ne peut, par ailleurs, que souligner combien ces chausse-trapes langagiers vont à l’encontre de l’éthique objectivantede la science censée faire coïncider les discours tenus sur les faits étudiés et la réalité de ces faits, réalité dont il est entendu qu’elle ne peut être qu’une vérité relative. Si évidemment, la politique universitaire n’est pas la science, il reste que le factice des combines discursives est une arrogance qui est aux antipodes de l’ontologie minimale sur laquelle se construit la factualité scientifique.
RP ____Quel rôle peuvent jouer les étudiant.e.s et la jeunesse dans la séquence présente ?
FG ____La première chose à souligner tient au fait que l’embarras du milieu universitaire vis-à-vis de la grève ressemble à un renoncement, voire à une défiance, laquelle provoque notamment des tensions avec les étudiant.e.s, plus disposé.e.s à s’investir et prendre leur part à la conflictualité sociale, élan qui se voit, parfois, dénoncé comme un spontanéisme juvénile. Or il me semble évident que les enseignants-chercheurs doivent aujourd’hui faire en sorte de faciliter l’entrée des étudiant.e.s dans le mouvement social, lesquels estiment, pour une part, que les retraites sont une chose bien lointaine et, pour une autre part, que la mobilisation, globalement aux mains des centrales syndicales et des intersyndicales, ne répond guère à leurs aspirations d’autonomie et d’auto-organisation. Comme l’a justement remarqué Oskar Ambrepierre dans une contribution que vous avez publiée il y a quelques jours, il est pourtant nécessaire d’ouvrir une brèche pour le mouvement étudiant, et d’encourager la jeunesse à se mobiliser, jeunesse qui aurait bien des raisons d’y aller bille en tête, car le monde qu’on leur promet ressemble à une terrible dystopie : le niveau de vie qui ne cesse de baisser, le rendement décroissant des diplômes, la précarité, la ségrégation, le changement climatique, l’autoritarisme gouvernemental, etc. L’avenir n’a, hélas, rien de chatoyant. Une grève conséquente de l’Université encouragerait, sans aucun doute, les secteurs de la jeunesse, lycéens et étudiants, à s’engager dans la bataille. Sans eux, nous n’arriverons vraisemblablement pas à construire un rapport de force gagnant. Aussi, des demi-mesures symboliques il va falloir passer rapidement aux engagements concrets, dont la grève me semble être l’élément premier. À cet égard, je souscris entièrement à la motion de la coordination nationale des facs et des labos en lutte qui s’est réunie les 1eret 2 février à Saint-Denis. La mise en place d’une grève réelle et effective est indispensable.