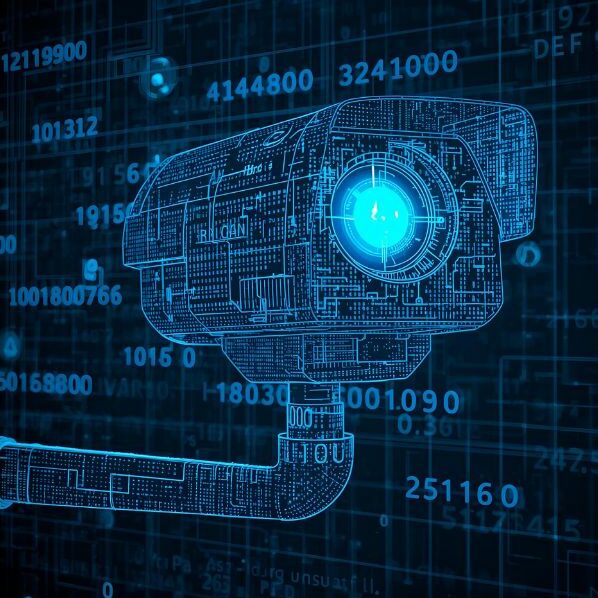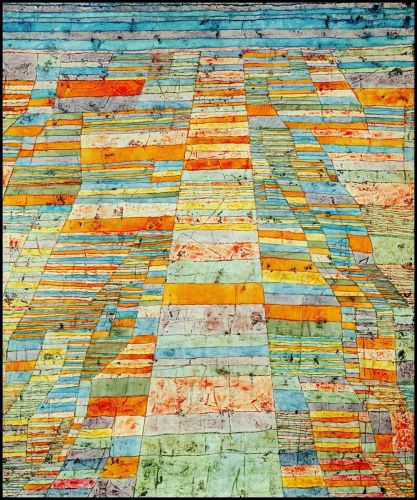Article – Inégalités sociales-numériques et rapports Nord/Sud – Questions internationales
Le numérique est largement présenté comme la solution à de nombreux maux, notamment ceux dont les pays « les moins avancés » souffrent. Aussi, semble-t-il urgent de combler la « fracture numérique » sur ces territoires, à qui l’on promet alors un meilleur développement. Or derrière ces injonctions à épouser au plus vite la modernité technologique et à atteindre la « connectivité universelle » se trouvent des nécessités qui s’avèrent moins celles des pays du « Sud global » que celles du capitalisme occidental. Toutefois, l’idée d’un numérique fondé sur des valeurs environnementales, de justice sociale et un rééquilibrage des rapports de force géopolitiques, est une exigence que l’on ne saurait abandonner.
La « fracture numérique » dite « globale » (global digital divide) décrit les dynamiques inégalitaires correspondant aux différentiels de pénétration des technologies numériques, entre pays, continents ou d’autres formes de zones géographiques (e.g. Maghreb, Afrique sub-saharienne, Amérique centrale, etc.) ou de blocs géo-politico-commerciaux (CEDEAO, BRICS, tigres asiatiques, etc. – Perkins, Neumayer, 2011). Les travaux cherchant à mettre en lumière ce type de phénomènes sont fort nombreux, s’appuient sur des méthodologies variées, portent sur des objets dissemblables (infrastructures, matériels, usages, etc.) et développent des approches théoriques fort diverses (Ragnedda, Gladkova, 2020 ; Ragnedda, Muschert, 2014 ; 2019). Les recherches universitaires côtoient par ailleurs les rapports des institutions internationales, les expertises de think tanks et les analyses d’ONG. Aussi est-il difficile de dresser un bilan synthétique de ces travaux. Soulignons, ici, que les approches les plus problématisées sont souvent celles qui sont les plus critiques et qui tendent à relativiser les bienfaits de la numérisation à marche forcée de toutes les sphères de l’existence (familiale, professionnelle, des loisirs, etc.). Force est en effet de constater que la plupart de ces travaux, pourtant censés objectiver des inégalités, ne s’appuient que rarement sur des théories de la justice sociale ou de la domination. Pour l’essentiel, ils se contentent de décrire des écarts d’équipement ou de pratiques, et de rendre compte des expériences supposées apporter quelque preuve quant aux effets du numérique. Aussi préférons-nous parler d’inégalités sociales numériques (Granjon, 2022), afin d’insister sur le fait que ce qui est précisément qualifié de « numérique », ne saurait seulement relever d’une dimension technique, mais relève de faits sociaux, culturels, économiques, politiques, etc. (Wessels, 2014). La « fracture numérique » en tant qu’elle est alors envisagée comme conséquence d’inégalités qui en définissent la nature ne peut donc être redevable d’une lecture simplement graduelle des taux d’équipement, des durées, fréquences et types de pratique, mais doit également s’intéresser aux utilités/torts concrets découlant des (non-)usages[1]. Toutefois, force est de constater que la grande majorité des travaux prenant pour sujet la global digital divide portent encore, pour l’essentiel, sur les dynamiques de pénétration et d’accès du/au numérique sur les différents territoires envisagés et sont le plus souvent attentifs aux nations qui tendent à se rapprocher des pays les plus économiquement développés (e.g. les BRICS plutôt que les pays dits « les moins avancés » – PMA) .
Global digital divide
Sous cet angle, les études menées tendent à faire correspondre niveau de développement socioéconomique et niveau d’usage du numérique, à montrer comment l’un et l’autre se nourrissent mutuellement et à souligner les correspondances entre volontarisme étatique et situations nationales (Mutsvairo, Ragnedda, 2019). Selon des statistiques de l’ONU (2022), un tiers des habitants de la planète situé pour l’essentiel dans les PMA n’a toujours pas accès à Internet et le rythme de développement des connexions s’est ralenti, notamment celui du téléphone mobile qui participait jusqu’alors du « miraculeux décollage » africain. L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) considère qu’il s’agit là d’un amenuisement qui pourrait signer une situation durablement « problématique » pour le « Sud global » (Mahler, 2018), et plus particulièrement pour le continent africain et l’Asie de l’Est et Pacifique. Quand les pays les plus riches progressent dans la réduction des inégalités sociales-numériques, les pays les plus pauvres prennent, eux, du retard selon les indicateurs mis en place par les organisations internationales. Outre les déficits d’infrastructure et d’équipement, cette temporisation dans la « numérisation du monde » tient également à une série d’autres facteurs de natures sociale, culturelle, linguistique, compétentielle, politique et évidemment économique. Les inégalités sociales-numériques se distribuent en effet sur une série de variables liées à l’aménagement territorial (au niveau des pays, des régions, etc.), au genre, à l’âge, au groupe ethnique, au niveau de diplôme, à l’appartenance sociale, etc. (Williams, 2022 ; BM, 2016 ; Chinn, Fairliey, 2007). À l’échelle internationale, on observe ainsi de flagrantes disparités, par exemple quant aux taux de pénétration d’Internet entre les pays à faible revenu (22 %) et ceux à revenu élevé (91 %), entre les zones urbaines et les zones rurales (les premières comprenant deux fois plus d’usagers), entre les hommes (62 % utilisent Internet) et les femmes (57 %), entre les populations les plus jeunes (71 % des 15-24 ans sont connectés) et celles plus âgées (57 %)[2]. Les rapports sur le développement dans le monde à l’initiative de la Banque mondiale identifient bien que se sont « les défis qui se posent traditionnellement au plan du développement [qui] empêchent la révolution numérique d’engendrer des transformations profondes » (2016 : v), rappelant, par là même, que ce sont bien les inégalités sociales etéconomiques qui sont au principe des inégalités numériques, mais réaffirment en même temps la primauté donnée au fait technologique comme levier de développement, dans un rhabillage contemporain des théories diffusionniste du rattrapage – le développement technologique conduirait quasi mécaniquement au progrès social.
À cette aune technosolutionniste, les inégalités (de développement) sont alors considérées non plus comme les causes, mais comme les conséquences des rapports que les PMA entretiennent à la chose numérique. Leur supposé « retard » vis-à-vis de la modernité mondialisée en vient à se résumer à une déréticulation, c’est-à-dire à une décohésion d’un système technique qui devient la totalité organique à partir de laquelle est censée s’organiser la connexion qui, en l’espèce, est appréhendée comme ce qui permet le fonctionnement du tout et assure sa reproduction. La lutte contre la global digital divide vise alors à réintégrer les potentiels inemployés des Suds dont on craint toujours qu’ils puissent perturber le système ou, à tout le moins, désoptimiser son rendement. Les PMA sont donc envisagés comme ayant vocation à être rétablis dans leur utilité minimale au monde de l’économie numérique (McChesney, 1997). Sous cet angle, les singularités nationales-régionales s’effacent pour laisser place à la figure de territoires qui se définissent d’abord comme des entités porteuses d’un niveau de performance minimal, disposées à leur intégration à une configuration sociotechnique hégémonique, déterminant leur participation continue à l’activité productrice et de consommation, normalisant leurinscription dans les standards occidentaux d’existence et assurant finalement leur intégration à l’économie mondialisée (Moyo, 2019).
De fait, les institutions internationales, les principaux traités commerciaux (RCEP, TPP, ALENA, etc.) et les cabinets conseil internationaux (McKinsey produit par exemple un « index de connectivité globale ») promeuvent le développement d’une « connectivité universelle[3] » (ITU, 2022). Les pays du Nord, sous l’égide des États-Unis, soutiennent, au sein d’une étonnante Déclaration sur l’avenir de l’Internet[4] (2022), l’idéal d’un Internet « ouvert, libre, mondial, interopérable, fiable et sécurisé » ; pétition de principe qui, tout en galvanisant les « libertés numériques », « les droits de l’homme » et « une prospérité économique équitable », semble surtout devoir satisfaire aux nécessités renouvelées du free flow of information[5] et de son corollaire : un expansionnisme économique s’appuyant notamment sur un renforcement de la concurrence, une « amélioration [du] climat des affaires » (BM, 2016 : v), la non- ou dé- réglementation, et le développement des partenariats public-privé (Gurumurthy, Bharthur, 2020). Aussi n’est-il pas étonnant de constater que les plus importantes initiatives de « lutte contre la fracture numérique » au niveau mondial sont portées par des géants du numérique qui voient parfaitement les avantages qu’ils pourraient tirer à augmenter le volume d’usagers[6] et d’informations produites par ces dernires. Alliée au marché, l’informatique connectée est présentée comme la panacée universelle, synonyme de progrès, d’égalité et de démocratie : « En favorisant l’inclusion, l’efficacité et l’innovation, la technologie permet aux populations pauvres et défavorisées d’accéder à un monde de possibilités auparavant hors de portée » (BM, 2016 : v). Le comblement des « fractures numériques » vise donc, in fine, à « renforcer la productivité », à produire des « dividendes », à « doper la croissance », à générer des profits, mais aussi à renforcer le contrôle social nécessaire au bon déroulement des affaires, à l’instar de la période épidémique liée à la COVID-19, durant laquelle les populations ont largement été assignées à résidence et les géants du numérique d’engranger à cette occasion des bénéfices records[7].
Les enseignements de l’épidémie de COVID-19
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 s’est accompagnée de confinements nationaux et d’un impératif de distanciation sociale qui a construit le numérique comme la solution technique permettant le maintien de nombre d’activités. Le télétravail, l’enseignement à distance, la vente en ligne, l’e-santé, etc. sont des domaines par rapport auxquels la crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur des logiques de « dématérialisation » qui les traversent. Au sein de certains pays de l’OCDE, on a ainsi pu constater une augmentation du trafic Internet allant jusqu’à +60 % (OCDE, 2020). Sans surprise, les inégalités sociales-numériques se sont alors creusées au sein même des populations nationales et entre ces dernières. Plus le recours aux technologies numériques d’information et de communication (TNIC) devient un impératif – i.e. sans alternative – et plus on constate un creusement des inégalités sociales liées à une distribution asymétrique des capabilités concrètes, c’est-à-dire des capacités à tirer de réels avantages des usages du numérique : « les individus disposant de niveaux de compétences et de revenus plus élevés faisant un meilleur usage d’internet et des activités en ligne [sont] plus à même d’accéder aux connaissances, aux offres d’emplois et aux services de santé et d’éducation » (OCDE, 2021 : 3). La crise sanitaire a ainsi participé au développement d’un numérique de plus en plus excluant (vs. un numérique inclusif), que celui-ci soit envisagé sous l’angle des infrastructures (haut débit, 5G, blockchain, big data, IA, etc.), des usages, ou des externalités et des potentiels positifs susceptibles d’en découler. Au sein des pays où la connectivité est tributaire de la présence physique, par exemple du fait de la nécessité d’achat de cartes SIM et d’offres prépayées, la numérisation accrue des activités s’est clairement trouvée au principe d’un creusement des inégalités.
L’UNICEF avance par exemple qu’un tiers des élèves dans le monde n’a pas eu accès à l’enseignement à distance durant la pandémie[8] et sur le continent africain, « seul un étudiant sur dix disposait d’un ordinateur ou d’un accès à l’internet à son domicile » (Fafunwa, 2021 : 3). Mais il est aussi des pays où certains services éducatifs ou de santé ont rencontré de francs succès, notamment grâce à de bonnes couverture et accessibilité des/aux services mobiles. Si ces réussites tendent à montrer, par exemple, qu’un « numérique africain » est de facto possible, il faut néanmoins souligner que la majorité des investissements de la « tech » africaine porte aujourd’hui sur les secteurs financiers et les services d’argent mobile[9] (paiement de facture, crédit, transfert d’argent, etc.). La « fintech » (on parle également d’« inclusion financière ») est un domaine dans lequel l’Afrique a été pionnière et que les cabinets de conseil internationaux envisagent comme un secteur particulièrement « attractif » (i.e. rentable) dans un environnement peu bancarisé où le marché est encore loin d’être saturé. Les entreprises occidentales ne s’y sont d’ailleurs pas trompées, à l’instar des entreprises Wave ou Vodafone (actionnaire principal de la société kényane M-Pesa), start-up californienne et opérateur téléphonique britannique qui, dans le champ du mobile money se sont taillé de considérables parts de marché en Afrique.
Car l’épidémie de COVID-19 a aussi été l’occasion de pratiques agressives visant à imposer de nouvelles règles commerciales, à libéraliser les systèmes de paiement en ligne et à faciliter l’exploitation des data émanant des pays du Sud. Les pays du Nord et leurs acteurs majeurs de l’économie numérique ayant d’importantes capacités d’implantation, d’exportation et d’offre de contenus ont cherché à gagner des parts de marché au détriment de la souveraineté numérique des États des PMA et de leur possibilité attenante de développer des plateformes nationales pouvant créer, à terme, de la valeur (UA, 2020). Les difficultés rencontrées par certains de ces pays à relever le défi pandémique en s’appuyant sur le numérique les ont en effet incité à réduire les contraintes pesant sur les investissements étrangers et les réglementations en ce domaine, afin notamment de pallier les manques infrastructurels, et ce, quitte à perdre des marchés qui auraient pu être construits pour leurs propres profits (Kwa et al., 2020) et à renforcer l’hégémonie économique des firmes transnationales les mieux implantées (CNUCED, 2019).
Impérialisme et néo-colonialisme ?
À l’ère du capitalisme de surveillance (Zuboff, 2020), l’exploitation massive des données (big data) est, il est vrai, devenue le nerf de la guerre économique numérique. Et mettre la main sur cette manne informationnelle revient à s’arroger des avantages concurrentiels notoires[10] et à rendre dépendantes les populations aux plateformes qui ont les moyens de les exploiter. Les GAFAM et autres géants du numériques n’ont de cesse de renforcer leur position dominante dans la chaîne de valeur mondiale des données et d’aucuns avancent, à cet égard, l’idée d’un néo-impérialisme qui, sous couvert de politiques d’aide au développement et de programmes humanitaires numériques, vient grever la souveraineté des nations du Sud et leur droit à l’industrialisation numérique (Pinto, 2020). En marge de l’édition 2019 de l’Internet Governance Forum, a par exemple été rédigé par les militants de la Just Net Coalition (un réseau d’organisations fondé à Delhi en 2014), un Manifeste pour une justice numérique[11]. Celui-ci pointe, entre autres choses, les droits de propriété et les conditions de circulation transfrontalière des data largement défavorables au « Sud global », dénonce la mainmise des acteurs privés sur la technostructure, fustige les échanges inégaux et l’affaiblissement des États qui en découlent et réclame un modèle de gouvernance plus démocratique « allant du local au global » (autodétermination), en contravention avec à l’intégration commandée du plus grand nombre à la « société digitale » et au régime d’accumulation qui lui correspond.
Ce nouvel élan impérialiste trouve également à se déployer dans une division internationale du travail visant à surexploiter la force de travail des populations des PMA. Car les forces productives du secteur numérique ne sont pas seulement constituées de new men of power, d’ingénieurs et de manipulateurs de symbole, mais elles ont aussi besoin d’un salariat d’exécution peu qualifié (au nombre duquel, des enfants, des femmes et des membres de minorités ethniques), que les pays du Sud fournissent à des coûts prohibitifs[12], tandis que leurs ressortissants les plus diplômés peuvent, eux, être tentés d’aller travailler dans les pays du Nord. Outre les ouvriers travaillant, souvent dans des conditions déplorables, dans les mines, dans les usines d’assemblage en bout de chaîne de la sous-traitance, dans les entreprises de recyclage, etc., l’industrie numérique mondialisée et l’économie des plateformes ont aussi fait émerger un travail numérique subalternisé, reposant sur l’exécution de micro-tâches taylorisées (gig work : taggage, modération, tris, annotation, vérification de requêtes, etc.). Ces nouvelles formes de tâcheronnat que certains États voient comme une bonne occasion de réduire le chômage, reposent sur des rémunérations très faibles, une protection sociale inexistante et un droit des travailleurs peu respecté (Onkokame, et al., 2020).
Certains auteurs développement, de surcroît, l’idée d’un néo-colonialisme numérique (Kwet, 2019 – d’aucuns parlent même de « digital apartheid » – Moyo, 2019) qui, outre son hégémonie sur la production, circulation et consommation des biens numériques (objets, logiciels, contenus, services, etc.) viserait également à maintenir une superstructure idéologique défavorable aux population des PMA. Du point de vue de ces dernières, une fois conscientisées au problème, les inégalités sociales-numériques devraient moins tenir à des questions de classes, de sexe ou de compétences (digital literacy) qu’à des questions de culture, de rapports coloniaux et d’idéologie raciste. Dans cette perspective, le numérique est alors appréhendé comme une technologie d’assujettissement qui outre, le fait qu’elle permet d’exploiter le « Sud global » à des fins de profit, cherche également à le reconfigurer à sa main, en travaillant à lui faire oublier son histoire, ses imaginaires collectifs et ses identités ; domination culturelle qui est une des conditions de possibilité d’une domination économique efficace. S’appuyant sur les théories décoloniales de Ramón Grosfoguel (Grosfoguel, Castro-Gómez, 2007), Internet est alors conçu comme un outil qui instruit également une hégémonie épistémique en invisibilisant les voix, les langues et les visions du monde non occidentales, tout en construisant le « mythe du sauvage paresseux pré-numérique » (Jandrić, Kuzmanić, 2015 : 44), c’est-à-dire un discours de légitimation de l’impératif technologique : le numérique sauvera les populations de l’ignorance, du dénuement et des régimes dictatoriaux. Aussi, les inégalités sociales-numérique (de troisième niveau – i.e. portant sur les éventuels avantages à tirer de l’usage des TNIC) sont l’expression, dans le domaine du numérique, d’un système techno-idéologique qui tend à maintenir le « Sud global » dans un état de dépendance (i.e. une exclusion du pouvoir qui se tisse dans l’inclusion au système technique – Musa, 2019).
Numérique et environnement
À cela s’ajoute la question environnementale. Reposant sur des logiques extractivistes, d’exploitation et d’obsolescence, le numérique n’apparaît guère comme le levier de « développement durable » qu’une certaine doxa voudrait pourtant faire de lui. Grand consommateur d’énergie (environ 10 % de la consommation mondiale d’électricité dont la production par les PMA est plus impactante que celle du « Nord global »), il s’appuie également sur des secteurs industriels particulièrement pollueurs, dont celui de la fabrication des équipements (première dans la hiérarchie des sources d’impact) et de leur recyclage, activités qui sont surtout concentrées dans le Sud global. L’impact environnemental du numérique, largement nourrit des « émissions d’opulence » du Nord, ne cesse, de facto, de prendre de l’importance (Chen, 2020) : son impact carbone constitue à lui seul près de 4 % des émissions globale des gaz à effet de serre et cette proportion semble devoir augmenter au fil des années (de 6 % par an[13]). Celle-ci décrit une trajectoire à la hausse due à l’exploitation grandissante des ressources naturelles (minéraux, métaux, charbon, etc.), au développement des terminaux (une étude du réseau GreenIT estime à 34 milliards le nombre de terminaux numériques), à leur remplacement de plus en plus fréquent et à l’explosion d’usages (le trafic de données pourrait être multiplié par six d’ici 2030 selon l’ADEME – 2023[14]), notamment ceux qui sont les plus consommateurs d’énergie (vidéo, cloud, edge computing, IA, etc.). Par ailleurs, le quintuplement prévu d’ici 2025, du nombre d’équipements numériques risque fort d’« augmenter les tensions sur les matières premières et notamment renforcer le rôle des minerais dans le financement des conflits armés en Afrique et en Asie » (Bordage, 2019 : 20). Conséquemment, nous allons assister à la croissance constante des volumes de déchets d’équipement (e-waste – dont 20 % seulement sont recyclés), estimés à 317 millions de tonnes en 2025 (vs. 128 millions de tonnes en 2010 – l’« immatériel » est bel et bien formé de matière), et ce, en l’absence de normes environnementales cadrant cette activité dangereuse et polluante, participant notamment à la multiplication par plus de trois des émission de gaz à effet de serre sur la période 2010-2025.
*
Le thème de la global digital divide pose, en creux, des interrogation quant au bien-fondé de « l’impératif numérique » dans le cadre des rapports Nord/Sud : l’accès au numérique est-il une solution ou bien une partie du problème ? Faut-il développer un numérique alternatif, critique, contre-hégémonique – moins polluant, moins énergivore, open source, low-tech, etc. –, ou bien faut-il plus radicalement limiter la pénétration des TNIC et lutter contre son développement tous azimuts ? S’agit-il de combler coûte que coûte les inégalités sociales-numériques ou bien faut-il prioriser d’autres leviers de développement plus fondamentaux ? Le numérique est-il définitivement une lignée technique impérialiste du « Nord global », ou bien peut-il être, malgré tout, porteur de projets de développement « décolonisés » (Haffner, 2019 ; Moyo, 2019 ; Jandrić, Kuzmanić, 2015). Ces questions restent ouvertes, mais force est de constater que l’idée d’un numérique devant répondre à des valeurs environnementales, de justice sociale et à un rééquilibrage des rapports de force géopolitiques (SP, 2021 ; JNC et al., 2022) se fait de plus en plus pressante, notamment au sein du « Sud global »[15]. Les chemins qui pourraient transformer cette volonté de résistance et d’autonomie – qui trouve à s’exprimer dans des initiatives qui restent souvent locales – en des pratiques concrètes reproductibles et amplifiables, décentralisées et souveraines, et au service des populations parmi les plus défavorisées, restent largement à inventer. Néanmoins, il est certain qu’ils devront être ouverts sous une autre bannière que celles du global marketplace et de l’occidentalo-centrisme.
Bibliographie
BM, Rapport sur le développement dans le monde 2016 : Les dividendes du numérique – Abrégé, Banque mondiale, Washington, 2016.
Frédéric Bordage, Empreinte environnementale du numérique mondial, GreenIT, s.v., 2019.
Sibo Chen, « Immatérielle », l’expansion mondiale des TIC ? », Alternatives Sud, vol. XXVII, n° 1, 2020, pp. 105-117.
Menzie D. Chinn, Robert W. Fairliey, « The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis of computer and internet penetration », Oxford Economic Papers, n° 59, 2007, pp. 16-44.
CNUCED, Rapport sur l’économie numérique 2019, New York, United Nations Publications, 2019.
Tunde Fafunwa, « Le développement numérique de l’Afrique : préparer l’avenir numérique », in OCDE, Coopération pour le développement 2020, OCDE, Paris, 2021, pp. 1-7.
Fabien Granjon, Classes populaires et usages de l’informatique connectée. Des inégalités sociales-numériques, Presses des Mines, Paris, 2022.
Ramón Grosfoguel, Santiago Castro-Gómez, El giro decolonial : Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Siglo del Hombre, Bogota, 2007.
Anita Gurumurthy, Deepti Bharthur, « Ce que les acteurs du développement doivent savoir sur l’e-commerce », Alternatives Sud, vol. XXVII, n° 1, 2020, pp. 65-74.
John Haffner, « Critical infrastructures, critical geographies. Towards a spatial theory of the digital divide », in Massimo Ragnedda, Glenn W. Muschert, eds., Theorizing Digital Divides, Routledge, Londres, 2019, pp. 103-116.
ITU, Global Connectivity Report , 2022, ITU, Genève, 2022.
Petar Jandrić, Ana Kuzmanić, « Digital postcolonialism », International Journal on WWW/Internet, vol. 13, n° 2, 2015, pp. 34-51
JNC-APC-CETRI, Articuler les justices numérique et environnementale : un dialogue Nord-Sud, JNC-APC-CETRI, Bruxelles, 2022.
Aileen Kwa, Fernando Rosales, Peter Lunenborg, «COVID-19 and WTO: Debunking Developed Countries’ Narratives on Trade Measures », Policy brief, n° 77, 2020, pp. 1-12.
Michael Kwet, « Digital Colonialism: US Empire and the New Imperialism in the Global South », Race & Class, vol. 60, n° 4, 2019, pp. 3-26.
Anne G. Mahler, From the Tricontinental to the Global South: Race, Radicalism, and Transnational Solidarity, Duke University Press, Durham, 2018.
Robert McChesney, « The communication revolution: the market and the prospect », Media, Culture and Society, vol. 24, n° 5, 1997, pp. 591-612.
Last Moyo, « Rethinking the information society. A decolonial and border gnosis of the digital divide in Africa and the Global South », in Massimo Ragnedda, Glenn W. Muschert, eds., Theorizing Digital Divides, Routledge, Londres, 2019, pp. 133-145.
Muhammed Musa, « Technology and the Democratic Space in Africa A Re-Examination of the Notion of “Digital Divide” », in Bruce Mutsvairo, Massimo Ragnedda, eds., Mapping the Digital Divide in Africa: A Mediated Analysis, AUP, Amsterdam, 2019, pp. 65-88.
Bruce Mutsvairo, Massimo Ragnedda, eds., Mapping the Digital Divide in Africa: A Mediated Analysis, AUP, Amsterdam, 2019.
OCDE, Maintenir l’accès à l’internet en temps de crise, OCDE, Paris, 2020, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/maintenir-l-accesa-l-internet-en-temps-de-crise-3cd99153/.
OCDE, La transformation numérique à l’heure du COVID-19. Renforcer la résilience et combler les fractures, Supplément à l’édition 2020 des Perspectives de l’économie numérique, OCDE, Paris, 2021, www.oecd.org/digital/digital-economyoutlook-covid.pdf.
OIT, Emplois et questions sociales dans le monde. Tendances 2022, Organisation internationale du Travail, Genève, 2022.
Mothobi Onkokame, Aude Schoentgen, Alison Gillwald, « Microtravail en Afrique : un levier de développement ? », Alternatives Sud, vol. XXVII, n° 1, 2020, pp. 149-156.
Richard Perkins, Eric Neumayer, « Is the Internet really new after all ? The determinant of telecommunications diffusion in historical perspective”, The professional geographer, vol. 63, n° 1, 2011, pp. 55-72.
Renata Ávila Pinto, « La souveraineté à l’épreuve du colonialisme numérique », Alternatives Sud, vol. XXVII, n° 1, 2020, pp. 25-36.
Massimo Ragnedda, Anna Gladkova, eds., Digital inequalities in the Goblal South, Palgrave Macmilan, Cham, 2020.
Massimo Ragnedda, Glenn W Muschert, eds., The Digital Divide. The Internet and social inequality in international perspective, Routledge, Londres, 2014.
Massimo Ragnedda, Glenn W. Muschert, eds., Theorizing Digital Divides, Routledge, Londres, 2019.
SP, Impact environnemental du numérique : tendance à 5 ans et gouvernance de la 5G, The Shift Project, s.v., 2021.
UA, The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030), Addis-Abeba, Union africaine, 2020, https://au.int/sites/default/files/documents/38507-doc-dts-english.pdf.
Bridgette Wessels, « The reproduction and reconfiguration of inequality: Differentiation and class, status and power in the dynamics of digital divides », in Massimo Ragnedda, Glenn W. Muschert, eds., The Digital Divide. The Internet and social inequality in international perspective, Routledge, Londres, 2014, pp. 17-28.
Natalia Williams, « Overview on global digital divide », Global Journal of Technology and Optimization, vol. 13, n° 1, 2022, https://www.hilarispublisher.com/open-access/overview-on-global-digital-divide-85619.html.
Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, Zulma, Paris, 2020.
[1] La littérature dédiée identifie trois « niveaux » de « fracture numérique ». Le premier niveau touche à l’accès aux équipements et aux connexions ; le deuxième niveau a trait aux (non-)usages, à leurs motivations et à leurs déterminations ; quant au troisième niveau, il concerne la relation à établir entre les usages et les bénéfices que les utilisateurs retirent concrètement de leurs investissements pratiques dans le numérique (Ragnedda, Gladkova, 2020 : 18 et seq.).
[2] Et quand on s’intéresse au croisement de certaines variables, les résultats peuvent être pour le moins parlants. L’UNICEF (2023) avance par exemple que « 90 % des adolescentes et des jeunes femmes, dans les pays à faible revenu, ne sont pas utilisatrices d’Internet. Leurs homologues masculins, quant à eux, ont deux fois plus de chances d’être connectés », https://www.unicef.fr/article/90-des-adolescentes-et-des-jeunes-femmes-des-pays-a-faible-revenu-nont-pas-acces-a-internet/.
[3] En 2023, le Fonds monétaire international (FMI) estime que pour arriver à une « connectivité universelle », il faudrait investir près de 420 milliards de dollars.
[4] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/Declaration-for-the-Future-for-the-Internet.pdf.
[5] Il s’agit d’une doctrine élaborée durant la Guerre froide par le bloc capitaliste, visant à défendre la libre circulation des informations entendues dans un sens large et envisagées comme essentielles à la circulation des marchandises et des idées libérales.
[6] Nous pensons, par exemple, aux programmes Free Basics de Facebook, Starlink de SpaceX, Kupier d’Amazon ou Next Billion Users de Google.
[7] Citons, par exemple, le cas emblématique d’Amazon qui a réalisé près de 110 milliards de dollars de chiffre d’affaire au premier trimestre 2021.
[8] https://www.unicef.org/eap/press-releases/covid-19-least-third-worlds-schoolchildren-unable-access-remote-learning-during.
[9] Cf. De Vergès (Marie), « En Afrique, le décollage des fintech », Le Monde, 4 mai 2023, p. 16.
[10] La CNUCED (2019) précise que « 40% des 20 premières entreprises au monde, en termes de capitalisation boursière, reposent sur le modèle commercial de la plateforme numérique. Sept « super-plateformes », à savoir Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent et Alibaba, représentent deux tiers de la capitalisation boursière des 70 premières plateformes », https://news.un.org/fr/story/2019/09/1050972.
[11] https://justnetcoalition.org/2019/DJManifestoV6.1.pdf.
[12] Pour ce qui concerne l’Afrique et selon les estimations du BIT, « près de 5 millions de travailleurs supplémentaires et leur ménage sont passés sous le seuil d’extrême pauvreté au travail dans cette région en 2020, ce qui a fait augmenter le taux d’extrême pauvreté de 1,3 point de pourcentage » (OIT, 2022 : 44).
[13] Pour respecter les accords de Paris, il faudrait, a contrario, les baisser de 7 % par an. En France, il est prévu que l’empreinte carbone du numérique augmente de près de 50 % d’ici 2030.
[14] https://presse.ademe.fr/2023/03/impact-environnemental-du-numerique-en-2030-et-2050-lademe-et-larcep-publient-une-evaluation-prospective.html.