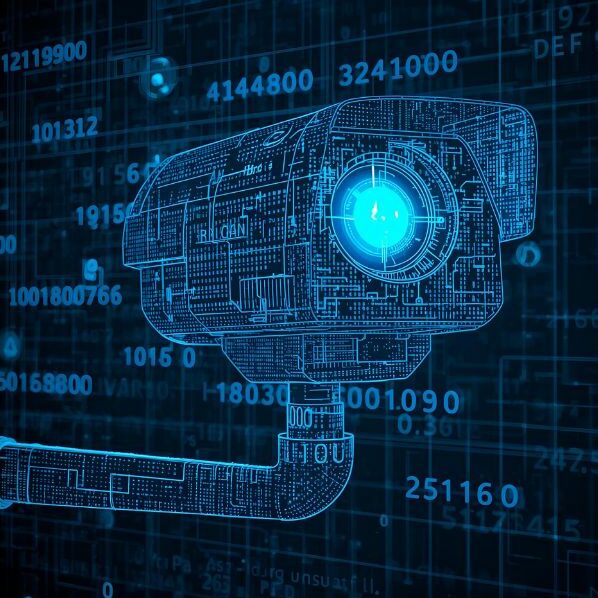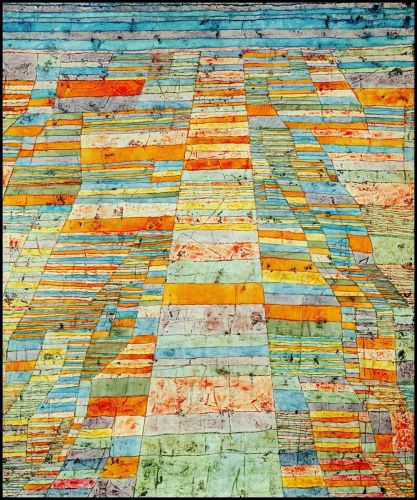Entretien – Émancipation, Université, identitarismes
Pour commencer cet entretien pour Critica Masonica, pouvez-vous préciser ce que vous placez derrière le vocable « émancipation » ?
Vaste question… L’émancipation est un affranchissement. C’est un ensemble de processus qui permettent de se défaire d’une tutelle ou d’une domination, qui peut strictement s’exercer depuis une extériorité sous des modalités à la fois coercitives et de mise en acceptabilité, mais qui peut également relever de dispositions faites corps, engrammées au sein même des individus, qui vous poussent à penser, agir et ressentir d’une certaine manière en conformité avec un ordre social. On peut ajouter que s’émanciper n’est pas seulement s’affirmer contre un pouvoir qui nous empêche d’exister véritablement, mais c’est aussi, comme le suggère Michel Foucault, refuser ce que nous sommes en tant que sujets soumis à la domination. L’idée d’émancipation est donc liée à une forme de libération, d’autonomisation, de déprise, de rapports de domination. Elle est liée à un renforcement d’une puissance d’agir individuelle ou collective, ou encore, dans une version plus légaliste, à la conquête de nouveaux droits. S’émanciper, c’est se désajuster ou se désaligner de nécessités qui pèsent sur soi et qui empêchent ou rognent vos potentiels d’expression, de créativité et d’épanouissement. En son principe, la chose peut paraître relativement simple, mais pratiquement elle s’avère difficile à réaliser. D’une part, parce que leslogiques émancipatrices recouvrent des réalités fort disparates qui dépendent des contextes sociaux et historiques dans lesquels les revendications et les allants d’émancipation sont formulés, et qui en cadrent les objectifs – on ne s’émancipe pas des mêmes choses et de la même manière selon la période historique et la formation sociale à laquelle on appartient. D’autre part, parce qu’il peut y avoir discussion sur les modalités pratiques et le sens même de l’émancipation visée. Si l’on prend le cas du port du voile, il est évident que celui-ci peut être tour à tour saisi comme une forme de soumission à une idéologie religieuse patriarcale ou, a contrario, comme une manière de s’émanciper d’un joug postcolonial. Et à l’évidence il peut être à la fois l’un et l’autre. Ce qui est vu par certains comme ressources émancipatrices peut être considéré, par d’autres, comme éléments de domination. L’émancipation prend donc des « couleurs » très différentes selon ce dont on estime devoir se détacher et aussi selon la manière dont il s’agit de rompre et de travailler à l’obtention de conditions propices à aller vers une vie meilleure.
L’émancipation serait donc une affaire de justice sociale…
Les dynamiques d’émancipation ont en effet un rapport avec les questions de justice sociale, d’inégalités, d’aliénation, d’oppressions, et supposent donc d’entrer en lutte afin de se défaire de ce qui vous diminue. L’émancipation suppose une prise de pouvoir et n’est jamais un long fleuve tranquille. C’est toujours un affrontement, une lutte sociale et politique contre soi et contre les oppresseurs, contre les logiques de répétition et de reproduction de l’existant. S’émanciper de l’ordre capitaliste passe, par exemple, par une rupture avec la logique et la généralisation de la forme marchande qui a pénétré et déformé la totalité de la vie, les rapports à la nature, aux autres et à soi-même, rapports qui sont réifiés, chosifiés et structurés par la raison instrumentale et la dynamique d’accumulation du capital. L’émancipation est donc une bagarre qui s’avère toujours complexe, dans la mesure où elle est une lutte à plusieurs dimensions qui nécessite une prise de consciencedes dominations et des idéologies qui les accompagnent. Mais ce n’est pas simplement une histoire de savoirs. Encore faut-il s’organiser pour initier des pratiques de changement effectives. Le savoir n’est que pour partie émancipateur. On peut considérer qu’il s’agit d’une condition nécessaire, mais certainement pas suffisante. D’aucuns considèrent même que ce qui compte relève moins d’un savoir, d’une conscience, que d’un désir de changement allié à un faire susceptible de le prendre concrètement en charge.Dans cette perspective, l’émancipation a moins partie liée à la culture et à la connaissance qu’à la force des engagements et à une libido de type actionnaliste. On peut toutefois, raisonnablement, considérer que la condition de possibilité d’un changement effectif visant un dégagement des dominations est tout de même de prendre la mesure de ces dominations, fut-elle approximative, et dans un registre qui ne soit pas seulement celui de la souffrance. Certes, la plupart du temps, la domination sécrète de la souffrance et alerte donc sur une situation qui n’est pas souhaitable. On ne peut duper entièrement et tout le temps les individus assujettis, car il y a toujours un moment où l’assujettissement cause un trouble qui alerte sur la situation et son anormalité. On retrouve, par exemple, cette idée au sein de la Théorie critique de l’École de Francfort, mais aussi chez Pierre Bourdieu qui estime que la plupart des sujets ne sont pas ignorants des dominations, mais en sont plutôt méconnaissants, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas toujours en mesure d’identifier et d’analyser précisément leur situation. En revanche, ils sont sensibles à la domination en tant qu’elle cause des troubles, des tensions, de la gêne. Mais la souffrance tout comme le savoir ne sont pas suffisants pour initier des processus d’émancipation.
La souffrance n’est-elle pas, pourtant, ce qui peut amener à une première forme de conscientisation ?
Si vous n’avez pas l’impression d’être dominé, vous n’avez évidemment aucune raison de vous émanciper de quelque chose que vous ignorez et ne ressentez pas comme amoindrissant. Il ne faut pas oublier que l’une des conditions de possibilité visant à rendre les dominations effectives est deles faire oublier en tant qu’elles sont des dominations. Les ressorts de la domination relèvent de son invisibilisation, de sa mise en acceptabilité (amener les individus à considérer que certaines oppression ou inégalités sont justes), de sa capacité à provoquer l’inhibition et le découragement (rappelons-nous le slogan de Margaret Thatcher : There is no alternative), et à pouvoir aussi exercer une contrainte directe si besoin est. Comme pourrait le dire Antonio Gramsci, c’est un équilibre d’hégémonie et de coercition.S’émanciper revient à intervenir sur tout ou partie de ces empêchements et de rendre, sous un angle ou sous un autre, les sujets dominés capables de se défendre, de se prendre en charge, de se libérer des dominations qui s’exercent à un titre ou à un autre sur eux. Il s’agit d’un réarmement, de redonner de la puissance de penser et d’agir aux dominés, d’être critique, et de toujours avoir pour souci, comme le suggérait Michel Foucault, de réfléchir à la manière de ne pas être gouverné de telle manière, au nom de tels principes particuliers. Pour Foucault, l’attitude critique naît précisément de cette exigence morale et politique tenant au fait « de ne pas être tellement gouverné » disait-il : un art de l’inservitude volontaire, de l’indocilité réfléchie. Il n’y a pas d’émancipation sans attitude critique et donc sans la nécessité de quitter sa position d’assujetti.
Quelle place peuvent prendre la culture et le savoir dans les processus d’émancipation ?
Je tiens à le répéter : seul, le savoir n’est pas suffisant. L’erreur souvent commise est de penser qu’il serait le préalable inconditionnel de l’émancipation, ce par quoi il faudrait d’abord passer, avant d’en venir aux choses sérieuses. Il s’agit là d’un chemin possible, qui a sa logique – il est même assez commun –, mais il n’est pas l’unique possibilité. C’est aussi dans et par l’action que l’on s’arrache de la méconnaissance et qu’opère le travail du négatif qui fait précisément du sujet travaillant à son émancipation un sujet nécessairement critique. L’émancipation n’est pas d’abord un acte de connaissance, mais un acte politique dont une des dimensions relève d’une lutte pour la connaissance. Une autre manière de le dire est d’affirmer que l’émancipation est une démarche qui pose toujours le problème d’un agir en commun relatif à un devenir collectif et pas seulement un effort de réflexion entendu comme pensée et réflexivité. Si l’on prend au sérieux le fait que lesdominations s’exercent en provoquant de l’adhésion, du dévouement, un accord avec les règles du jeu, alors, l’émancipation n’est pas une simple question de prise de conscience ni de révolte contre l’insupportable, mais doit aussi relever d’une déshabituation susceptible de transformer durablement les dispositions à la soumission. Il s’agit en quelque sorte d’une contre-socialisation et d’une contre-éducation. Cette dernière passe par un travail de la raison aidant à se défaire des phénomènes de fausse conscience qui freinent la connaissance exacte de la réalité sociale. Mais la connaissance n’est pas la panacée.
Les institutions républicaines d’enseignement ne peuvent donc, selon vous, jouer qu’un rôle somme toute secondaire ?
C’est un vieux débat ! L’école républicaine a été considérée comme l’instrument par lequel chacun pouvait se libérer de ce qui l’aliène indûment : dogmes, préjugés, tutelles familiales ou religieuses. A contrario, elle a également été considérée comme un outil de disciplinarisation de ses usagers et aussi de ses personnels. Condorcet y voyait un instrument de la vérité, de la connaissance vraie, et certains anarchistes un dispositif de dressage. Elle n’est ni l’un ni l’autre, mais une institution imparfaite, reproductrice d’inégalités qui, toutefois, peut permettre une habilitation de l’individu en lui apportant des appuis critiques essentiels. Si l’égalité des chances et la méritocratie sont des mythèmes de la démocratie formelle, il n’en reste pas moins vrai que les savoirs fondamentaux dispensés au sein des institutions éducatives d’État s’avèrent indispensables en ce qu’ils permettent une certaine autonomie des intelligences. Reste cependant à travailler à l’émancipation des volontés et à constituer une communauté des égaux, et c’est là une tout autre affaire, dont on voit d’ailleurs mal pourquoi elle devrait être confiée spécifiquement aux instances d’éducation formelle. De surcroît, il ne faut jamais oublier que si le savoir donne de la puissance, la condition de production de ce savoir relève aussi d’une situation de domination. La connaissance scientifique exige, par exemple, du temps, de la disponibilité, une éducation spécifique et fort longue, c’est-à-dire une condition scolastique notamment fondée sur une séparation du travail intellectuel et manuel. Les intellectuels de métier n’existent que parce que par ailleurs d’autres travailleurs, manuels ceux-là, leur assurent des conditions d’existence leur permettant de se livrer à la production de connaissance. C’est Édouard Vaillant, élu de la Commune de Paris, qui estimait que ceux qu’il appelait les « manieurs d’outils » devaient être mis en capacité de pouvoir écrire un livre, avec passion et talent rajoutait-il. Cent cinquante ans plus tard on reste toujours fort éloigné de cet idéal égalitariste.
Venons-en à l’Université. Quel diagnostic dressez-vous aujourd’hui du monde universitaire ?
L’Université est une institution qui me semble déclinante si l’on se place sous les auspices des nécessités de la critique et de l’émancipation. Du côté des usagers de l’Alma mater, il est utile de rappeler que les parcours positifs – passer d’une année à l’autre sans difficulté, obtenir ses diplômes, effectuer des stages formateurs, se constituer un réseau professionnel, etc. – restent encore largement le fait des étudiants issus des milieux les plus favorisés socio-économiquement et culturellement. La démocratisation-massification de l’enseignement supérieur ne doit pas faire oublier que la « réussite » de ceux qui arrivent à l’Université depuis des filières techniques ou professionnelles est particulièrement faible, que l’accès aux établissements les plus prestigieux et donc les plus sélectifs est singulièrement inégalitaire, que l’origine sociale des apprenants continue de déterminer leurs performances, ou encore que l’accroissement du niveau de certification n’est synonyme ni de l’accession à une culture critique commune de haut niveau, ni d’une promotion sociale forcément ascendante. À cela s’ajoutent des mesures successives comme la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, le dispositif « Parcoursup », la mécanique « Bienvenue en France », etc., qui préparent petit à petit une université à deux vitesses : d’une part, des collèges universitaires qui auront pour mission de former des étudiants en correspondance avec les besoins de certains bassins d’emploi ; d’autre part, des universités disposant de gros moyens et au sein desquelles on pourra faire de la recherche et suivre des cursus hyper sélectifs. La formation critique sera éventuellement dispensée dans ces pôles « d’excellence », à l’instar du système états-uniens. L’émancipation sera en quelque sorte censitaire.
Du côté des personnels, le tableau à dresser n’est guère plus heureux. Les personnels non-enseignants ont souvent des conditions de travail difficiles (suppression de postes, polyvalence, précarisation) et des salaires misérables. Prenez un poste de catégorie C en région parisienne et vous voilà obligé de vous nourrir aux plus bas prix et vous loger en deuxième ou troisième couronne. L’indécence sociale du libéralisme qui creuse les inégalités, encense les « premiers de cordée » et fustige les « premiers de corvée » traverse aussi le monde universitaire. S’agissant des enseignants-chercheurs, il faut par exemple rappeler qu’un maître de conférences en début de carrière, après huit années d’études, a minima, débute avec un traitement net mensuel d’environ 1700 euros, c’est-à-dire, grosso modo, 200 euros de plus que le Smic. Voilà ce que réserve l’institution à ceux qui ont réussi à obtenir un poste de titulaire, après un parcours du combattant qui parfois épuise les promus avant même qu’ils aient véritablement commencé leur carrière. Mais au-delà des conditions salariales, ce sont les conditions d’exercice qui se dégradent, là aussi, sous le coup d’un train de « réformes » qui visent à reconfigurer le service public d’enseignement supérieur à la main d’un néolibéralisme dont les mantras sont la croissance et la compétitivité, mesures qui remettent notamment en cause les principes de quasi-gratuité et d’égalité. Les vagues successives de programmes d’investissements d’avenir ont préparé la grande opération de tri des universités ; l’instauration de la rupture conventionnelle pour la fonction publique va dans le sens d’une flexibilisation et d’une précarisation des carrières ; quant à la Loi de Programmation de la Recherche (LPR), elle étend les principes de concurrence et de performance, censés être la grande leçon donnée par le privé au public, ainsi que la condition sine qua non d’une recherche « hautement compétitive ». La recherche par projets et les crédits fléchés supplanteront bientôt la plupart des financements permanents et le secteur privé se taillera une place toujours plus vaste dans la gouvernance et les stratégies de nos établissements, qui en ont déjà adopté la novlangue. Dans un rapport du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur il est, par exemple, écrit que mon université, Paris 8,n’aurait pas réussi à imposer une « image de marque » et éprouverait des difficultés à « transformer la spécificité de son concept ». Il faut évidemment, ici, entendre « concept » au sens publicitaire du terme.
L’Université devrait donc prendre conscience qu’elle est une entreprise comme une autre, et la Loi de Programmation de la Recherche de l’aider dans cet effort. De fait, la LPR entérine une amplification de l’évaluation et de la compétition par le démantèlement des statuts des enseignants-chercheurs et la modulation des services et des traitements individuels, qui, en tout état de cause, devront être adaptés à la « réalité du métier », à la pénurie de postes, etc. Ça ne laisse guère de doute sur la direction que prendra l’adaptation des obligations de service. L’approfondissement de l’« autonomie » des universités et de sa logique d’excellence découlant des recommandations européennes du processus de Bologne ou de la stratégie de Lisbonne sont, à l’évidence, des machines managériales discrétionnaires de production d’inégalités. Elles contenteront quelques « premiers de cordée » académiques, mais floueront la très grande majorité des enseignants-chercheurs. La recherche sera un privilège accordé à quelques-uns par un cénacle de managers qui ne seront pas tous des pairs, loin s’en faut. Ils auront la haute main sur les parcours professionnels, les infléchissements de carrière et les préséances locales (promotions, primes, sanctions), favorisant encore un peu plus les logiques de népotisme, d’allégeance et de docilité.
La critique aura semble-t-il de plus en plus de mal à se faire entendre. Mais n’est-ce pas déjà le cas aujourd’hui ?
Il est des espaces académiques où l’idée de donner des armes critiques plutôt que des leçons convenues et accommodantes reste toujours, fort heureusement, d’actualité. Mais ces lieux de résistance sont de plus en plus restreints et fragilisés, y compris au sein des universités réputées très à gauche, comme Rennes 2, Toulouse 2-Jean Jaurès ou Paris 8. Il ne s’agit, le plus souvent, que de quelques cours et séminaires qui sont le fait d’individus assez fréquemment isolés ; plus rarement le fait de collectifs à l’échelle des laboratoires ou des départements. Les dynamiques critiques réellement collectives se font de plus en plus exceptionnelles. Les unités de formation et de recherche, les facultés, les établissements et les divers regroupements universitaires sont, la plupart du temps, très hétérogènes et rassemblent des sensibilités éducatives et épistémologiques très diverses, voire carrément opposées. Par exemple, il n’est pas rare de rencontrer au sein d’un même département certains enseignants-chercheurs défendant, pour les uns une pédagogie magistrale, un utilitarisme des savoirs et une recherche d’obédience positiviste, tandis que d’autres soutiendront un enseignement populaire attentif aux curricula latents et une recherche critique. On peut évidemment se réjouir de cette variabilité des points de vue censée faire la richesse de l’Alma mater, mais il ne faut pas oublier que cette diversité est structurellement organisée viades logiques de champ qui déterminent des rapports de pouvoir, classent les visions, créent des divisions et hiérarchisent les individus. Il va sans dire que les règles du jeu académique ne favorisent qu’accidentellement les tenants d’une critique radicale qui ont précisément en ligne de mire la nécessité de faire rupture avec le formatage éducatif et scientifique de mise en conformité des apprenants aux nécessités de la société dans laquelle ils évoluent.
Votre université, Paris 8, héritière du Centre universitaire expérimental de Vincennes créé dans le sillage de mai 1968 n’est-elle pas un pôle de résistance à ces logiques de champ ?
Je ne suis pas certain que l’esprit vincennois irrigue toujours notre institution. Se réjouir d’un riche héritage est une chose, le faire vivre et s’y ajuster en pratique, et pas seulement en théorie, en est une autre. Les approches critiques censées être au cœur des travaux et des pédagogies de cette université sont le fait d’enseignants-chercheurs qui peuvent aussi se laisser prendre dans les filets du jeu académique. Il n’y a pas d’immunité face aux logiques de champ qui pèsent avec force sur les individus, y compris ceux qui se réclament de la critique, qui peuvent néanmoins, eux ausi,s’avérer de parfaits suiveurs de l’ordinaire universitaire, prêts à accueillir et examiner toutes les propositions susceptibles de leur apporter quelque avantage. La chair universitaire est faible !La sphère académique est un espace social au sein duquel les procès de catégorisation et la construction symbolique des faits se révèlent d’une grande importance. Ce sont des opérations nécessitant une certaine maîtrise du langage dont les plus cyniques n’hésitent pas à se servir pour construire des discours d’accompagnement et de mise en acceptabilité de leurs renoncements et de leurs activités de substitution, ou bien, pour d’autres, pour construire leur plan carrière. Le paradigme constructiviste qui irrigue nombre des modèles d’analyse contemporains en sciences sociales a, certes, permis d’importantes avancées heuristiques, mais il sert aussi de terreau et de caution à des travers que Renaud Garcia a par exemple fort bien consignés dans son ouvrage LeDésert de la critique et dont l’un des traits principaux relève de cette tendance fictionnelle à estimer que la réalité étant erratique, elle n’aurait finalement que la consistance des interprétations que l’on en fait et pourrait même se réduire aux constructions symboliques dont elle est l’objet. Bref, la réalité serait, pour l’essentiel, une affaire de points de vue, de pouvoir s’incarnant dans des jeux de langage et des chaînes de significations et d’équivalence. D’aucuns en font des outils d’analyse, d’autres des stratégies de placement. Se peindre et se vivre en chercheur critique tout en étant particulièrement conciliant avec les logiques de démembrement de l’institution, c’est diversifier ses mises pour maximiser ses boni. Cela explique d’ailleurs, pour partie, l’attentisme d’un certain milieu universitaire face aux attaques qu’il subit, attaques auxquelles il n’adhère pas forcément, mais dont il estime qu’il pourrait tirer, à courte échéance, quelque avantage. Cette forme de cynisme qui présente tous les atours d’un renoncement provoque notamment des tensions avec les étudiants, plus prompts à prendre part aux mobilisations contre les politiques de casse de l’Université, élan qui s’avère parfois dénoncé par les tenants de cette critique dévoyée comme un spontanéisme juvénile.
La critique a également sont lot de « narcisses ambitieux » qui tendent à vouloir faire de l’Université une structure d’opportunités susceptibles de participer de leur splendeur. Raccordés au « tout à l’ego », ils prennent l’Université pour un bassin de décantation de leurs excrétions narcissiques. L’homo econo-acade-micus de l’ère macronienne, DRH de son auto-petite-entreprise a pour caractéristique d’agir d’abord pour infléchir positivement sa trajectoire professionnelle en termes de traitements et de reconnaissance sociale. Habitué à jouer des coudes et à gérer son entreprise d’élévation personnelle par l’affirmation de sa « singularité », de son « authenticité », il n’est pas très ouvert au dialogue. Le narcisse ambitieux a tendance à construire n’importe quel désaccord quant à sa manière de gérer son appétit professionnel en offense castratrice portée par de sombres collègues qui ne penseraient qu’à maintenir leurs préséances. Les places sont chères, les possibilités somme toute restreintes. Aussi estime-t-il pouvoir faire feu de tout bois pour accéder aux positions qu’il considère devoir occuper. La précarité et la concurrence accrue ne produisent pas que des renoncements, elles créent également des défiances exacerbées et consacrent le dégagisme comme solution à l’exercice de ce « pouvoir » que le narcisse ambitieux décrit tour à tour comme diffus et/ou concentré, selon ce qui l’arrange à un moment ou à un autre, et lui permet de faire exister cette culture victimaire dont il a tant besoin pour justifier ses assauts et faire passer pour critiques ses stratégies égotistes. En l’espèce, il me semble que l’on assiste à une collusion entre certaines théories identitaristes et les exigences individualistes du libéralisme contemporain. Les subjectivités deviennent la mesure incontestable d’une réalité qui doit tout recevoir de l’individu et de sa sensibilité. La conjuration des ego qu’évoque Aude Vidal dans son livre éponyme sur les milieux militants féministes est également une réalité des milieux universitaires dont le fractionnisme narcissique s’avère un levier fort utile pour instituer l’individualisation des parcours et la précarisation des collectifs de recherche. C’est tout du moins ce que j’observe depuis là où j’exerce.
Ces derniers temps, l’Université a également été l’objet d’attaques idéologiques frontales, et plus particulièrement le secteur des sciences sociales, accusé de développer une « culture de l’excuse », voire de faire le lit des pires obscurantismes.
En effet. Il y a une douzaine d’années, dans un ouvrage intitulé Unmaking the public University, Christopher Newsfield posait l’hypothèse que les universités américaines subissaient un assaut idéologique discréditant la validité intellectuelle de leur travail critique. Il y voyait l’expression d’une guerre culturelle faite aux classes populaires qui trouvaient à s’émanciper via l’Université, malgré tous ses défauts. Une telle hypothèse pourrait être également proposée concernant ce qui se passe aujourd’hui en France, mais aussi en d’autres pays. Discréditer les sciences sociales, c’est s’attaquer aux productions scientifiques qui, précisément, produisent des outils théoriques fort utiles, permettant le développement de pensées critiques réflexives susceptibles de remettre en cause certaines des « évidences » dérangeantes du monde tel qu’il va : inégalités, racisme, sexisme, etc. Aussi, pour ceux qui ont tout intérêt à ce que rien ne bouge, la science devrait être maintenue à distance du politique. Il s’agirait de séparer ce qui relève, d’une part, de la recherche et, d’autre part, du militantisme. Manuel Valls expliquait il y a quelque temps qu’une forme de sociologie dévoyée justifie les faits délictueux, alors qu’elle se doit de rester axiologiquement neutre et de cesser d’embrigader des générations d’étudiants crédules. Une belle ânerie pourtant reprise par nombre de collègues. S’agissant des accusations d’islamo-gauchisme, car il me semble que c’est aussi à cela que vous faisiez référence, c’est une offensive idéologique à tendance confusionniste et complotiste, visant à désigner ni plus ni moins que des « traîtres à la nation », en affinité avec l’obsession macronienne du séparatisme. C’est une polémique dont l’intérêt scientifique est tout bonnement nul, puisqu’elle postule l’existence d’une hégémonie des « théories décoloniales » au seins des sciences sociales, laquelle n’existe tout bonnement pas. Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal ont d’ailleurs été bien aidés dans leur croisade par les fantasmes d’Houria Bouteldja qui, quelques jours avant le gros de l’offensive gouvernementale, écrivait dans sa lettre de démission du Parti des Indigènes de la République dont elle était jusqu’alors l’une des porte-parole, que le PIR rayonnaitdans toutes les universités. Les propos des ces ministres ont par ailleurs trouvé de nombreux appuis dans le milieu universitaire lui-même, à l’instar de celui de Nathalie Heinich qui, dans un entretien donné au Figaro, a avancé, sans ciller, que les chercheurs critiques contribuent àlégitimer les assassins de l’école Ozar Hatorah ou de Charlie Hebdo. Les universitaires critiques sont donc construits comme desennemis intérieurs qui se seraient alliés aux forces obscures de l’islamisme radical pour ratifier la haine des « Blancs ». Ce sont des formes de production discursive relevant des techniques propagandistes de l’altright et des alternative facts chères à Donald Trump et élaborées par son ex-conseiller d’extrême droite Steve Bannon. Il s’agit, là encore, de donner à penser que les théories identitaires en particulier et les sciences sociales en général pourraient s’avérer dangereuses pour la Nation et, par conséquent, de suggérer qu’elles devraient être surveillées et, le cas échéant, sévèrement sanctionnées. C’est une offensive claire contre les libertés académiques. Reste que certaines productions scientifiques à tendance identitariste doivent être interrogées sans concession car elles portent d’évidentes régressions épistémopolitiques qui ne sont pas sans conséquence sur les dynamiques d’émancipation.
Pouvez-vous préciser ?
Je crois qu’il faut d’abord rappeler que la critique la plus visible de ces élaborations théoriques est de nature plutôt réactionnaire. Elle s’exprime prioritairement dans des tribunes, des appels, des manifestes, des pétitions et des entretiens dont les supports privilégiés sont les médias dominants qui font leurs choux gras des surenchères campistes et provocatrices. L’espace public médiatique est quelque peu saturé par ces saillies qui tendent à rendre inaudible une critique qui, précisément, garde pour boussole l’émancipation et qui, en son nom, pointe tant les limites épistémologiques que les travers politiques des identitarismes. L’aporie la plus évidente est celle de l’essentialisation. Les perspectives identitaires peuvent avoir une pente essentialisante et considérer que les identités sont des éléments de nature immuable, stables, figés et incommensurables. Elles se transforment alors en identitarismes aveugles à la complexité des cultures et des parcours individuels et réifient les sujets individuels et collectifs, notamment en les réduisant à des figures d’oppresseurs ou de victimes. Être blanc de peau, homme cis genre et/ou hétérosexuel peut ainsi devenir le signe d’une appartenance évidente aux groupes dominants. Peu importe la position et la trajectoire sociales des sujets considérés. Ces marqueurs sont censés attester d’une appartenance à une caste de privilégiés que l’on peut éventuellement considérer autrement que comme des oppresseurs patentés si et seulement si ils acceptent de dispenser quelque aveu public de leurs supposés privilèges auxquelles ils semblent aveugles. La culpabilité est ici envisagée comme le sentiment « minimum » pouvant éventuellement conduire à une conversion. L’éventualité en question est d’ailleurs assez improbable si l’on prend au sérieux le fait qu’il est impossible de renoncer à une essence. L’essentialisation conduit à la hiérarchisation, au communautarisme, à la préservation d’une « pureté », à la non-mixité, et je ne parle pas là des réunions non-mixtes. Par ailleurs, ces égarements identitaristes nourrissent des crispations épistémologiques. La division du travail académique et l’hyperspécialisation se voient renforcées sous l’effet de courants théoriques qui cherchent moins à discuter entre eux et à trouver des plans d’articulation qu’à se livrer à une guerre des places.
Vous venez d’évoquer les réunions non-mixtes, ne font-elles pas prendre le risque que des rapports de force s’installent dans un groupe genré ou racisé ?
Pour ma part, je suis tout à fait favorable aux réunions non-mixtes. Ellesont un intérêt central qui est de permettre l’existence d’une parole libérée de certaines contraintes qui pèsent dans les situations de mixité. La non-mixité est un outil utile pour les combats émancipateurs, mais à deux conditions. La première condition est de faire de la similitude liée à la non-mixité la condition de nouveaux écarts, comme dirait François Jullien. Autrement dit, la non mixité ne doit jamais être sa propre fin, elle doit travailler à recouvrer de la diversité : certes nous sommes entre femmes, homosexuels, etc., mais il s’agit aussi de considérer, derrière ce qui nous rassemble, non pas ce qui nous pourrait nous éloigner, mais ce qui nous singularise et nous permet de jouer de ces écarts. Pourquoi ? Parce que c’est à partir de ces singularités que l’on peut créer un commun interne et notamment ne pas laisser d’autres formes de domination que celle qu’évacue la non-mixité donner le « la » des échanges. La seconde condition est de se donner les moyens de se servir de ce moment de non-mixité comme la possibilité de, collectivement, se singulariser pour cette fois, mettre en tension et en dialogue cette singularité collective avec d’autres singularités collectives. L’idée est, là, de pouvoir créer un commun que l’on pourrait qualifier « d’externe » et qui permet de rentrer en discussion avec d’autres entités susceptibles de conduire à des alliances, voire des fronts de lutte. C’est une erreur de penser que les réunions non-mixtes sont nécessairement les instruments d’un identitarisme, car elles peuvent s’avérer primordiales dans l’instauration d’un dialogue. Elles peuvent ouvrir à de nouveaux possibles et, précisément, faire sortir de l’ornière essentialiste les identités censées être permanentes et les culturalismes dogmatiques.
L’Université apparaît comme un des espaces d’évidence de l’usage public de la raison, de la discussion libre et publique ; or ces derniers temps, la censure ne l’a pas épargnée. La « cancel culture » fait aussi son œuvre au sein même de l’alma mater.
J’imagine que vous faites allusion à des événements tels que le report des Suppliantes d’Eschyle dans le cadre des Dionysies à La Sorbonne ou l’annulation de la conférence de Sylviane Agacinski à l’université de Bordeaux au motif de son opposition à la PMA. Avant d’y revenir, il me semble important de préciser que la censure la plus dangereuse est tout de même celle qui tente de s’imposer par le haut, que nous évoquions tout à l’heure ; une censure qui pourrait véritablement instituer un cadrage de la production scientifique et des enseignements allant à l’encontre du principe des libertés académiques : des Présidents d’Université qui sanctionnent leurs personnels pour participation à des mouvements sociaux, des procès disciplinaires intentés pour déloyauté, des formations qui ferment sous couvert de rentabilité, des colloques annulés ou encore des profils de poste amendés pour raisons politiques, et ce, sur décision d’une tutelle ou d’une autre. Les tentatives de mise au pas du monde universitaire les plus inquiétantes sont, à mon sens, davantage liées aux pouvoirs institutionnels qu’aux coups de force de poignées d’individus crispés sur quelque identité. Ceci étant précisé, il n’est pas inutile de pointer la tendance délétère à considérer l’autre comme un ennemi. Dans un ouvrage récent, Brutalisme, Achille Mbembe rappelle combien les identitarismes sont pourvoyeurs de violence et conduisent à la brutalisation des rapports entre les Nous supposés victimaires et les Eux censément oppresseurs. La focalisation sur les egos identitaires et l’essentialisation des dominants font dire à certains que la cancel culture érige ses adversaires en des ennemis irréformables qu’il ne s’agit donc plus de contrer, mais d’éliminer, d’effacer, et ils y voient un règlement des désaccords par élimination et une montée aux extrêmes des débats. L’argument doit être évalué avec circonspection, mais force est de reconnaître qu’il y a des faits tendant à ratifier l’hypothèse d’une brutalisation des antagonismes politiques. Les identitarismes ont du mal à se positionner autrement que comme systèmes de valeurs à défendre contre d’autres systèmes de valeurs et, finalement, à n’en rester qu’à des jeux de conflit qui crispent encore davantage les identités sans se donner les moyens d’inventer des communautés politiques nouvelles. D’un côté, l’importance prise par l’offense au sein de certaines visions du mondetend à encourager la construction d’espaces de retrait servant à se protéger des discours soi-disant offensants ; de l’autre on censure, on dénigre, on diffame, plutôt que de tenter de structurer les conditions d’un débat démocratique et égalitaire le plus large possible. Les limites du débat public se trouvent ainsi doublement cadrées : d’une part, par une forme de « politiquement correct » qui entend éviter les affrontements directs et la charge de violence contenue dans le langage et, d’autre part, par ce que Mbembe appelle une viscéralisation des débats qui n’évite ni l’invective, ni l’insulte, ni la calomnie, ni l’enfermement sur soi.
La brutalisation est une conséquence de l’essentialisation. Quand Reni Eddo-Lodge publie Why I’m non longer talking to white people about race, elle suggère bien la volonté de faire rupture dans le dialogue avec les « Blancs ». Et quand Houria Bouteldja considère que ses premiers ennemis sont ses potentiels alliés de gauche, c’est encore au nom d’une « rupture avec la blanchité », c’est-à-dire avec ce qu’elle considère comme le « pouvoir blanc ». Bien que parfois présentés comme rapports sociaux, la « blanchité » et ses dérivés sont traités comme relevant in fine d’une essence dont on ne saurait se défaire et qui inscrit leurs porteurs dans un rapport de domination fatal qu’on ne peut combattre que brutalement, notamment par éradication. Cette frénétisation va jusqu’à épouser, en certains de ses développements, des penchants aux tendances racistes, antisémites, sexistes et homophobes, à l’instar de certains discours portés par le Parti des Indigènes de la République. Il y a derrière cette extrémisation une concurrence victimaire visant à hiérarchiser l’importance des atteintes portées à certaines minorités, parfois sous couvert de reconfigurer les catégories usuelles de la gauche. On baigne là dans un confusionnisme bifide dont la tête politique, mal faite, est habitée de relents d’extrême droite, et l’autre, la tête épistémologique, trop pleine, déborde d’imbroglios théoriques comme l’« homonationalisme » ou le « fémonationalisme » censés rendre compte des logiques de collaboration avec le blanco-hétéro-patriarcat. Aussi, celles et ceux qui, malgré ce qu’ils sont, n’agissent pas selon les attendus des déterminismes identitaires, sont systématiquement suspectés d’être des valets, des sots, des traîtres ou, dans le meilleur des cas, d’être manipulés et incapables de prendre conscience des formes de violence symbolique qui les astreignent à coopérer aux desseins des oppresseurs.
J’évoquais, tout à l’heure, les narcisses ambitieux de l’Université. Il est intéressant de constater que l’individualisme libéral du carriérisme académique fait plutôt bon ménage avec les approches épistémopolitiques que je viens d’évoquer. Le souci de soi exacerbé tend à faire de l’espace des mouvements sociaux, mais aussi du champ académique, des lieux d’épanouissement existentiels qui doivent être globalement mis au service d’une attention renouvelée à la personne. À la figure radicale-chic du porte-parole militant médiatique révélant, enfin, au grand jour, l’existence d’un peuple en lutte dépossédé de tout et maltraité par tous, fait écho celle du social scientist disruptif qui éclaire de sa fulgurante et inédite pensée – bien que d’importation – la communauté de ses pairs censément englués dans des habitudes cognitives oppressives. Sous les auspices de l’identité, le tout à l’égo se porte bien et, assurément, l’Université est l’un de ses bassins de décantation. Quand, d’une part, les alliés potentiels sont tenus pour des ennemis et quand, d’autre part, aucune limite ne doit borner les excrétions narcissiques, alors il n’y a rien d’étonnant à remarquer que les plus individualistes n’hésitent pas à profiter de toutes les opportunités qui leur sont offertes, y compris celles qui sont produites par des politiques dont on sait pourtant qu’elles ne vont pas dans le sens d’une émancipation collective.
D’une certaine manière, on a l’impression que ce que vous décrivez relève d’un abandon des Lumières entendu comme projet général de sortie de l’Homme de l’état de tutelle. Est-ce vraiment le cas ?
Pour les identitaristes, de la raison, des Lumières et de l’universalisme, il s’agit plutôt de faire table rase ! Le fait que l’Occident, dans ses agissements coloniaux, ait écrasé des cultures, des traditions et des peuples, invaliderait en quelque sorte toutes ses productions. C’est, évidemment, faire là un procès expéditif confondant sciemment les visées humanistes et révolutionnaires poussant l’être humain à s’émanciper par la raison, l’éducation et la citoyenneté avec les logiques impérialistes organisant de nouvelles formes d’exploitation et d’oppression qui en sont un dévoiement. S’il est une forme d’universalité qui, effectivement, a été énoncée depuis l’Occident considéré comme civilisation avancée seule capable d’apporter le progrès et d’unifier progressivement les peuples, il est aussi un universalisme proposant autre chose qu’une globalisation homogénéisante et, comme le disait Aimé Césaire, qu’une dilution dans l’universel. Dans La Gauche contre les Lumières, Stéphanie Roza rappelle, par exemple, que les droits de l’homme ont aussi fourni des arguments contre la colonisation. Mais pour les identitarismes, la modernité et la rationalité ne peuvent mener à l’émancipation, dans la mesure où celle-ci doit nécessairement se confondre avec un retour aux traditions et être mise en conformité avec des éléments culturels censés être indiscutables. Certains tenants des études décoloniales comme le sociologue argentin Enrique Dussel évoquent pourtant l’idée d’un pluriversalisme transmoderne. Il désigne ainsi l’effort pour penser l’ensemble de l’humanité, non pas à partir de sa propre expérience culturelle érigée en modèle de référence et servant d’étalon, mais depuis un dialogue réellement capable de s’ouvrir aux autres qui, s’il reconnaît pleinement les dominations, ne fige pas pour autant les dominés dans un statut indépassable de victimes héréditaires et ne leur refuse donc pas des possibles émancipatoires. On retrouve chez des penseurs comme Césaire ou Édouard Glissant l’idée d’un universel riche de tout le particulier, un Tout-monde foncièrement ouvert à la relation, à l’échange qui vous change et à la pluralisation des grammaires de vie permettant l’invention de chacun par et pour tous. De fait, c’est sans aucun doute plus simple de faire la peau à l’exigence d’un pluriversalisme ouvert que d’essayer d’en relever les défis. Une fois l’exécution réalisée, il ne reste plus que le local et la contingence. L’émancipation n’est alors plus qu’une affaire de singularités rentrant en résistance depuis des raisons d’agir éminemment situées qui ne sauraient être vraiment communes à d’autres et encore moins à l’ensemble de l’humanité.
Dans leur version postmoderne, les identitaristesont également produit un scepticisme radical quant à la possibilité d’une vérité objective. En tant que subjectivismes, ils s’avèrent moins guidés par la raison et l’établissement de faits objectifs que par les affects et la construction sensibles des faits. Les subjectivités et les sentiments sont placés, dans le domaine du savoir, au premier plan des analyses et, dans le domaine politique, aux avant-postes des revendications. Or reconnaître que les faits sont des constructions sociales, c’est-à-dire le produit d’une activité sociale, ne veut pas dire que les faits se résument à des représentations, à des ressentis, à des interprétations. Mais sous l’effet du postulat postmoderne posant que les paroles, les discours et les représentations qui « enveloppent » les faits en déterminent la nature, ces deux aspects de la réalité sont confondus. Dans la perspective identitariste postmoderne, la « réalité » est ce que les individus en disent en résonance avec une intériorité d’autant plus importante qu’elle est une subjectivité de victime assurant une connaissance morale supérieure. Et puisque l’expérience de chaque individu en tant que membre d’une communauté est, axiomatiquement, irréductible à celle d’un membre d’une autre communauté, l’espoir d’un terrain d’entente dans le débat rationnel ne peut être qu’une illusion.
L’ouvrage récent de Stéphane Beaud et de Gérard Noiriel, Race et sciences sociales, pointe également la tendance des théories identitaires à remplacer la question sociale par la question raciale et, par là même, à ignorer la lutte des classes.
Oui, c’est effectivement un des reproches majeurs qui est aujourd’hui adressé aux théories et aux politiques des identités, mais aussi à une certaine gauche française qui a, à tout le moins, théorisé le fait que les classes populaires ne devaient plus être le cœur de cible de ses attentions politiques. L’importance donnée aux communautés minoritaires et aux oppressions aurait en quelque sorte conduit à faire l’impasse sur les revendications sociales. Les rapports sociaux de classe auraient été, en quelque sorte, engloutis par l’intérêt porté aux rapports sociaux de race et, plus modestement, de sexe. Stéphane Beaud et Gérard Noiriel ont mis en avant que ce focus sur les questions identitaires conduisait à occulter les facteurs sociaux, et ce, bien que les critères socio-économiques continuent à jouer un rôle central dans l’existence sociale des individus, sans être pour autant les seuls. Ils évoquent, à cet égard, l’existence d’une forme de « social blindness » qui ferait l’erreur de minorer ce qui pourtant continue à apparaître comme le facteur déterminant autour duquel s’affirment les autres dimensions de l’identité des personnes et, par là même, contribuerait à dédouaner les classes supérieures de leurs responsabilités.
Sans doute faut-il préciser que l’« identitaire » ne s’oppose pas au social, tant s’en faut, et il s’agit de se donner les moyens de les saisir dans leur rapport dialectique. De fait, les approches dites intersectionnelles se sont présentées comme une perspective susceptible de prendre en compte les rapports de classes, de genre et de « race » à égalité, mais dans les faits, elles ont assez souvent été l’occasion de majorer la race et/ou le genre au détriment de la classe. Certains féminismes considèrent, par exemple, que les rapports sociaux de sexe ou de genre sont la pierre angulaire de la domination capitaliste. D’autres considèreront que ce sont les rapports sociaux de race et d’autres encore, estimeront que c’est le rapport aux animaux ou l’écologie qui sont la clé de voute du progrès social. Bref, tout le monde voit l’émancipation à sa porte et en vient à estimer que ce sont ses revendications qui ne sont pas seulement les plus importantes, mais aussi les plus effectives, rendant obsolète, par la même occasion, tout effort pour construire une citoyenneté globale de plein exercice s’exerçant dans tous les espaces sociaux, et plus encore, évidemment, une unité de classe. En somme, se rejoue, là, le travers de la contradiction principale du marxisme le plus trivial, considérant qu’il y a une forme de domination prévalant sur les autres et, in fine, de désigner un ennemi principal et faire le tri entre les victimes. Une intersectionnalité véritablement portée par un esprit de synthèse est évidemment intéressante dans la mesure où, précisément, elle prend au sérieux la nécessité d’un cadre intégrateur. Dernièrement, dans un « Manifeste pour la science sociale » publié dans la revue en ligne AOC, Bernard Lahire réhabilite l’effort totalisant et souligne le danger des épistémologies par trop relativistes, nominalistes ou constructivistes qui auraient tendance à produire des points de vue irréconciliables, c’est-à-dire des identitarismes théoriques relativistes et guerroyants.
Vous avez un exemple ?
Je me souviens d’une tribune dans laquelle des collègues dressaient une carte de l’espace social français divisé en deux : d’un côté, les classes dominées racisées, de l’autre, les classes dominantes blanches. Sociologiquement parlant, une telle description est une stricte bêtise. Que fait-on, par exemple, de X, 20 ans, mâle, blanc, hétérosexuel, peu diplômé qui travaille en 3-8 sur une chaîne de montage ? Dominé ou dominant ? D’aucuns auront tôt fait de répondre « dominant » ! Pourquoi ? Parce qu’il y aurait une « complicité objective » entre prolétaires blancs et bourgeoisie, la seconde permettant aux premiers de ne pas être tout en bas de l’échelle sociale ! Pour Beaud et Noiriel, la conséquence de ce type de raisonnement accentue inévitablement les divisions au sein des classes populaires et rend pour le moins difficile la construction d’une contre-hégémonie. En insistant surla perpétuation de structures de domination issues du passé colonial, la mouvance identitariste décoloniale tend à ne pas tenir compte du contexte capitaliste qui en est l’écosystème. Si le capitalisme n’est pas l’inventeur des oppressions patriarcales, racistes, etc., il en est bien, aujourd’hui, le cadre général, dans la mesure où il utilise, aggrave et creuse toutes les inégalités qui lui permettent de tirer les conditions de vie de l’ensemble des classes populaires vers le bas, notamment par la mise en concurrence des travailleurs. Les discriminations qui pèsent sur celles et ceux qui sont directement visés par elles ne sont pas strictement identitaires, car elles pèsent également, d’une autre manière, sur l’ensemble de celles et ceux qui vendent leur force de travail. Ne pas en tenir compte, c’est, politiquement, renoncer à la possibilité d’une émancipation globale pour ne viser que des libérations partielles et situéesà partir des expériences concrètes de chacun, et donc n’imaginer que des prises de pouvoir localisées et focalisées sur des points précis liés à la vie des personnes. La nécessité stratégique est alors diluée dans l’empowerment. Et du point de vue épistémologique, ce type de positionnement peut conduire à une balkanisation des savoirs et au morcellement des discours scientifiques, y compris au sein d’une critique qui se focalise pour l’essentiel sur les rapports de domination et les logiques d’émancipation. Un constructivisme conséquent doit, certes, faire montre d’imagination sociologique et s’intéresser à la vue qui crée le point de vue car c’est là une des opérations qui permet un véritable travail d’objectivation, mais cette importance ne doit pas être une prévalence absolue. La créativité conceptuelle ne vaut que si elle sert à saisirles structures objectives de la réalité sociale dont il faut rendre compte, non pas depuis une posture esthétique, mais depuis une exigence de description, d’explication et de compréhension en correspondance fidèle avec les faits concrets observés.