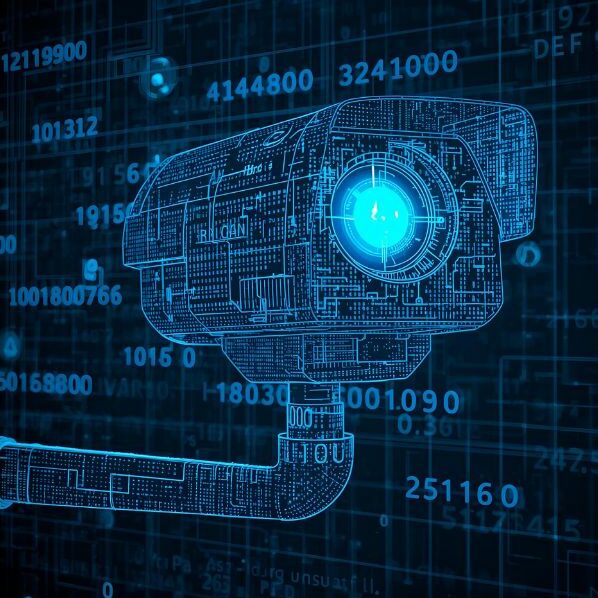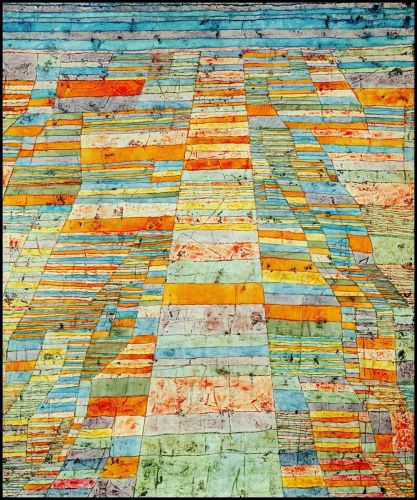Séminaire — UZ-topies et ‘‘territoires critiques’’ : penser Uzeste (saison 1) / 2015
Le séminaire « UZ-topies et ‘‘territoires critiques’’ : penser Uzeste (saison 1) » est un des espaces de travail du projet collectif de recherche porté par le CEMTI : « UZ-Topies à vivre. Territoires critiques, logiques émancipatoires, résistances et cultures populaires en ‘‘Jazzcogne’’ ». Cette recherche a vocation à saisir le travail mené à l’année à Uzeste (village du Sud Gironde, notamment connu pour être le camp de base de la Compagnie Lubat, ainsi que pour ses « hestejadas » estivales), afin de faire émerger des résistances populaires qui pèsent et agissent au quotidien (mobilisations esthétiques, théoriques et sociales). Le présent séminaire abordera quelques uns des aspects méthodologiques et théoriques de cette recherche en construction et devrait se dérouler tout au long de l’année universitaire 2015-2016 (saison 1 détaillée ci-après, saison 2 : de mars à juin). Ouvert à tou/te/s et abordant des thématiques pouvant intéresser par-delà leur articulation au projet « UZ-Topies », le présent séminaire est également une invitation aux étudiants, doctorants et collègues à nous rejoindre dans cette recherche interdisciplinaire.
PROGRAMME
Séance 1 — Fabien GRANJON : Présentation du projet de recherche « UZ-Topies à vivre. Territoires critiques, logiques émancipatoires, résistances et cultures populaires en ‘‘Jazzcogne’’ »
Séance 2 — Jean-Marc LACHAUD : Que peut (malgré tout) l’art ?
Nous avons aujourd’hui le plaisir d’accueillir Jean-Marc LACHAUD, cette fois pour son dernier ouvrage Que peut (malgré tout) l’art ?, publié cette année dans la collection Ouverture Philosophie chez L’Harmattan. J’ai proposé à Jean-Marc d’intervenir dans le cadre du présent séminaire parce qu’il me semble que la réflexion qu’il mène sans faillir et depuis de nombreuses années, sur la fonction critique de l’art, rentre à l’évidence en résonnance avec les intérêts de connaissance qui se trouvent au principe de notre recherche sur Uzeste. De fait, à Uzeste, le travail critique part de l’art. La compagnie Lubat est l’élément central d’une critique visant la construction d’un espace de résistance depuis des mobilisations esthétiques.
Vous connaissez sans aucun doute déjà Jean-Marc et les travaux qu’il a commis, mais je me permets de refaire rapidement les présentations : JEAN-MARC LACHAUD est philosophe, Professeur d’esthétique à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, chercheur au sein de l’institut ACTE et entres autres choses, membre du comité éditorial d’Actuel Marx et du comité de rédaction de Recherches en Esthétique. Jean-Marc est spécialiste théories esthétiques et sur les pratiques artistiques du XXème siècle qu’il examine notamment à l’aune de leur charge politique et des rapports qu’elles entretiennent avec les théories critiques de la société.
Avec le titre de son dernier ouvrage Que peut (malgré tout) l’art ?, Jean-Marc nous invite évidemment à réfléchir concrètement au rôle que l’art joue ou peut jouer dans la constitution de sujets individuels et collectifs critiques participant à l’élaboration, à l’implémentation et à l’efficace d’une praxis social émancipatoire. Évidemment, l’art peut être directement, mais souvent superficiellement critique quand il se fait simple référence à une extériorité politique dont il fait mention, message ou position. Simple support d’une critique qui lui serait externe, il peut aussi être critique depuis des ressources internes, de manière plus profonde, en ce qu’il peut être l’opérateur d’une imagination et d’un sensible à l’œuvre, c’est-à-dire d’une volonté libératrice en acte qui s’exprime en gestes, en son, en paroles, en matérialité dans une adresse à l’autre. C’est à la fois beaucoup et bien peu. Comme le note Olivier Neveux dans sa préface, je le cite, « Jean-Marc Lachaud sait trop bien que l’art ne saurait se confondre sans reste avec la politique et se méfie des proclamations qui en dévitalisent la singularité. L’art n’est chose ni suffisante ni insignifiante ».
À Uzeste, la musique et plus largement les autres arts qui viennent s’y greffer sont effectivement pris au sérieux dans leurs potentiels et, comme le souligne Jean-Marc, « fouillent par la pratique indocile de leur art conçue comme une utopie concrète, d’inimaginables horizons à-venir, possibles-impossibles ». Une intervention de la compagnie Lubat est toujours, en effet, une tentative de mettre « du chaos dans l’ordre » pour reprendre les mots d’Adorno, de faire éclore un surgissement qui prend à contrepied. « Si l’art n’a pas un pouvoir transformateur concret, souligne Jean-Marc, il porte en lui la farouche nécessité du changement, nécessité qu’il conserve et transmet parce que les lois qui le régissent ne sont pas celles de la réalité, et qu’elles n’hésitent pas à entrer en conflit avec celle-ci ».
Si l’art peut être plus substantiellement critique c’est parce qu’il se trouve en capacité d’exprimer la force du potentiel, de donner en quelque sorte une forme à l’utopie, d’incarner l’espoir, de révéler les potentialités émancipatrices à la base d’expérimentation sociales alternatives. Pour le dire autrement, l’essence de la vérité artistique serait donc contenue, et je reprends là Jean-Marc, « dans la rupture qui sépare l’art de la réalité établie, autrement dit, dans l’autonomie de l’œuvre d’art acquise au travers de la forme esthétique ». C’est là que résiderait la fonction critique de l’art, sa force politique, dans sa capacité à mettre la sensibilité et la réflexion en état de crise », à être un opérateur de la praxis sociale par révélation de l’irréalisé.
Uzeste est un terrain je crois assez formidable pour envisager concrètement, dans le cadre d’un espace restreint, donc plus facilement observable, ce travail d’un art critique sur les consciences, les dispositions, les habitus, les manières de faire, de penser, de sentir, de ressentir et de développer les contradictions. C’est un terrain idéal pour saisir les réussites et les échecs de ce travail de production critique, les obstacles auxquels il se heurte, les solutions qu’ils trouvent, les contradictions qu’il tend à résoudre et celles qu’il crée, notamment parce que la recherche de nouvelles formes de vie suppose fatalement la mise en tension d’engagements, de sensibilités, de désirs qu’il s’agit d’organiser dans des formes de coopération politique qui ne vont jamais de soi.
À Uzeste, on essaie à l’évidence d’accélérer l’avenir selon les termes de Gramsci et les œuvriers uzestois accélèrent depuis l’art. Sur la façade de l’Estaminet, Théâtre Amusicien, espace d’expérimentation transartistique comme il le définisse, cette autre citation de Gramsci, encore lui : « Il faut avoir une parfaite conscience de ses propres limites, surtout si on veut les élargir ». Eh bien parions que Jean-Marc nous éclairera aujourd’hui sur les nôtres, peut-être les leurs, et peut-être pourrons-nous ensemble, mieux rater, mieux recommencer et enfin peut-être réussir pour recommencer.
Séance 3 — Alain BERTHO : Restituer les connaissances scientifiques
INTRODUCTION FG : Nous sommes donc aujourd’hui réunis pour la troisième séance du séminaire « UZ-topies et ‘‘territoires critiques’’ : penser Uzeste (saison 1). Je vous rappelle que le présent séminaire a été conçu comme un espace de réflexion ayant vocation a abordé quelques uns des aspects méthodologiques et théoriques d’une recherche en cours qui porte sur la manière dont à Uzeste, village du Bazadais ; depuis des mobilisations sociales, théoriques et esthétiques, sont produits à l’année des sujets individuels et collectifs critiques.
La recherche que nous menons actuellement sur place est donc notamment conduite auprès de personnes qui, sans toujours disposer d’un niveau de certification scolaire élevé, disposent en revanche d’un capital culturel relativement important, notamment constitué par des savoirs souvent critiques issus des sciences sociales, de la philosophie politique et des éléments de théories esthétiques, le tout étant évidemment mobilisés et déployés sur un répertoire de pratiques politico-culturelles allant du spectacle à la manifestation en passant par des activités diverses : jardins partagés, médias alternatifs, accueil de migrants, participation active aux élections locales, etc.
Ce terrain uzestois nous place donc face à des publics enquêtés ayant une forte capacité réflexive. Il nous place également dans la position de commited scholars qui réfléchissent à des formes d’individuation et d’engagement desquelles ils participent par ailleurs, certes depuis une activité singulière, scientifique, mais dont la charge est éminemment politique. Il nous place enfin au cœur de sociabilités extrêmement mêlées, entre-mêlées, en-mêlées auxquelles le chercheur participe et qu’il participe évidemment à produire, déplacer, reconfigurer.
Travailler sur Uzeste, c’est réfléchir avec les Uzestois, mais aussi pour les Uzestois, certains tout du moins. Il s’agit donc d’une situation d’enquête qui, si elle n’est pas si rare que cela, est toutefois singulière dans la mesure où elle est indexée à la nécessité d’une praxis inédite qui naît de la rencontre avec des enquêtés qui sont des sujets pensants et agissants qui font voler en éclats le grand partage sujet-objectivant/objet-objectivé et nous invite à penser d’un peu près la dialectique connaissance/action.
Uzeste nous invite donc à penser la place que nous, chercheurs critiques, pouvons occuper au sein des espaces où s’exercent déjà certaines formes de critiques sociale et/ou esthétique et dans lesquels existe une demande évidente pour l’acquisition de connaissances qui pourront se transformer rapidement en des formes d’expression publique, les conditions pratiques de telles traductions pouvant être pour partie assurées par ces collectifs.
Lors d’une visite en Afrique du Sud en 1990 (et en évoquant l’Afrique du Sud nous restons proche d’Uzeste qui a notamment travaillé avec Soweto), Michael Burawoy s’étonnait par exemple de constater que les sciences sociales y sont pour l’essentiel conçues comme une confrontation, je le cite, « à côté de divers publics, aux questions publiques ». Et de découvrir, je le cite toujours : « l’étroite relation existant entre la sociologie et les luttes anti-apartheid, en particulier par l’intermédiaire des syndicats de travailleurs mais aussi de diverses organisations de défense des droits civiques. Alors qu’aux États-Unis nous faisions la théorie des mouvements sociaux, en Afrique du Sud les sociologues organisaient des mouvements sociaux ! […] La sociologie sud-africaine ne s’est pas seulement intéressée aux mobilisations sociales, mais également à leurs cibles. Les sociologues ont analysé les caractéristiques et les orientations de l’apartheid d’État, débattu de la stratégie du mouvement destiné à y mettre fin, et se sont demandé s’ils devaient être des auxiliaires du mouvement ou dans un rapport critique » (Burawoy, 2009 : 138).
Il me semble qu’un terrain comme celui d’Uzeste nous pousse à un questionnement prospectif relatif aux fins, aux moyens et aux valeurs des programmes de recherche en vue de dégager, comme le suggère Lukács : « une vision claire de la réalité en vue de l’action » (Lukács, 1923 : 258). Mieux comprendre ce que l’on cherche à changer et par là même, par cette meilleure connaissance, de mieux le transformer. Redonner en somme, au politique toute la place qu’il doit avoir entre la réalité sociale et les idées que l’on s’en fait.
S’y attacher, c’est évidemment faire écho au débat que Michael Burawoy a ouvert autour de la nécessité d’une critical public sociology depuis laquelle il recommande notamment de « rendre les savoirs à celles et ceux qui en sont à l’origine ». Pour Burawoy et bien d’autres chercheurs critiques avant lui, il s’agit donc de réfléchir à nos interventions au sein d’espaces collectifs et alternatifs afin de proposer, d’initier ou d’infléchir des questionnements qui conviennent, comme le suggère Élias, « à la résolution des véritables problèmes » (Elias, 1993 : 34). C’est aussi sans doute l’occasion de border les « illusions de la logothérapie » (Mauger, 2002), c’est-à-dire de se prémunir de « la croyance dans la toute puissance performative du logos académique » (Neveu, 2003 : 118).
Et pour penser d’un peu près la chose, j’ai pensé qu’il nous serait particulièrement utile de bénéficier, en ce domaine, de l’expérience d’Alain BERTHO qui a bien voulu se plier au jeu du séminaire et a donc accepté notre invitation. Aussi, permettez-moi encore quelques mots de présentation de notre invité du jour… Alain BERTHO est anthropologue, président du CNU d’anthropologie, directeur de la MSH Paris-Nord après avoir été directeur de l’École doctorale Sciences sociales à Paris 8, université où il enseigne dans le cadre de l’Institut d’Études européennes. Voilà pour ce qui est des médailles…
Surtout, Alain est l’auteur de nombreux articles et ouvrages portant sur les luttes sociales, l’altermondialisme et plus récemment sur les formes les plus radicales de l’action collective : émeutes, soulèvements insurrectionnels, révolutions. La liste est longue et je ne citerai que les plus récents : Le temps des émeutes, sorti chez Bayard en 2009 et Nous-autres, nous-mêmes, ethnologie politique du présent, publié aux éditions du Croquant en 2008. Parmi les nombreux articles qu’Alain a commis, il en est un qui retiendra, ici, dans le cadre de cette séance, peut-être davantage notre attention. Il porte comme titre « Les mots et les pouvoirs », hommage à Foucault évidemment, dans lequel Alain se propose justement de réfléchir aux perplexités et réajustements successifs de son itinéraire de commited scholar, à la fois savant et politique, qui arpente des espaces d’intellectualité et de pratiques qui se nourrissent l’un l’autre, qui ne vont pas l’un sans l’autre.
Dans et article fort intéressant d’objectivation-historicisation du sujet objectivant, Alain explique pourquoi, au début des années 1980 est fondé dans la mouvance du PCF le Centre de Recherches et d’Études sur la Société Française qui fait de l’enquête l’outil de production d’un savoir non scolastique à partir d’une hypothèse méthodologique, épistémologique et politique : celle de la nécessité d’une « communauté scientifique élargie ». Cette hypothèse de la communauté scientifique élargie faisait sienne l’idée d’un savoir social populaire qui ne pouvait se résumer ni à de l’idéologie ni à du sens commun et qui devait être produit par un travail commun de réflexion pratique avec des sujets sociaux qui n’étaient pas des scientifiques.
Quand cette expérience collective pris fin, au mitan des années 1990, Alain réinvestira la libido sciendi qui allait avec, dans la construction d’une MST « Formation à la connaissance des banlieues », maîtrise au cœur de laquelle avait été singulièrement placée l’enquête. Pendant près de dix ans, accompagné de Toni Negri, Maurrizzio Lazzarato, Sylvain Lazarus et les étudiants de cette formation, Alain réalisera une enquête annuelle qui donnait notamment lieu à des restitutions sous diverses formes s’adressant à des publics plus ou moins larges constituant cette communauté scientifique élargie
Comme le note Alain dans cet article, je le cite : « La publicité relève en fait, d’abord, d’une exigence déontologique sur cette production elle-même : il s’agit de restituer à tous les profanes ordinaires, la mise en ordre d’un savoir dont ils ont été la matière et la source. Avant tout, les discours sur le réel que produisent les professionnels des sciences sociales sont un bien public. Nos enquêtes ne sont pas des enquêtes de police et nos conclusions ne peuvent raisonnablement appartenir à aucun commanditaire ». À l’évidence, Alain est donc l’homme de la situation et c’est avec grand plaisir et mes remerciements chaleureux que je lui passe la parole.
Séance 4 — Jean-Louis LEGRAND : Récits et histoires de vie
INTRODUCTION FG : Nous allons ouvrir la troisième séance du séminaire « UZ-topies et ‘‘territoires critiques’’ : penser Uzeste (saison 1) », première séance de l’année 2016. La séance de ce jour sera plutôt d’ordre épistémologique et méthodologique, puisque nous avons la chance d’avoir parmi nous Jean-Louis LEGRAND, collègue Professeur à l’Université Paris 8 en sciences de l’éducation, que l’on a invité parce qu’on l’aime bien, mais aussi parce qu’il est spécialiste des histoires et des récits de vie. Il m’a semblé important de consacrer une séance à ce thème dans la mesure où le terrain uzestois auquel ce séminaire est lié nous amène assez directement à réfléchir aux conditions d’enquête (c’était le propos de la dernière séance), mais aussi aux modalités pratiques de l’enquête dans la mesure où une large partie de ladite enquête est consacrée au saisissement des structures de sensibilité critiques uzestoises.
Comment fait-on pour travailler sur des structures de sensibilité entendues comme des formes spécifiques de disposition ? Travailler sur une disposition nécessite en premier lieu de repérer ses origines (sociogenèse) : quels sont le ou les contextes socialisateurs qui ont littéralement produit cette disposition ? Mais également quels sont ceux qui lui ont permis de se maintenir active, de rester une ressource pour l’action, ou bien de ne plus avoir qu’une prégnance faible voire nulle dans les manières d’être et de faire ? À l’évidence, il existe des formes différenciées de socialisation. Comme le souligne Barnard LAHIRE, « Toutes les dispositions à croire, agir, sentir, penser d’une certaine manière n’ont pas bénéficié des mêmes conditions de socialisation et ne peuvent donc pas avoir la même force, le même degré de permanence et la même capacité à se transférer d’un contexte à l’autre » (Lahire, 2012 : 41).
L’incorporation des dispositions par les expériences socialisatrices induit l’idée d’un temps long ou d’une répétition de situations permettant une imprégnation lente du sujet social. Les logiques d’acquisition et de dévolution des structures de personnalité peuvent toutefois relever d’autres types d’expériences sociales, liées à des phénomènes de rupture, de « choc » ou de traumatisme.
S’interroger sur la manière de travailler sur des dispositions, ne peut également faire l’impasse sur la manière dont les schèmes d’orientation des conduites cohabitent au sein même du sujet social. La structure des apanages dispositionnels se fonde sur des formes de hiérarchisation qui, en quelque sorte, n’affectent pas les divers phénomènes de « propension à » d’un même coefficient de puissance et de durabilité. Si les dispositions étaient équivalentes en force, le contexte aurait seul le statut de vigueur activatrice et jouerait bien le rôle du déclencheur (le contexte irait en quelque sorte « chercher » la disposition). Or la réalité empirique porte à envisager que la mobilisation d’une disposition tient aussi à la place et à l’importance que celle-ci occupe au sein du legs des possibilités anticipatrices pratiques dont le sujet social est diversement en capacité. Aussi, doit-on également se questionner sur la manière dont les dispositions se structurent les unes vis-à-vis des autres car s’il est évident que « les dispositions n’agissent pas [la plupart du temps] de manière permanente », cela ne veut pas dire pour autant qu’elles deviennent actives « seulement [c’est nous qui soulignons] en fonction des contextes d’action qui se présentent » (Lahire, 2012 : 39), mais parfois aussi malgré lesdits contextes. Comme le reconnaît Lahire, il existe aussi « des dispositions permanentes (transcontextuelles) » qui, si elles ne sont sans doute pas les plus communes, n’en sont pas moins parmi les plus intéressantes à étudier de par leur nature singulière qui semble devoir faire des individus qui en sont porteurs des sujets moins « perméables » aux contextes, plus résistants pourrait-on dire. Dans notre enquête, il va notamment s’agir d’envisager le degré d’intégration des dispositions, éventuellement en un ou des habitus critiques qui les colligent et les renforcent sans pour autant avoir à postuler, d’une part, que les patrimoines dispositionnels se résument à cet ou ces habitus et, d’autre part qu’ils se transfèrent et agissent automatiquement quel que soit le contexte.
L’habitus considéré « comme formule génératrice des pratiques », c’est-à-dire comme « principe générateur et unificateur » des comportements n’est pas une simple vue l’esprit. Il est à considérer comme une configuration dispositionnelle singulière colorant fortement la « personnalité » d’un individu du fait de la durabilité et de la transférabilité des dispositions qui le constituent. Ce niveau élevé d’intégration révélant une proximité importante de la nature des dispositions incorporées contribue à ce qu’elles se renforcent entre elles. Mais aussi remarquable soit cette solidarité et aussi importante soit sa place au sein de l’économie psychique des personnes, elle ne saurait être permanente. Le caractère cumulatif de ces dispositions n’est pas nécessairement continu et ne peut rendre pleinement compte de la complexité dispositionnelles des sujets sociaux. Aussi, l’habitus ne devrait-il désigner, au sein d’un patrimoine de dispositions, que les organisations dispositionnelles les plus interdépendantes.
Une troisième base de questionnement devra enfin être consacrée à une « éthologie » des dispositions : en quelles occasions sont-elles activées ? Quelles sont les conditions de leur perpétuation, celles de leur conversion, de leur transformation, de leur mise en sommeil ou encore de leur dépérissement ? Il s’agit notamment de ne postuler, comme nous y invite Philippe Corcuff, « ni l’unité des dispositions ni le degré de leur durabilité, ni même leur activation dans toutes les circonstances de la vie quotidienne » (Corcuff, 2003 : 80). Lahire insiste notamment sur le fait que les dispositions ne sont pas des habitudes immuables que l’on collectionnerait et stockerait à mesure de la complexité biographique grandissante de chacun : « on n’a pas affaire, affirme-t-il, à une actualisation systématique des mêmes dispositions (du même système de dispositions ou de la même formule génératrice des pratiques), mais à un jeu complexe d’activation et d’inhibition des différentes dispositions incorporées qui peuvent se combiner partiellement entre elles dans certaines situations, ou fonctionner parfois indépendamment les unes des autres dans d’autres situations ». Et de poursuivre, je le cite toujours : « [pour Bourdieu], l’acteur individuel […] n’est donc pas fondamentalement marqué, dans son patrimoine de dispositions et de compétences, par la pluralité des contextes sociaux fréquentés. Produit mono-socialisé, il semble ne découvrir la pluralité extérieure à lui que dans un second temps. […] Ce qui est présupposé, c’est l’existence d’un habitus qui est Un, systématique, homogène – une formule génératrice de pratiques, qui se traduirait dans des champs aux propriétés et aux possibles différents. Les individus vivent dans des sociétés différenciées mais leur habitus n’en est étrangement pas affecté ; tout se passe comme s’ils étaient protégés d’une hétérogénéité qu’ils ne rencontrent qu’après avoir été constitués dans des conditions sociales homogènes » (Lahire, 2012 : 39 et 140-141). Le volume et la diversité dispositionnels de chaque personne sont potentiellement sujets à des variations conduisant certaines dispositions à acquérir davantage de force, s’amenuiser, gagner de nouveau en robustesse (atavisme) ou parfois disparaître, selon des trajectoires qu’il s’agit évidemment, en chaque cas spécifique, de repérer. Ce qu’il s’agit de saisir avec le plus de précision possible tient donc à la fois à la mobilisation des dispositions dans leur articulation à des contextes variés qui peuvent les déclencher, les inhiber, mais aussi les défaire, les altérer, les modifier.
Entreprendre le saisissement de ces différentes dimensions sur le terrain uzestois nous a amené à considérer que nous ne pouvions faire l’impasse sur cet appareil de preuves que constitue le récit de vie ou le récit de pratiques. Dans le terrain exploratoire que nous venons de terminer il y a dix jours, nous avons par exemple mis en place un tel dispositif avec Bernard Lubat puisque que nous avons effectué une quinzaine d’entretiens avec l’intéressé qui devrait donner d’ailleurs lieu à un ouvrage dans les mois qui viennent.
Les histoires et récits de vie et/ou de pratiques sont évidemment bien plus que de simples techniques d’enquête anthropo-sociales. L’ouvrage intitulé Les Histoires de vie, que Jean-Louis a notamment commis avec Gaston Pineau au PUF, il y a maintenant plus de 20 ans en rend parfaitement compte. Histoires de vie et récits de pratique participent d’un mouvement anthropologique plus large où comme ils le soulignent, « l’expression des vécus personnels constitue un moyen vital de reconnaissance, de connaissance et même de naissance de soi et des autres ». Technique d’enquête les histoires et récits de vie peuvent aussi être des formes d’invention de soi et de formation. Cet aspect nous intéresse également, car comme nous l’avions précisé lors de la dernière séance, les publics uzestois enquêtés sont des sujets pour le moins réflexifs.
Quand Bernard Lubat, après 20 ans d’absence, revient s’installer à Uzeste, il découvre un village qui est en train de mourir à petit feu et dont l’historicité rurale tend à disparaître, c’est-à-dire qu’elle semble mettre de moins en moins en mouvement la population qui au mieux s’en réclame sur le mode mémoriel. Pour contrecarrer cette dynamique mortifère, et réinscrire l’histoire d’Uzeste dans un mouvement social et culturel, Bernard Lubat trouvera une solution : faire des histoires, de ces histoires qu’il s’agit de faire sienne, de rendre collective parfois au risque du mythe et dont les histoires de vie, bien évidemment participent. Remettre dans l’agora uzestoise les histoires et récits de vie que l’on produira en collaboration avec nos enquêtés contribue modestement à ce mouvement d’entretien de l’histoire qui s’appuie sur le passé pour ouvrir des commencements et des recommencements.
Séance 5 — Dalila BOITAUD : Uzeste et la créolisation
INTRODUCTION FG : Pour l’heure, nous accueillons aujourd’hui Dalila BOITAUD-MAZAUDIER dont l’une des particularités tient au fait qu’elle est Uzestoise et qu’elle vient donc nous rendre aujourd’hui visite à double titre, en tant qu’actrice de la scène uzestoise et vous verrez que le terme n’est pas du tout usurpé, mais aussi, évidemment, en tant qu’analyste de cette scène uzestoise. Ces deux casquettes me semblent tout à fait précieuses et j’aimerais rappeler, à ce titre, une chose qui me semble essentielle.
Le terrain uzestois dont l’objectif est en gros de faire retour sur la culture populaire de résistance qui se développe à Uzeste, participe également d’un rapport spécifique du chercheur à son objet de recherche. Traduite dans l’idiome lubatien, notre démarche pourrait être qualifiée de « co-é-llabor-active » puisqu’elle tente d’examiner des formes d’individuation et d’engagement qu’elle soutient foncièrement, et auxquelles elle souhaite prendre part depuis une activité singulière, à la fois scientifique et politique. En travaillant sur Uzeste, il n’est pas possible de faire l’économie d’avoir aussi à réfléchir avec les Uzestois, mais également pour ces derniers certains tout du moins, ce qui ne veut pas dire à leur place et l’invitation lancée à Dalila en est la preuve.
Conduire une recherche de ce type, revient donc à accepter d’avoir à prendre sa part et de prendre la responsabilité de s’associer à la praxis de celles et ceux que l’on interroge et que l’on reconnaît comme des sujets pensants et agissants. Cette posture fait évidemment voler en éclats le grand partage sujet-objectivant/objet-objectivé et nous invite à reconsidérer la dialectique de la connaissance et de l’action sous l’angle d’une élaboration de parcours singuliers dans des espaces politiques d’intellectualité et de pratiques à la fois savantes et populaires, se nourrissant l’une de l’autre et n’allant pas l’une sans l’autre.
Un terrain comme celui d’Uzeste pousse donc le chercheur critique à un questionnement prospectif relatif aux fins, aux moyens et aux valeurs de son travail d’enquête en vue de dégager, comme le suggère Georg Lukács, « une vision claire de la réalité en vue de l’action ». Autrement dit, il s’agit de redonner au politique, dans l’activité scientifique, la place qu’il doit prendre entre la réalité sociale et les idées que l’on s’en fait, sous condition de la pratique.
Cette nécessité pèse par ailleurs d’autant plus fortement qu’elle se trouve relayée, à la base, par des demandes explicites d’aide à la réflexivité et d’acquisition de connaissances, lesquelles ont vocation à être traduites en des formes d’action et d’expression publiques par celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre ce qu’ils cherchent à changer, la manière de le faire et, par cette meilleure connaissance, mieux le transformer. S’il s’agit donc, comme le suggère Michael Burawoy de rendre les savoirs à celles et ceux qui en sont à l’origine[1], il s’agit peut-être, plus encore et plus en amont, de conduire un travail commun de réflexion pratique permettant d’initier, de reprendre ou d’infléchir des questionnements convenant à la résolution des problèmes concrets qui se posent aux sujets de l’investigation scientifique.
Le terrain uzestois entend donc construire une « localité » constituée de contributions collectives et partagées où l’espace de la pratique scientifique se trouve relié à l’espace des pratiques populaires par une politique critique de l’enquête pleinement assumée.
Donc si Dalila est parmi nous aujourd’hui, c’est une conséquence de ce cadre spécifique d’exercice de l’activité scientifique. Aussi, bien évidemment, je souhaiterais vous dire deux mots de notre invitée. Dalila est auteure et metteur en scène, elle dirige depuis douze ans la Compagnie UZ et Coutumes basée à Uzeste, compagnie qu’elle monte après avoir collaboré pendant quatorze ans aux travaux de la Compagnie Lubat de Gasconhà.
La compagnie de théâtre UZ et Coutumes est reconnue par les institutions nationales et signe en 2013 sa dixième création, avec la volonté de défendre un théâtre politique. En 2013 toujours, elle reçoit la Bourse « Auteurs d’Espaces publics » de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) pour sa pièce de théâtre HAGATI YACU / ENTRE NOUS, poème urbain de la guerre, du soleil et de la mélancolie, en mémoire des tutsi du Rwanda, adaptée en partie du roman de Boubacar Boris Diop Murambi, le livre des ossements.
Dalila enseigne par ailleurs à l’Université Bordeaux 3 et prépare actuellement un ouvrage autour de la question des sites mémoriels au Rwanda et de l’art théâtral comme dialogue des mémoires, mais si nous l’avons invitée, c’est pour qu’elle nous apporte ses lumières sur un point particulier de la dynamique uzestoise, à savoir les processus de créolisation qui s’y jouent et dont l’activité d’UZ et Coutumes est je crois un bel exemple.
Comme vous le savez, Édouard GLISSANT est LE penseur, avec quelques autres, de la créolisation et il se trouve, mais ce n’est pas un hasard, qu’il a été un compagnon de route essentiel d’Uzeste. Dalila a donc eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises avec lui et il m’a donc semblé intéressant de lui demander de nous éclairer sur les processus de créolisation qui ont été initiés depuis Uzeste, puisqu’elle s’est trouvée et continue de s’y trouver aux première loges.
Dans l’ouvrage Les UZ-topies de Bernard Lubat, celui-ci affirme à un moment donné de nos entretiens, la chose suivante, je le cite : « Il faut « former les rangs-contre », pour réfléchir-penser-agir du local au mondial, ne pas se laisser enfermer dans son propre terrier, se rendre solidaire de l’humanité. Uzeste-Musical est un centre du monde, local, qui se dialectise avec le reste du monde. Les œuvriers-créateurs de la Compagnie sont des « localchimistes universalistes », des artistes et techniciens du spectacle qui portent haut et loin la fierté de la ruralité, mais d’une ruralité nouvelle, consciente de la nécessité du dialogue avec l’ailleurs, avec l’extérieur, une ruralité contemporaine qui se voudrait notamment débarrassée de ses complexes politiques et culturels. S’inventer ne peut se faire sans le concours de ceux qui se cultivent « d’ici d’en » et d’ailleurs, de ceux qui se sont cultivés, exprimés, partout de par le monde, passé, présent, avenir du futur compris. Du passé, il s’agit de faire table offerte à l’avenir dans un présent qu’il faut débarrasser des conformités et des appellations contrôlées de la religion, du marché, de la religion du marché. La vie, le vivant est constitué d’une diversité de propositions, d’expérimentations, de partis pris, de paris inouïs par rapport auxquels il s’agit d’être à la hauteur ».
L’idée d’une identité vivante, en mouvement, qui se construit et s’étend dans sa relation à l’autre est, je crois, un pilier de la pensée uzestoise. Dans un entretien donné à Jazz Magazine (n° 159, juillet/août 2009), Glissant affirmait ceci, je cite : « Il n’y a pas de continuité logique dans l’apparition de phénomènes de créolisation. C’est de l’ordre de l’inattendu. Dans le cas du jazz, la création d’une communauté dominée, martyrisée, réduite à l’état d’animalité, sans possibilité d’évolution dans aucune direction et ayant tout perdu dans les bateaux négriers. Les Africains-Américains sont arrivés nus, sans aucun instrument. C’est pour cela qu’ils ont dû se reconstruire, en fouillant les traces de leur mémoire, et c’est à partir de cette simple trace de l’Afrique, qu’ils vont inventer le jazz. C’est-à-dire l’expression de ces traces ».
En d’autres termes, la créolisation tient à la construction, depuis la trace d’un chant, de l’inédit qui permet de s’interfacer à l’autre, d’échanger avec lui, s’en trouver changer, mais sans pour autant perdre son originalité dans cet échange. Glissant estime que contrairement au métissage, la créolisation relève d’un processus d’interpénétrabilité culturelle, une « poétique de la Relation » dont les résultats sont imprévisibles. Pour autant, ajoutait-il : « la poétique de la Relation n’est pas une poétique du magma, de l’indifférencié, du neutre. Pour qu’il y ait relation, il faut qu’il y ait deux ou plusieurs identités ou entités maîtresses d’elles-mêmes et qui acceptent de changer en s’échangeant » (1996 : 42).
Dalila, la parole est à toi…
[1] Cf. Burawoy (Michael), « Pour la sociologie publique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 176-177, 2009, pp. 121-144.