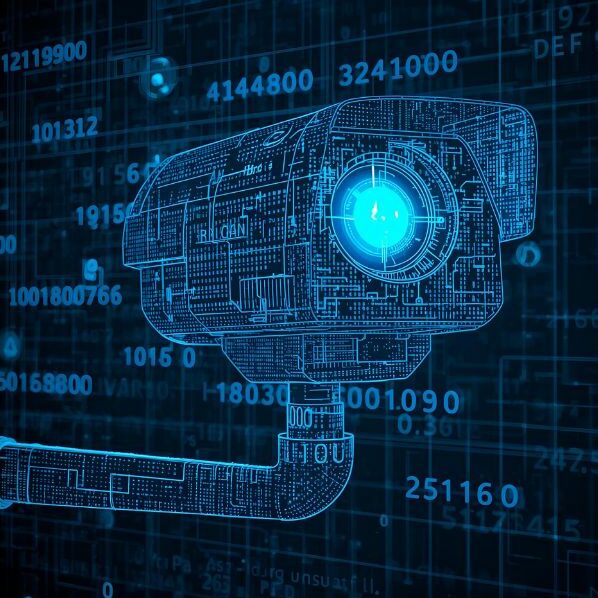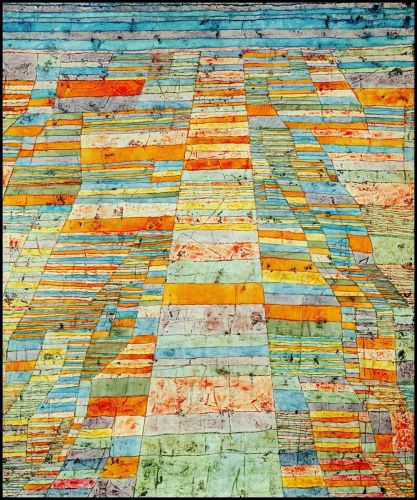Intervention – Instrumentation numérique et action publique : un bilan critique – Carrefour de l’inclusion numérique
Instrumentation numérique et action publique : un bilan critique
[…] Le mandat qui m’a été confié, est de vous dresser et de vous adresser un bilan critique nécessairement partiel de cette rencontre de l’action publique avec cette dynamique que l’on désigne par un vocable dont j’aimerais commencé, d’entrée de jeu, par dire qu’il me semble en fait plutôt inadapté. Ce mot, vous vous en doutez, c’est la dématérialisation.
Pourquoi le terme serait-il inapproprié ? Parce que ce terme nous invite à penser une « immatérialité » là, où dans les faits, la matérialité des dispositifs numériques n’a jamais été aussi prégnante. Je crois qu’il faut effectivement avoir en tête que le numérique, ce n’est pas seulement des lignes de code, des flux et des algorithmes, mais que c’est aussi et peut-être même d’abord des infrastructures : des bâtiments, des serveurs, des équipements divers, des ordinateurs, des périphériques et bien évidemment des sujets sociaux, des individus et des collectifs qui décident des politiques liées au numérique, qui les implémentent, qui les appliquent et qui font usages des instruments numériques.
Donc d’un certain point de vue, quand on parle de dématérialisation de l’action publique, on parle moins d’un fait technique que d’une logique de réforme de la relation administrative par un processus de numérisation des administrations. Et il faut garder en tête que ladite dématérialisation dont il est question n’est en aucun cas un équivalent de la disparition de toute matérialité.
Ceci étant précisé, j’aimerais également attirer votre attention sur le fait que quand on pense dématérialisation, on pense le plus souvent à ce que cela induit pour l’usager final, et à raison, puisque cela porte effectivement à conséquence pour les administrés et citoyens que nous sommes. Toutefois, il ne faut pas oublier pour autant que ce que l’on désigne donc par « dématérialisation » est un processus complexe qui relève à la fois de décisions politiques, de développements industriels, de régulations institutionnelles et, en bout de course, effectivement, d’usages développés par des citoyens, mais aussi par des agents de l’État qui, eux aussi, subissent avec plus ou moins de félicité la numérisation accrue de leurs environnements de travail.
Une fois ces précisions un peu générales apportées, reste encore à constater qu’aujourd’hui, la dématérialisation est un phénomène mondial qui touche tous les pays occidentaux et aussi de plus en plus les pays du Sud global. L’Organisation des Nations unies a par exemple mis en place, depuis 2003, un E-Government Development Index qui sert à établir des scores d’avancée des États sur le chemin de la numérisation de leurs institutions. Donc l’affaire n’est pas neuve, tant s’en faut.
Si l’on prend cette fois le niveau européen, il est clair que tous les pays, sans exception, ont mis en place des politiques de dématérialisation de leurs administrations. La Commission européenne a par exemple mis en place un programme qui s’appelle Digital Decade et qui a pour objectif d’avancer des « trajectoires de référence » indiquant « la voie idéale à suivre chaque année » afin, je cite, de développer des « infrastructures numériques résilientes et souveraines, capables de défendre les valeurs européennes tout en relevant les défis de notre époque ». Évidemment, au sein des différents états de l’Union, la dématérialisation prend forme à des rythmes divers qui dépendent de multiples facteurs – développement des infrastructures, cadres législatifs et réglementaires, contextes socioéconomiques, etc. – et impliquent que les différents États n’avancent pas à la même allure. Si l’Estonie, Malte ou l’Islande font figures de « bons élèves », les nations du Sud de l’Europe ont des indicateurs de performance moindres, et d’autres – Roumanie, Moldavie, Serbie, etc. – sont nettement plus en retrait.
Alors pourquoi cet engouement pour la numérisation de l’action publique ? Parce que le numérique est censé constituer un atout majeur dans le développement de plans d’action permettant aux États de diminuer la dépense et la dette publiques, de perfectionner les dispositifs du travail administratif, de renforcer les processus décisionnels et d’améliorer les conditions d’exercice des agents publics. Et évidemment, la dématérialisation est aussi censée permettre l’optimisation de la qualité des services et des prestations à destination des usagers. Ce remodelage du modèle d’action publique visant à plus d’efficacité se fonde donc sur un recours accru des administrations à différents moyens et procédés numériques qui toutefois ne vont pas sans poser problèmes, tant ils bouleversent l’organisation des institutions d’État, les pratiques professionnelles de leurs agents et les usages de leurs ressortissants.
De fait, la numérisation des administrations redéfinit le rapport à l’État et plus largement à la citoyenneté. C’est là aussi un point très important car on a parfois tendance à penser que l’arrivée massive du numérique pourrait finalement se résumer à un changement d’instruments, à un changement d’outils. Or quand on change les outils on ne change pas seulement une capacité à faire et à faire faire, on change aussi un rapport à l’institution, à ses missions et à ses pratiques. Pour le dire autrement, quand on change d’instruments, on change des manières de gouvernance, c’est-à-dire les manières dont l’État exerce ce que Michel Foucault appelait sa « fonction stratégique dominante » (Foucault, 1988 : 300), c’est-à-dire une manière d’exercer le pouvoir.
Si on devait reformuler la chose de manière encore plus directe, on pourrait dire que tout changement de dispositif est un changement d’ordre politique. Il faut bien avoir conscience que les outils et la technologie ne sont jamais neutres et qu’ils portent toujours en eux l’empreinte d’une politique dans la mesure où ils vous invitent, voire contraignent à agir d’une certaine manière.
Ce point nous amène d’ailleurs à rappeler qu’il n’y a pas de politique, d’État, d’institutions et d’action publique sans lois, sans règles, sans normes, c’est une évidence et il est tout aussi évident que les institutions ne peuvent non plus exister sans la présence d’objets et de dispositifs techniques qui leur apportent précisément leur force matériel. Donc force est de constater que l’action publique s’est toujours construite à partir de dispositifs techniques, par exemple en s’appuyant sur des appareils statistiques, qui concrétisent des intentions, qui introduisent des systèmes de régulation, qui définissent des finalités et des contenus.
Penser l’instrumentation numérique de l’action publique peut donc épouser différents questionnements, selon que l’on s’intéresse à l’étape de la décision politique, à l’étape d’innovation ou à celle de l’appropriation. Quand on travaille sur la dématérialisation on peut donc essayer de comprendre plusieurs choses, par exemple : s’intéresser aux raisons qui poussent les hauts fonctionnaires et les élus de la République à imposer ces changements ; ou bien s’intéresser à la phase d’innovation, aux choix des instruments et à la manière dont ils sont en quelques sorte programmés pour servir les politiques décidées en amont ; ou bien encore porter attention aux conséquences pratiques des instruments mis en œuvre en s’intéressant, cette fois, aux diverses formes d’usage qu’ils génèrent et aux habitudes qu’ils déplacent.
Aussi, j’aimerais partager avec vous deux-trois choses de chacune de ces phases politique, d’innovation et d’usages…
Concernant la phase politique…
Il me semble qu’il faut insister sur le fait que la dématérialisation est l’œuvre conjuguée de trois logiques idéologiques, à partir desquelles ladite dématérialisation se voit justifiée et mise en acceptabilité. Ces trois configurations idéologiques qui résonnent les unes avec les autres sont : d’une part l’individualisme libéral et la théorie du capital humain, d’autre part, le new public management et, en dernier lieu, l’idée de la start-up nation.
Deux mots rapides sur chacun de ces cadres idéologiques : tout d’abord, l’individualisme libéral et la théorie du capital humain. On pourrait dire que c’est une vision du monde qui promeut une norme d’intériorité qui encourage d’après Robert Castel : à « modifier la conduite des individus en difficulté en les incitant à changer leurs représentations et à renforcer leurs motivations à ‘‘s’en sortir’’, comme s’ils portaient en eux-mêmes la principale responsabilité de la situation dans laquelle ils se trouvent ». L’individualisme libéral porte en fait l’idée d’un individu qui par des investissements volontaires, doit se faire entrepreneur de lui-même, se responsabiliser, travailler à sa réussite personnelle et jouir de soi, comme s’il devait nécessairement disposer en propre des ressources utiles à son épanouissement en dehors de toute médiation collective. Cet impératif à s’armer pour être soicorrespond évidemment à l’idée d’avoir à s’intégrer au mieux aux formes contemporaines de production les plus rentables de biens et de service. Aussi il n’est pas étonnant de constater qu’on trouve dans les discours politiques, médiatiques et même scientifiques de longues tirades à la gloire de la (re)connexion de tous au monde merveilleux du numérique. Il s’agit, là, d’une déclinaison à la mode numérique des théories du capital humain développé par Gary Becker et ses collègues de l’Université de Chicago, au mitan des années 1960, que l’OCDE définit comme déterminant la capacité des individus à stimuler la croissance : concourir à sa propre réussite, travailler à sa bonne santé, accroître ses potentiels (savoir-être et savoir-faire), améliorer son employabilité, sa mobilité, son adaptabilité, sa flexibilité, etc.
L’idée du capital humain va donc de pair avec la rationalité technicienne, au point que d’aucuns avancent l’idée d’un « capital humain numérique », numérique qui est donc souvent présenté comme la condition de possibilité de la montée en compétence et de l’augmentation des potentialités productives individuelles. Il va sans dire que ces dispositions à la performance individuelle sont évidemment très éloignées des situations individuelles de la plupart usagers les plus ordinaires du numérique.
Deuxième pilier idéologique des politiques de dématérialisation : le new public management. Le new public management, c’est une idéologie qui entend justifier la réforme radicale des administrations publiques et notamment celles des États-providence au nom de la nécessité de les rendre plus efficaces et les débureaucratiser. C’est un mouvement international porté par le libéralisme économique qui vise donc à introduire les modes organisationnels du privé et de la rentabilité au sein du secteur public. En France, sous le gouvernement Balladur, il y a donc maintenant 30 ans (là encore, on constate que la chose n’est pas neuve), un rapport avait été remis stipulant que les secteurs de la justice, de la formation, de la culture, de la recherche et même de la cohésion sociale devait à termes, passer aux mains du marché. Depuis, les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, se sont pliés aux principes de ce new public management : les « ordonnances Juppé » réformant la sécurité sociale et le secteur sanitaire ; la loi organique relative aux lois de finances portée par Lionel Jospin ; la révision générale des politiques publiques (RGPP) de Nicolas Sarkozy ; la modernisation de l’action publique (MAP) de François Hollande ; le projet « Action publique 2022 » engagé par Emmanuel Macron ; et plus dernièrement, le projet de simplification de la fonction publique de Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique qui n’a rien trouvé de mieux que de Twitter qu’il se ferait un plaisir d’échanger avec Elon Musk nouvellement nommé par Donald Trump à ce sujet… Le pire est donc sans doute devant nous.
Donc derrière des nécessités d’agilité, de simplification, d’optimisation des fonds publics et de diminution des coûts qui ont pour elles, convenons-en, la force du bon sens se cache donc l’idée qu’il faut laisser au privé le soin d’organiser la chose publique. Dans cette perspective, le citoyen est d’abord vu comme un client, c’est-à-dire un consommateur de services publics pour lesquels l’État doit rendre le meilleur service au moindre coût. Dans ce cadre, il est entendu que l’État devrait se limiter à la fixation des priorités collectives et à leur financement, tandis que l’exécution opérationnelle des missions d’intérêt général devrait être déléguée à des entités autonomes, sous contrat, qui répondent à des normes de pilotage par indicateurs et depuis une logique du résultat.
La déclinaison du new public management à l’ère du numérique, c’est aussi l’idée clairement formulée par le Président Macron d’une start-up nation, troisième piliers idéologiques de la dématérialisation… Derrière l’idée de start-up nation, il y a l’idée de réduire à sa portion congrue l’État-providence quitte à ce que cela fasse courir de sérieux risques : quant à la perte de souveraineté sur la chose régalienne, quant à la perte d’expertise en interne des administrations réduisant leurs capacités d’adaptation, quant à la précarisation des métiers et la mise à mal des professionnalités des agents de l’État, ou encore quant au principe d’égalité de traitement des citoyens sur le territoire national.
L’idée de la Start-up Nation (on parle aussi parfois d’État-plateforme), c’est l’idée de renouveler le modèle économique et industriel national en misant pour l’essentiel sur des innovations de rupture – la robotique, le big data, l’intelligence artificielle, la cyber-sécurité, l’Internet des objets, le deep learning, etc. –, portées par des organisations de la French Tech, attirant des salariés à forte valeur ajoutée en capacité d’effectuer des levées de fond importantes et d’occuper des places compétitives sur des marchés internationaux. La Start-up Nation, c’est en quelque sorte l’idée d’un pays de cocagne numérique peuplé d’entrepreneurs technophiles, obsédés par l’hypercroissance, mais aussi par l’idée d’un État misant sur l’accroissement de la productivité, la rentabilité, la culture de la performance, l’extension de la compétition. Comme le note le philosophe André Tosel, je le cite : dans l’imaginaire néolibéral, « ce n’est pas l’État qui doit contrôler le marché et ses abus, ou ses excès, c’est le marché qui place l’État sous surveillance permanente et lui assigne en même temps une fonction nécessaire de contrôle quant à l’effectivité du marché ».
Sous les auspices de la Start-up Nation, l’État doit donc soutenir les entreprises du numérique mais, plus encore, il doit lui-même en devenir une. Encore mieux, l’idéal serait que chaque fonctionnaire devienne littéralement un « entrepreneur de l’État » et agisse avec créativité et efficacité. Dans le « nouveau monde » macronien, cela équivaut à agir depuis des normes d’une justice consistant non pas là a réussite de tous, mais à coup sûr, à la réussite de ceux qui sont a priori les plus doués, les « fameux premiers de cordée », c’est-à-dire ceux qui disposent des meilleurs atouts dès la naissance.
Donc voilà tiré à gros traits les trois piliers idéologiques à partir desquels sont justifiées les politiques de dématérialisation. Qu’en est-il maintenant de l’étape suivante, celle de l’innovation, c’est-à-dire de la transformation de ces idées en dispositifs concrets d’administration composés d’un complexe d’instruments numériques ?
La phase d’innovation
La phase d’innovation concerne donc la mise en instrument des politiques de réforme de l’État. Plusieurs travaux de recherche qui portent précisément sur cette phase d’innovation montrent, sans surprise, que ce sont les acteurs privés qui mènent le bal et que les propositions de solutions techniques qu’ils proposent servent d’abord leurs intérêts de rentabilité et de positionnement sur le marché et les conduisent bien souvent à minimiser si ce n’est même parfois à abandonner les réflexions de fond sur la valeur d’usage citoyenne des dispositifs. L’instrumentation numérique de l’action publique entraîne, de fait, de nouveaux schémas collaboratifs public/privé avec des opérateurs industriels et des fournisseurs de solutions techniques qui ne vont donc pas sans accrocs s’agissant du choix et du design des instruments, mais aussi de la place à réserver aux usagers dans l’étape d’innovation.
Dans l’étape de négociation entre agents de la haute fonction publique dépositaires d’un projet administratif et opérateurs privés sous-traitants, l’usager médial et l’usager final s’avèrent, de fait, peu présents et peu représentés dans le processus de conception. Les innovateurs semblent donc certes sommés de proposer des services ajustés aux besoins effectifs d’un usager générique ou, plus rarement, liés aux besoins spécifiques de certaines catégories d’usagers, mais ils apparaissent notamment peu vigilants s’agissant des difficultés que certaines franges des usagers rencontrent dans l’accès aux services qu’ils imaginent.
Les travaux de la sociologue belge Périne Brotcorne documentent particulièrement ce point. Elle montre l’absence criante des utilisateurs dans la phase d’innovation, ce qui les éloigne de la possibilité effective de délibérer tant sur les valeurs encodées dans les nouvelles infrastructures que sur les problèmes ergonomiques. La situation apparaît d’autant plus paradoxale que les différents acteurs prenant part au processus d’innovation revendiquent souvent une « approche usager », posture qui révèle en fait une vision très sommaire des publics destinataires des services qui se fondent la plupart du temps sur des intuitions et des représentations tirées des expériences personnelles des innovateurs ou de celles de leurs proches.
Conséquemment, il n’est donc pas étonnant de constater un désajustement avec les attentes et les capacités effectives des usagers et des agents : « Dans tous les cas, explique Perrine Brotcorne, l’usager enfermé dans le design du guichet [numérique] n’est ni un faible ni un non-utilisateur des technologies numériques ».
Malgré la volonté de mettre en œuvre, en certains cas, un procès d’inclusion « by design » et de tenir régulièrement des « user clubs » pour indexer l’innovation aux retours des usagers, force est de constater que les services implémentés sont généralement d’une trop grande complexité et contribuent à la « fabrique de l’incapacité » de certains publics parmi les moins habitués à la manipulation des outils numériques et qui, par la force des choses, tendent donc à devenir des non-usagers des services publics.
Si la phase d’innovation est parfois présentée comme relevant d’une logique de coproduction des services et des biens publics, dans les faits, force est de reconnaître qu’elle s’apparente plutôt à l’imposition de solutions qui conviennent d’abord aux innovateurs. Les bénéficiaires de l’action publique sont généralement, au mieux, représentés par quelques individus dont les discours et les retours de test ou d’expérience viennent, certes, compléter et ajuster les représentations – pas toujours très informées – des innovateurs, mais sans en modifier globalement la teneur.
La phase d’appropriation
Alors la phase des usages, c’est évidemment un peu l’épreuve de vérité. Une fois que l’on a pensé une politique, qu’on l’a traduite dans des dispositifs et qu’on a implémenté ces dispositifs dans les administrations qu’est-ce qui se passe ? Et là, il y a de fait beaucoup de choses à dire, puisque sans avoir la volonté d’être nécessairement négatif, force est de constater que le bilan a de quoi alarmer.
Par quoi se solde en bout de course la dématérialisation ? Pour répondre à cette question dont nous ne ferons évidemment pas le tour, je vous propose de considérer deux types d’usagers : d’une part les usagers médiaux constitués par les agents publics censés appliquer les politiques de dématérialisation et le usagers finaux, les administrés qui les uns et les autres sont globalement contraints de se soumettre aux exigences portés par les dispositifs numériques.
Les usagers médiaux : les agents publics
Commençons par les agents publics. Que peut-on dire des conséquences de la dématérialisation sur les activités des agents publics d’un point de vue général, parce qu’évidemment, il y a des spécificités selon les administrations, les services et les espaces nationaux considérés. Ce qui se passe en Suisse n’est pas exactement ce qui se passe au Danemark ou en France et ce qui se passe au sein de France Travail, n’est pas ce qui se passe à la CAF ou dans un centre social communal. Mais au-delà des singularités nationales et de chaque administration, il est néanmoins possible de tirer quelques conclusions générales qui valent dans la plupart des situations. J’en présenterai quatre :
Premier constat : la dématérialisation réforme la division sociale du travail entre les personnels et les bénéficiaires. Nombre de tâches qui relevaient des prérogatives des agents publics sont aujourd’hui déléguées aux usagers ce qui a moins pour conséquence d’alléger le travail des agents publics que d’en changer la nature et, surtout de limiter leurs marges d’action.
Deuxième constat : cette reconfiguration des tâches entrainent notamment de nouvelles tâches centrées sur l’assistance numérique qui viennent là aussi déplacer le périmètre des missions premières des agents publics qui dénoncent systématiquement dans les enquêtes un temps trop important consacré aux manipulations techniques qui finit par dévaloriser les « cœurs de métier ». Pierre Mazet et François Sorin soulignent que ces situations créent ce qu’ils appellent des « troubles de la professionnalité » fondés notamment sur une tension de plus en plus présente, par exemple chez les travailleurs sociaux, entre devoir de porter assistance et capacité à actualiser cette mission sous les auspices d’une dématérialisation qui interroge notamment certains principes déontologiques (faire à la place des ressortissants, accès à leurs données personnelles, à leurs identifiants, etc.).
Troisième constat : la dématérialisation engendre des processus de négociation quant à la répartition des tâches. Les employés des administrations chargés d’interagir directement avec le public se voient retirer certaines de leurs prérogatives qui, certes, pouvaient donner lieu aux excès bien connus de la « bureaucratie de proximité », mais qui leur permettaient de se dégager des marges de manœuvre ouvrant à des ajustements au plus près de la variété des situations individuelles rencontrées. A contrario, l’instrumentation numérique des procédures induit plutôt une délégation au dispositif numérique qui tend à faire des travailleurs des services publics des exécutants soumis à des programmes d’action porteurs de normes organisationnelles fichées et figées dans une rationalité technique peu ou pas flexible.
Si le détournement de certaines procédures est parfois envisageable, la marge interprétative des agents publics et leur « agentivité morale » se trouvent de fait assez largement rognées. Leurs pratiques discrétionnaires peuvent, par exemple, se rapporter uniquement à l’évaluation du niveau de service à adopter vis-à-vis des usagers, assurant alors moins des fonctions de conseillers-experts que de « gestionnaires de dossier » ou de « coach généraliste » devant rappeler aux administrés la nécessité qu’ils ont à s’engager dans leur « devenir citoyen numérique » et inciter les citoyens « à faire plus ». Pour reprendre l’exemple de France Travail, les conseillers jouaient, jusqu’alors, un rôle d’intermédiation entre l’offre et la demande d’emploi, or ils sont désormais censées d’abord aider les chômeurs dans la maîtrise des outils informatiques.
L’agent public tend à devenir un screen-level bureaucrat, simple exécutant manipulateur de données, même si certains agents publics arrivent à se dégager des marges de manœuvre. Jorge Muñoz (2015) montre, par exemple, qu’en France, la numérisation des services chargés de la gestion des déclarations d’accident du travail conduit les techniciens desdits services à développer un sentiment de perte de contrôle, de compétences et de sens, en rapport avec la reconfiguration de leurs activités de qualification. Toutefois, cette réalité déceptive liée à la réorganisation imposée de leur activité professionnelle est contrebalancée par une mobilisation « créatrice » leur permettant de reprendre la main sur une partie des pratiques au cœur de leur métier, à partir de nouvelles manières de faire. Cette reconquête de l’activité s’appuie, en l’espèce, sur une collaboration accrue entre personnels et la capacité qui en découle à produire de nouvelles associations entre le fonctionnement des dispositifs numériques et le fonctionnement du collectif professionnel. D’autres travaux montrent aussi que, face aux changements imposés par le haut peuvent se construire des stratégies innovantes de contournement et d’adaptation des/aux contraintes sociotechniques, ainsi que des logiques d’« autonomie responsable » fondées sur une éthique professionnelle qui s’en trouve parfois revigorée.
Quatrième constat : si la dématérialisation peut être saisie comme répondant concrètement à des besoins fonctionnels ayant trait au bon pilotage des services publics, elle se présente aussi comme au principe de nouvelles obligations pratiques standardisées, de procédures de contrôle par la mise en statistiques de l’activité des agents et d’épreuves de professionnalité qui fragilisent les identités de métier. Cette nouvelle gouvernementalité conventionnelle devient alors source durable d’inquiétude, notamment parce qu’elle permet une extension de la traçabilité et du contrôle des activités des agents publics, sans que ceux-ci aient les moyens d’en connaître l’exacte teneur et l’ampleur. La dématérialisation instaure une surveillance diffuse rendue possible de manière constante et introduit un malaise (le sentiment de pouvoir être pris en défaut) qui fragilise les pratiques et les personnels qui sont poussés à développer un travail de justification inédit et de protection dans le but de se préserver individuellement leur emploi ou leur fonction et de se protéger collectivement leur métier.
Les mécanismes d’adaptation mis en œuvre par les « travailleurs de première ligne » oscillent entre différentes modalités qui varient en fonction des situations, des interlocuteurs, de leur charge de travail et qui ne sont pas affectées du même sentiment (positif ou négatif) selon les moments : disponibilité accrue de l’attention, regain de professionnalisme, prudence dans la rédaction des textes, externalisation de certaines actions vers les usagers (auto-assistance), priorisation nouvelle des tâches, limitation des interactions, contournement des procédures, etc. Avec la dématérialisation, c’est un nouveau répertoire de l’agir professionnel qui se constitue ; répertoire que les agents publics jugent plus exigeant dans la mesure où il repose sur une remise en cause des asymétries caractéristiques des relations traditionnelles entre agents et usagers et qui expose davantage les agents au contrôle de la hiérarchie, des pairs et des ressortissants.
Les usagers finaux : les administrés
Bien donc voilà ce qui se passe du côté des agents publics et voyons maintenant ce qui se passe du côté des administrés. Là, il y a évidemment beaucoup à dire. On l’aura compris, la dématérialisation est parée de toutes les vertus, mais dans les faits, en tout à bout de chaîne, au plus près des citoyens, le constat est pour le moins déceptif tant les problèmes sont nombreux. Les nombreuses enquêtes menées dans différents pays et auprès de différentes administrations révèlent de nombreux dysfonctionnements et la dématérialisation y est systématiquement présentée, non pas comme un simple changement d’outils d’organisation et de gestion, mais bien comme une évolution de nature politique redéfinissant des rapports à l’État, à la vie sociale et aux citoyens.
Ces recherches montrent notamment qu’un des obstacles majeurs inhérent à l’instrumentation numérique des services publics et au fait d’imposer l’usage du numérique dans la relation administrative tient à ce que cela s’accompagne de la fermeture partielle ou totale des guichets physiques des administrations. La suppression progressive ou brutale des points d’accueil physique, notamment essentiels à l’accompagnement de celles et ceux dont les parcours d’accès aux droits peuvent s’avérer particulièrement laborieux, entérine, de fait, une situation inégalitaire rendant caduque le principe de continuité et de qualité des services publics.
En France, le Défenseur des droits a insisté à plusieurs reprises sur le risque de rupture d’égalité des citoyens que constitue l’amenuisement d’une accessibilité multicanale, prônant la conservation d’une variété de modalités d’accès aux services publics, seule solution lui paraissant pouvoir maintenir un accès pour toutes et tous, permettant de lutter contre l’appauvrissement des contacts physiques avec l’administration et de conserver une relation d’aide de qualité notamment susceptible de prendre en charge les cas les plus complexes.
C’est un « droit au guichet » qui est donc réclamé par différents acteurs de la société civile, que nombre de recherches mettent par ailleurs en avant et tout particulièrement celles qui s’intéressent aux politiques d’accueil des personnes migrantes pour lesquelles certaines démarches administratives s’avèrent déjà délicates en « temps normal », mais se voient rendues encore plus inconfortables sous les conditions d’utilisation des plateformes numériques dédiées, qui restent peu connues des intéressés et malcommodes à utiliser pour nombre d’entre eux. Les migrants sont certes « connectés », mais ils ne le sont que rarement sur un mode qui les prédispose à s’approprier facilement la relation administrative en ligne. Les obstacles majeurs tiennent en premier lieu aux difficultés rencontrées quant à la maîtrise de la langue française et, plus particulièrement, à celle du langage administratif. Les migrants – notamment les primo-arrivants – peuvent n’être ni locuteurs, ni lecteurs, ni scripteurs et, quand ils le sont, peuvent l’être dans des formes d’appropriation assez dégradées qui ne leur permettent pas de tenir les exigences liées à la figure d’un individu calculateur, stratège et autonome. En ce cas, mais en bien d’autres cas aussi, reconnaissons que l’on est bien loin de la figure postulée par les politiques publiques d’un usager autonome travaillant activement à son insertion dans la « société numérique », capable de se débrouiller d’une relation administrative « sans relation humaine », de faire montre d’ingéniosité et d’autoresponsabilisation.
La plupart des travaux menés sur le thème du « fardeau administratif » lié à l’instrumentation numérique des services publics souligne que les États-providences s’inspirent des nouvelles pratiques commerciales, invitant les ressortissants à s’engager dans des actions censées relever des prérogatives des agents publics, mais qui, in fine, leur reviennent. La dématérialisation de l’action publique signe en cela une double délégation : d’un côté, certaines opérations déléguées aux dispositifs techniques ; de l’autre, un déplacement complémentaire de celles-ci vers les usagers qui portent désormais la charge et la responsabilité du bon déroulement des démarches au sein desquelles ils s’inscrivent. Sauf que la numérisation des démarches administratives se révèle en fait, pour nombre d’administrés, être un écueil supplémentaire à surmonter, susceptible d’alimenter un phénomène de non-recours aux droits.
Plusieurs travaux, notamment menés en France montrent que la dématérialisation a fait de l’accès et de la maîtrise des outils numériques un nouveau critère d’éligibilité aux droits pouvant être générateur d’un non-recours. Hélèna Revil et Philippe Warin avancent par exemple que les moyens numériques mis en œuvre ne permettent notamment ni d’entendre les individus qui ne recourent pas ou résistent à faire valoir leurs droits, ni aux institutions de justifier les fins de non-recevoir qu’elles adressent. Leurs enquêtes montrent que plus les « publics cibles » ont des difficultés d’insertion sociale fondées sur des déficits cumulatifs de capital (économique, culturel, social, etc.) et plus le passage au numérique tend à constituer une charge supplémentaire pour les plus vulnérables, à renforcer les logiques d’exclusion qui les affectaient préalablement et à déplacer la responsabilité du non-accès aux droits sur les ressortissants. Les individus culturellement les moins dotés et porteurs de disposition incapacitantes (peur de mal faire, de se faire berner ou surveiller, etc.) sont aussi ceux qui cumulent les difficultés pour maîtriser les pratiques que suppose la dématérialisation de la relation administrative. Le « fardeau administratif » propre au numérique devient alors un obstacle dans l’accès aux politiques sociales pour les usagers des administrations publiques les plus en difficulté, phénomène qui participe, pour certains chercheurs, à, je cite, un « écrémage radical des pauvres ».
Des chercheurs scandinaves ont par exemple montré que les États-providences du Nord attendent des citoyens qu’ils gèrent eux-mêmes leurs dossiers dans un environnement où la prise de décision s’est fortement standardisée. Or la « simplification par le numérique » se présente finalement, en bien des cas, comme une complication effective qui impose des coûts importants de transaction aux usagers des services publics (coûts d’équipement, d’apprentissage, de mise en conformité, psychologiques, etc.), notamment s’agissant des services soumis à conditions de ressources, rendant plus laborieux encore leur accès aux droits fondamentaux. Lorsque les citoyens sont confrontés à des situations de vie réellement difficultueuses, les formes standardisées du rapport aux administrations portées par le numérique deviennent en fait une épreuve supplémentaire, car les nécessités qu’elles posent ne s’ajustent généralement guère à leurs compétences et à leurs dispositions
Pour surmonter les difficultés rencontrées, on a mis en place d’autres politiques publiques dites d’« inclusion numérique », de lutte contre l’illectronisme ou encore de « médiation numérique ». Si l’on prend l’exemple français (sur lequel on pourra revenir dans la discussion), force est de constater que les médiateurs numériques se trouvent, de fait, de plus en plus mobilisés pour des demandes d’assistance administrative. Chargés originellement de participer à la montée en compétences numériques des populations, ils se retrouvent à assurer toujours davantage la prise en charge de l’accompagnement spécifique des usagers des administrations. À l’échelle nationale, les démarches en ligne se placent par exemple en tête des aides réalisées par les CnFS.
Outre le non recours et les aspects inégalitaires de la dématérialisation, de nombreux travaux pointent également que la dématérialisation conduit à davantage de contrôle des administrés et à un durcissement de l’attribution des prestations car elle permet d’inscrire dans les dispositifs algorithmiques – notamment sous prétexte de lutte contre la fraude –, des politiques de discrimination et de suspicion largement en défaveur des usagers les plus précaires et restreignant de facto leur accès aux services sociaux. Pour la chercheuse américaine Virginia Eubanks, la numérisation n’entrave pas seulement le pouvoir discrétionnaire des agents publics, mais constitue un dispositif général par le biais duquel s’impose une gouvernementalité répressive conduisant à un surcontrôle massif des plus précaires. Patrick Williams a par exemple analysé, la manière dont la dématérialisation des services de police au Royaume-Uni et plus largement en Europe contribue au renforcement de la criminalisation des personnes racisées et à leur « sur-condamnation ». Certaines recherches évoquent, à cet égard, l’idée d’un « technocolonialisme » ou d’un « colonialisme des données » imposé par des institutions extractivistes qui exploitent les informations livrées par les administrés et fait émerger un nouveau régime d’analyses des données personnelles reposant sur des profilages, du scoring et des analyses prédictives.
De fait, la numérisation des administrations a permis une amplification de la circulation des données et la création de plateformes de mise en relation des bases de données de différents services, visant à terme l’unification au sein d’un même réseau des domaines d’intervention, voire entre institutions publiques. Si l’interopérabilité permet des gains d’efficacité, la captation des données sociales des administrés invitent à se questionner sur le modèle de service public qui pourrait à terme en découler. Le capitalisme de surveillance que décrit la chercheuse Shoshana Zuboff semble avoir pénétré la sphères étatique pour qui le secteur privé de la Tech devient bien un modèle à suivre quant à l’exploitation commerciale des données. Les États-providences scandinaves, par exemple, en viennent à se positionner comme des acteurs-clés d’une économie du big data fondée sur l’exploitation marchande de données massivement collectées dans le cadre de leurs opérations d’action publique et qui se présente comme une opportunité nouvelle de création de valeur pour les États.
*
Ce bilan critique n’invite pas à un optimisme débridé. Je crois vraiment que l’on se trouve aujourd’hui dans une situation assez critique dont je ne vois pas, à l’heure actuelle, comment elle pourrait s’améliorer rapidement si ce n’est à revenir sur un certain nombre de choix qui ont été faits : le numérique comme cheval de Troie de la privatisation des services publics, le principe du digital-by-default, la suppression des guichets, l’algorithmisation des prestations, l’accroissement de la surveillance, l’abandon de l’aide au développement au secteur de la médiation numérique. Tous ces éléments et quelques autres qui s’y rajoutent font qu’il y a quelque raison à être inquiet. Pardon pour ces mauvaises nouvelles, mais comme le rappelait Antonio Gramsci, « Il faut avoir une parfaite conscience de ses propres limites, surtout si on veut les élargir ».