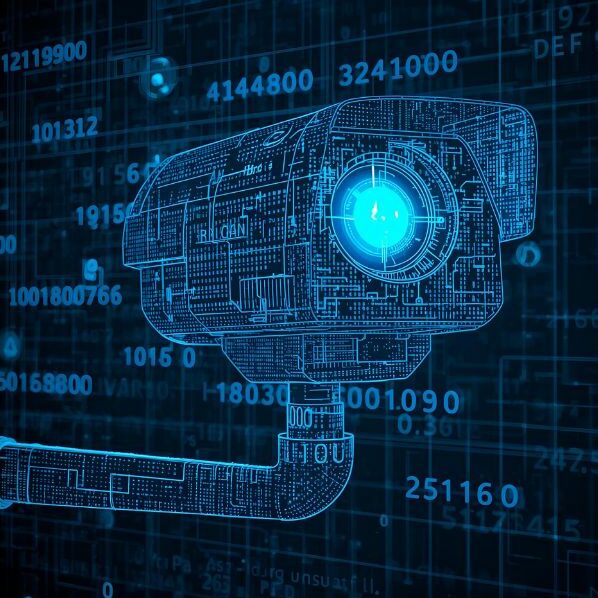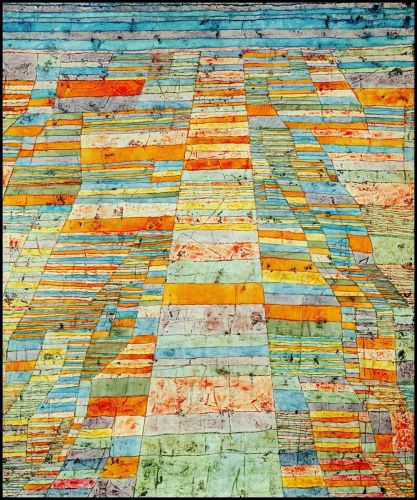Coopérative de recherche – ZOÉ
La création d’une unité de recherche coopérative dédiée aux faits de domination, de pouvoir et d’influence au sein du vivant vise à faire émerger, au sein du paysage de la recherche de l’Université Paris 8 et de ses entours, une dynamique scientifique novatrice s’inscrivant dans la continuité du legs à la fois critique et expérimental de l’Université de Vincennes. Faire vivre concrètement un tel héritage dans le domaine des sciences, ne peut se contenter d’un vague rappel aux origines glorieuses et encore moins d’utiliser cette histoire comme d’une simple marque déposée. À distance de la mise sous cloche d’un capital symbolique qui, par-là même, ne peut aller que s’étiolant, tout comme de l’entretien d’un « folklore scientifique » (Elias, 2016 : 161) ou de l’exercice ritualisé d’une critique populiste essayant de démontrer que « les petites gens résistent avec succès à une forme de pouvoir ou d’influence globalisante » (Graeber, 2018 : 115), c’est sur la base de pratiques épistémopolitiques en phase avec un présent menaçant, inscrit dans une histoire, traversé par de « nouvelles » inégalités environnementales[1], qu’il s’agit d’actualiser l’« esprit de Vincennes ». Cette forma mentis qui ne s’est jamais montrée hésitante à investir les marges pour construire de nouvelles fécondités analytiques, nous voulons l’actualiser dans une initiative qui entend donc proroger cette disposition institutionnelle à se décentrer et notamment à s’intéresser aux rapports sociaux, aux emprises et aux crises répétées du capitalisme[2] – en l’espèce, celle qui hypothèque ses conditions naturelles de reproduction du fait des dégradations écosystémiques – qui forment le substrat sur lequel s’assemblent les êtres vivants humains et non-humains.
Fondée sur un statut de Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) renouvelant de ce fait les modes de participation et de gouvernance du collectif, l’unité de recherche que nous souhaitons créer se distingue d’abord par son objet central (les agencements de dominance), son domaine d’application interspécifique et son effort global de théorisation (les assemblages du vivant – structures de rencontre et d’organisation, milieux de vie), ainsi que par les diverses logiques d’hybridation qui se trouvent aussi à son principe : interdisciplinarité, interlocalisation et internationalisation. Les quelques lignes qui suivent ont vocation à présenter un peu plus avant ces fondements.
Ζωήú Penser le vivant à l’ère de l’anthropocène
Si les sciences sont bien filles de leur temps, alors nul ne sera étonné de cette tentative qui est la nôtre d’essayer de faire vivre une science sociale du vivant à la hauteur des défis que nous impose notre entrée dans l’ère d’un régime climatique d’origine anthropique et de la crise écologique globale sur laquelle les experts du GIEC ne cessent d’alerter. Nouvel âge géologique, l’anthropocène (Latour, 2023 : 143 et seq. ; Malm, 2017) est ce moment de l’histoire qui remet radicalement en cause le« déchaînement des forces productives » (Marx), le mythe croissantiste, la gabegie énergétique, et réaffirme, avec force, l’évidence du caractère mortifère, pour les humains, de la perte de biodiversité (variété des espèces) et de la sixième extinction des espèces animales non-humaines (Broswimmer, 2010)[3]. Il pose, plus largement, la question de la finitude du vivant, de ses limites naturelles ainsi que des conditions concrètes de sa subsistance tel qu’on le connaît aujourd’hui, et ce, dans l’indissociabilité de ses différents taxons.
À cette aune, penser les interdépendances fondamentales et notamment les propriétés majeures de dominance (de domination/domestication de la nature et de ses différents êtres[4]) dont il est avancé par nombre de recherches qu’elles se trouvent au principe de rapports sociaux participant du dépérissement du vivant, nous semble être une intention d’utilité épistémopolitique à tout le moins aussi louable que n’importe quel autre programme d’investigation. Cette focale nécessite néanmoins de mettre en question – si ce n’est en cause – la division généralement admise du travail académique, de son découpage en baronnies disciplinaires et des effets de champ qui leur sont afférents. Il s’agit d’essayer, en élargissant les foyers d’analyse aux non-humains et en expérimentant d’autres manières de mixer les sciences de l’homme et du vivant, de voir un peu plus clair quant aux agencements de dominance et aux inégalités s’y référant[5] qui traversent l’anthropocène et qui, au stade actuel de développement des différents taxons du vivant – notamment humain – produisent des déséquilibres tels, que la disparition progressive dudit vivant est devenue une hypothèse tout à fait crédible.
Prendre au sérieux que « la nature est un champ de bataille » (Keucheyan, 2018) et envisager qu’il s’agit là de la cause première de son dépérissement ; considérer son caractère capitalo-industriel ancré dans un système inégalitaire qui « désensibilise » (un naturalisme sans égards, sans éthique, sans réciprocité, sans symétrie selon les auteurs) et réifie le rapport au vivant (productivisme, extractivisme, marchandisation, biopiraterie, etc., qui contribuent à une perte de consistance ontologique – Morizot, 2020) ; mettre en lumière et analyser les phénomènes composant les bouleversements environnementaux : voilà qui serait susceptible de déboucher sur des connaissance utiles qui, sans garantie aucune de réussite, pourraient alimenter – autrement que dans le seul ordre de la pensée – des pratiques salvatrices de changement social (des « moyens d’orientation plus adéquats, réalistes et étendus » – Elias, 2016 : 160) et d’action publique[6] à la recherche d’une « vie large[7] […] qui met chacun à l’abri de l’insécurité d’existence, qui offre à toutes et tous la possibilité réelle de développer leurs facultés et leur sensibilité » (Magnette, 2024 : 8) et qui nous aide à comprendre « comment mieux vivre dans un monde que nous partageons avec d’autres sortes de vies » (Kohn, 2017 : 59 ; Haraway, 2008).
Ζωήú Une approche critique
L’Unité de recherche coopérative Zoé revendique la critique comme un des fondements de ses travaux, dans la mesure où elle s’attache à analyser des faits de domination, de pouvoir et d’influence[8] intra- et inter- espèces au sein des assemblages du vivant qu’ils constituent[9] (biocénoses, écosystèmes, biosphère, etc.). Elle prête attention aux différents types d’agencements de dominance, c’est-à-dire à la manière dont les rapports de domination, de pouvoir et d’influence sont assemblés et font système à la fois dans et entre chaque composante du vivant[10], et ce, depuis des problématiques spécifiques (cf. infra) qui, précisément, permettent de rapprocher les analyses portant sur des objets qui, a priori, pourraient être considérés comme étrangers les uns envers les autres.
Notre perspective est critique parce qu’elle fait du vivant un domaine classiquement politique (e.g. un sujet de droit – Vanuxem, 2020), qui rentre en ligne de compte des gouvernementalités. Mais elle fait également de la nature un sujet autrement politique en ce que les diverses entités – notamment non-humaines – qui composent celle-ci et définissent des « vivre-ensemble » et des collectifs plus intégratifs, sont, par-là même, « bailleuses » d’attendus (cosmo)politiques différents (notamment la réorganisation post-naturaliste des puissances d’agir et des modes d’organisation hétérogènes du vivant en géoclasses[11] – Descola, in Descola, Pignocchi, 2022 : 85) de ceux qui régissent habituellement, du côté des animaux humains collectivement organisés, le fait d’avoir à trancher dans les possibles de la vie collective (Hage, 2012). La critique sur laquelle nous faisons fond s’intéresse à diverses formes de vie (des manières d’être vivant, des modes d’existence), à leur manière de constituer des « communautés », et notamment à des types de rapports (dominance-dépendance) dont Bernard Lahire (2023 : 44) estime qu’ils constituent – surtout chez l’être humain –, par-delà leurs singulières différences, un schème de tendance universelle qui s’ancre primordialement dans le phénomène d’altricialité secondaire, c’est-à-dire la dépendance native des juvéniles vis-à-vis des adultes – laquelle aurait à tendance à devenir permanente[12], structurant, selon Lahire, « tous les rapports de domination » (2023 : 683). Outre ce fait matriciel, c’est plus largement à l’existence d’ordres biotiques, sociaux et culturels (Halbwachs, 1934) qui définissent des positions, des identités, des fonctions asymétriques et donc à l’exercice de manières de dominance entremêlées qui traversent, classent, structurent les êtres et forment système auxquels nous portons attention[13].
L’effort critique est un effort de totalisation, non pas dans la perspective d’un épuisement descriptif du réel ou de celle de l’élaboration d’une « suprême théorie » – efforts de complétude toujours vains –, mais dans une visée consistant à rendre possible des « synthèses créatrices[14] » (des « connexions nouvelles entre des totalités bien articulées » – Feyerabend, 1975 : 34) proposant des modèles analytiques multidimensionnels, décalés, prenant en compte, à un niveau macro, la dialectique des logiques capitalistes et des dynamiques environnementales, à un niveau méso, des appariements collectifs bio-socio-culturels et à un niveau micro, des configurations instanciés dans les corps physiques des individus[15] (dont les intellects) et les matérialités non biotiques (structures non vivantes, sociales et culturelles). Il s’agit alors de s’efforcer d’explorer et de rendre compte de réalités concrètes au sein desquelles s’enracinent les expériences du vivant en se donnant les capacités d’en concevoir une critique radicale, c’est-à-dire une critique allant à la racine des agencements de dominance, des formats d’épreuve qu’ils engendrent (Boltanski, 2009) et des structures desquelles ils participent, lesquelles ne sont pas directement observables. Malgré l’apparente pluralité des faits bio-socio-culturels, ce que cherche à produire cette « critique-Phusis » c’est de reconstituer l’unité des diverses dimensions du vivant en ce que celles-ci, composées dans des assemblages, sont à la fois causes et conséquences d’agencements de dominance qui entretiennent des relations entre eux. La totalisation relève donc, ici, d’un travail de synthèse théorique[16] qui exige de considérer que la réalité complète de l’objet ne peut être atteinte sans cette double exigence de mise en relation des ordres du vivant et des ordres de domination faisant système. Elle tient aussi au socle ontologique renouvelé que commande l’interspécifique, lequel pose la nécessité de prendre en considération le large répertoire des relations que les êtres vivants entretiennent entre eux (cf. infra).
Ζωήú Une interdisciplinarité « grand angle »
L’Unité de recherche coopérative Zoé postule que les dimensions biotique, sociale et culturelle[17] sont présentes – à des degrés fort divers s’agissant de ce dernier aspect : soumis pour les uns à des transmissions essentiellement génétiques et pour les autres à des héritages aussi/surtout culturels – à la fois chez les végétaux, les animaux non-humains et les animaux humains. Les ordres/altérités « phyto », « zoo » et « anthropo » n’ont par ailleurs jamais cessé d’être en relation, d’être assemblés et, à l’ère de l’anthropocène, n’ont jamais été autant dépendants de la culture humaine et de ses impérialismes scientifiques, techniques et marchands.
Si la division sociale du travail scientifique a spécifié disciplinairement – avec plus ou moins de bonheur[18] – les opérations intellectuelles et, par-là même, a voulu les révéler dans leurs identités singulières – essayant de les faire relever en chaque cas d’un nomos particulier –, il appert que ces opérations de distinction établissent surtout des « droits de propriété » et produisent des effets institutionnels de provincialisation et de hiérarchisation des champs et des recherches qui s’y déroulent. Or rien n’empêche – si ce n’est le désagréable sentiment de se faire mal voir et mal entendre – d’envisager que la nature différente des choses que consacrent par exemple certaines « studies » et, plus largement, la tendance à l’hyperspécialisation, mais aussi les spécificités épistémiques de façade – notamment au sein des SHS qui pratiquent la balkanisation des régions épistémologiques et des champs de connaissance – sont des inclinaisons desquelles il est possible de se défaire pour recomposer autrement nos intérêts de connaissance, repenser les foyers sous lesquels nous pouvons nous imaginer ranger la diversité de ces connaissances et réinventer nos investigations.
Pour ce faire, nous entendons nourrir nos réflexions des apports empiriques et théoriques des sciences humaines et sociales (anthropologie, sociologie, histoire, philosophie, droit, etc.), mais aussi des connaissances produites par un répertoire large de sciences dites « naturelles », prenant comme objet le vivant – plutôt, mais pas seulement, sous ses aspects biotiques – comme l’éthologie, la biologie évolutionniste, l’écologie comportementale, la paléontologie, la neurobiologie, les sciences cognitives, etc. Les modèles d’analyse que nous mobilisons entendent donc ne pas se laisser claustrer dans des régions épistémologiques dont les protectionnismes disciplinaires qui généralement les accompagnent servent moins à garantir des heuristiques qu’à établir des pré-carrés et des splendides isolements scientifiques qui nous semblent être parfois davantage les héritiers de Sébastien Le Prestre de Vauban que d’Hérodote, Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin, Émile Durkheim, Marcel Mauss ou encore Karl Marx.
Cette interdisciplinarité « grand angle » (une science mutualiste à courte focale et large vue) entend donc revendiquer un droit de passage (un droit au désenclavement) lui permettant d’arpenter une grande variété de territoires disciplinaires et de construire des problématiques tachant de poser des énigmes susceptibles de prendre en compte l’intrication des structures biologiques, institutionnelles et artefactuelles, ainsi que l’enchâssement des attributs biotiques, sociaux et culturels des écosystèmes[19](environnements), des individus (humains et non-humains) et de leurs assemblages qui constituent les objets hétérogènes de nos investigations. C’est, ainsi, se donner les moyens de recomposer des cadres d’analyse plus généraux et, de ce fait, permettre une science plus consiliente[20] (Lahire, 2023 : 24) et plus armée pour répondre au défi de l’anthropocène.
Cette forme d’in(ter)disciplinarité, qui repose sur un redécoupage des objets disciplinairement dédiés, suppose donc d’assumer une certaine défiance vis-à-vis des droits de douane institutionnels et épistémologiques qui entravent la possibilité d’une production scientifique plus inclusive, au sein même des SHS et, plus encore, entre les sciences du vivant et celles dites « culturelles ». Cette manière de faire science repose sur une révision des binarismes antagonisant notamment le « naturel » et le « culturel » (naturalisme – Descola, 2005), le matériel et l’idéel (Godelier, 1984), le diacritique et le synthétique (Testart, 2021 ; Lahire, 2023), etc., et invite à envisager la construction de modèles d’intelligibilité reposant sur des « continuités réversives » (Tort, 2002) et des boucles récursives plutôt que sur des grands partages.
Ζωήú « Tournant ontologique » et multi-comparatisme
Le socle épistémologique sur lequel nous nous appuyons procède d’une ambition qui n’est, aujourd’hui, plus nouvelle (différents courants de l’anthropologie, notamment, s’y consacrent depuis plusieurs décennies – Kirksey, Helmreich, 2010 ; Latour, 2006 ; Haudricourt, 1962) ; consistant à porter attention à l’ensemble des entités relevant du vivant, ainsi qu’à celles (matérielles, techniques, symboliques qui les accompagnent) qui s’y trouvent reliées. En cela, nous participons de ce qui a été parfois décrit comme un « tournant ontologique », faisant sien le postulat « que les sources de la pluralité des êtres et des régimes d’existence se situent à un niveau plus profond que le niveau socioculturel traditionnellement étudié par l’anthropologie, […] [niveau] dans lequel humains et non-humains deviennent conscients les uns des autres et développent des formes de relation antérieures aux processus habituels de catégorisation et de communion insérés dans des cadres historiquement et linguistiquement contingents » (Descola, in Kohn, 2017 : 14). Bien que cette nécessité prenant en considération des qualités d’être variées, ainsi que leurs matérialités, alimente nombre de travaux en SHS, rares sont néanmoins les recherches qui poussent la symétrisation (Latour, 1991) entre entités du vivant jusqu’à considérer que ces dernières disposent toutes d’un organisme (d’un corps), de dispositions à proprement parler sociales et donc d’un dispositif d’appréhension du monde extérieur et de traitement des informations tirées de leur environnement (cognition), structurellement couplés (Maturana, Varela, 1994), leur permettant de « penser » et de connaître le monde à leur manière. L’« anthropologie au-delà de l’humain » d’Eduardo Kohn (2017), notamment influencée par Terrence Deacon (2012) est un exemple tout particulièrement intéressant de ces conceptions homologiques de la corporéité et, en l’occurrence, de la capacité « interprétative » (non représentationnelle) de tous les êtres vivants (sémiose – Francisco Varela parlerait d’approche énactive de la cognition[21] – 2004), car elle élargit le spectre des bases communes du biotique, les désanthropologise et pose l’existence de relations entre formes de vie singulières – notamment au regard de la dialectique dominance/autonomie – qui restent largement à explorer dans la mesure où elles se fondent sur des propriétés (émergentes) du monde (ontologies – manières de faire monde) supposant des nouvelles « écologies des sois » et des nouvelles configurations de « nous » qui, jusqu’alors, avaient échappé aux analytiques traditionnelles.
Aussi, nous nous appuyons sur un multi-comparatisme qui entend examiner les rapports de ressemblances (rapprocher, symétriser) et de différences (distinguer) significatifs entre les divers règnes biotiques (végétaux, animaux non-humains, animaux humains – une «phyto-zoo-anthropo-logie qui ne croit plus en l’incommensurabilité des différentes catégories du vivant), la manière dont ils sont pris et combinés dans des assemblages qui régissent leur existence commune et dans des agencements de dominance qui ordonnent leurs interactions, ainsi que leurs milieux sociaux et culturels associés (éco-logie[22]). Il s’agit, non pas de faire d’une attention générale au vivant une heuristique principielle valant en soi, mais : d’une part, de considérer que la réalité n’est faite que de composés et d’assemblages biotiques, sociaux et culturels (symboliques, artefactuels, normatifs) à des degrés divers ; d’autre part, d’envisager, en chaque cas étudié, l’intérêt qu’il peut y avoir à considérer ces encastrements et leur co-existence – dans un effort de délestage anthropocentrique – ; enfin, de mettre en parallèle (rapprocher/éloigner), au besoin, le jeu des relations coopératives et rivales entre sociétés (passées et présentes) et entre espèces (phyto, zoo, anthropo), sous l’angle des rapports de domination, de pouvoir et d’influence.
L’interdisciplinarité évoquée au point précédent vient s’opérationnaliser, en quelque sorte, via ce multi-comparatisme. Prendre en considération les différents angles problématiques portés par ces disciplines, c’est se donner les moyens de comparer les différents taxons du vivant en tant qu’ils sont questionnés par des théories dont on peut vouloir tester l’heuristique sur d’autres objets que ceux dont elles se sont saisies ; de postuler des similitudes, éventuellement des homologies inter-espèces et ou inter-sociétés ; de décaler le regard en rapprochant des mondes qui sont considérés comme étant trop diversement composés (Descola, 2014) pour pouvoir être saisis de concert ; de produire des questionnements intégrés et éventuellement des développements théoriques novateurs. La logique comparatiste invite plus généralement à examiner, ensemble, des faits et des situations dans des cadres à la fois synchroniques et diachroniques.
[1] « Parler de la nature, ce n’est pas signer un traité de paix, c’est reconnaître l’existence d’une multitude de conflits sur tous les sujets possibles de l’existence quotidienne, à toutes les échelles et sur tous les continents. Loin d’unifier, la nature divise » (Latour, Schultz, 2022 : 11).
[2] Notons toutefois que ce n’est pas le seul apanage du capitalisme que de faire s’effondrer des environnements écologiques (Diamond, 2009).
[3] Maux auxquels on peut rajouter « l’acidification des océans, l’appauvrissement de la couche d’ozone, la pollution atmosphérique, la déforestation, les prélèvements d’eau douce, la concentration d’azote et de phosphore dans les terres agricoles, les émissions de nouveaux polluants chimiques » (Magnette, 2024 : 18-19), les mégafeux, etc.
[4] « Même si l’‘‘ordre de la nature’’ déploie régulièrement sa puissance sauvage lors de tremblements de terre ou d’ouragans, les membres des sociétés dans lesquelles la masse des événements physiques et biologiques est saisie en tant que ‘‘nature’’ ne perçoivent celle-ci, grosso modo, qu’en tant qu’elle est domestiquée, domptée et transformée par le contrôle humain » (Elias, 2016 : 283). Le réchauffement et les événements climatiques de ces dernières années changent évidemment quelque peu la donne.
[5] « En somme, l’intersection entre la classe, la race et le genre doit être complétée par une quatrième dimension, qui vient la compliquer en même temps qu’elle est elle-même compliquée par les trois autres : la nature. L’ordre et la prépondérance causale de l’une – ou de plusieurs – de ces logiques sont à chaque fois spécifiques. Parfois, les inégalités écologiques se mêlent à d’autres, au point qu’elles se distinguent difficilement d’elles. Dans d’autres cas, elles expliquent d’autres inégalités, comme lorsque ce qui apparaît de prime abord comme des inégalités ‘‘ethniques’’ est en réalité sous-tendu par des inégalités environnementales. Dans d’autres encore, elles aggravent des logiques inégalitaires qui trouve nt leur origine ailleurs » (Keucheyan, 2018 : 47).
[6] C’est là, pour l’anthropologue David Graeber – et nous y souscrivons –, un des rôles des chercheurs critiques que d’« observer ceux qui créent des alternatives viables, essayer de comprendre qu’elles peuvent être les implications plus larges de ce qu’ils font déjà et offrir ensuite ces idées, non pas comme des prescriptions, mais comme des contributions ou des possibilités, comme des dons » (2018 : 18).
[7] Le terme est emprunté à Jean Jaurès.
[8] Le terme « dominance » est ici utilisé pour couvrir les phénomènes de domination (rapports de force traversant tous les groupes d’une même société), de pouvoir (dominations spécifiques à une localité) et d’influence (dominations avec des niveaux de prescription faibles visant à manœuvrer les autres).
[9] « […] les conditions de vie d’un organisme dépendent de ses interactions avec d’autres organismes. Or ces ‘‘autres’’, qui constituent mon environnement, sont eux-mêmes capables d’évoluer. Les relations causales sont alors à double sens. Mon évolution dépend des autres, qui évoluent aussi en fonction de moi » (David, Samadi, 2021 : 257). Outre la composante biologique, les composantes sociales et culturelles jouent évidemment aussi un rôle d’autant plus central que celles-ci permettent des changements/ajustements beaucoup plus rapides quant à leur inscription dans structures externes et un peu moins diligentes s’agissant des inscriptions internes (incorporation – l’organisme est en cela une « matière » plus difficile à réorganiser que les choses).
[10] La théorie de l’évolution darwinienne se fonde sur le principe d’une lutte intra- et inter- spécifique (prédation, compétition, parasitisme, etc.) introduisant une sélection naturelle (survie de subsistance) et sexuelle (survie de reproduction). Les néo-darwinismes (théories synthétiques et synergiques) entendent élargir les logiques de tri sélectif à des étage d’intégration des systèmes vivants à la fois en-deçà (dérive génétique) et au-delà (aspects sociaux et culturels) des éléments organiques mis en avant par Charles Darwin. On parle à cet égard de sélection « multipolaire ».
[11] « […] un vaste collectif réticulaire dont les membres sont touchés à divers titres par un ensemble systémique de pratiques d’exploitation de la main-d’œuvre et de dévastation des milieux transformés en ressources profitables » (Descola, in Descola, Pignocchi, 2022 : 85).
[12] Patrick Tort (2002) développe une théorisation tangentielle, inspirée de Charles Darwin. Avec le concept d’effet réversif de l’évolution, il insiste, pour sa part, sur le fait que les logiques évolutionnistes conduisent les sociétés civilisées (humaines) à s’émanciper des lois de l’évolution (organique) par adoption d’instincts sociaux et de modes de vie altruistes qui les invitent à prendre soin des plus faibles et non à les éliminer en accord avec le fonctionnement sélectif. La protection des plus fragiles (par la médecine, le droit, l’éducation, etc.) n’empêche toutefois pas le fait que ceux-ci puissent être, par ailleurs, l’objet de rapports de domination. Sans doute est-ce même là une constante. Les inégalités ne sont plus sanctionnées par une élimination, mais par des formes variées de dominance qui en tirent profit. In concreto, les relations de nature conflictuelle se mêlent à celles de type coopératif (mutualisme, assistance, symbioses, etc.), que cela soit sous des aspects organiques, sociaux ou culturels.
[13] Bruno Latour et Nikolaj Schultz notent que sous le régime climatique qui est aujourd’hui le nôtre, « S’émanciper change de signification quand il s’agit de s’habituer à dépendre enfin de ce qui nous fait vivre ! » (2022 : 44). C’est là une caractéristique proche de celle d’un « système ouvert », lequel se définit comme « système qui peut nourrir son autonomie, mais à travers la dépendance à l’égard du milieu extérieur. Ça veut dire que, contrairement à l’opposition simplifiante entre une autonomie sans dépendance et un déterminisme de dépendance sans autonomie, nous voyons que la notion d’autonomie ne peut être conçue qu’en relation avec l’idée de dépendance, et ce paradoxe fondamental est invisible à toutes les visions dissociatrices pour qui il y a une antinomie absolue entre dépendance et indépendance » (Morin, 1990 : 260).
[14] Synthèses créatrices qui « récapitulent, coordonnent, clarifient, reformulent et orientent la recherche afin de féconder de nouveaux travaux théorico-empiriques riches du patrimoine accumulé et conscients de ce qu’ils peuvent apporter de neuf dans un paysage clairement dessiné » (Lahire, 2023 : 909).
[15] D’un point de vue organique, un individu peut être considéré comme une société de cellules et de gènes (David, Samadi, 2021 : 126 et seq.).
[16] « […] la totalisation n’est jamais donnée puisqu’elle résulte de l’opération au moyen de laquelle des collectifs, des traits culturels, des normes ou des positions sociales sont constitués comme des variantes d’une totalité analytiquement construite. […] L’objet de l’anthropologie ce n’est pas ces agrégats de cultures dont on cherche à tirer des leçons généralisables, ce sont les modèles que l’on construit pour rendre compte d’une totalité constituée de l’ensemble des variantes observables d’un même type de phénomène et afin d’élucider les principes de leurs transformations » (Descola, 2014 : 69 et 241).
[17] La part biotique est liée aux caractères génétiques (moléculaires), biologiques (anatomique, physiologique, cognitif) et adaptatifs (« valeur sélective », fitness) des êtres vivants ; la part sociale tient, elle, à l’organisation collective des rapports, des relations et des formes de vie des individus ; la part culturelle relève fondamentalement à l’accumulation et à la transmission de connaissances acquises singulières dans un cadre d’apprentissage social (pour les animaux non-humains, essentiellement via un copiage par observation, parfois interspécifique et utilisation de l’information publique – Laland, 2022 : 97).
[18] « Selon une conception répandue, l’existence d’une multitude de départements académiques spécialisés témoignerait de la division du travail nécessaire à l’exploration du monde, dans la mesure où l’objet visé par la recherche scientifique, à savoir l’univers et ses nombreux niveaux de différenciation et d’intégration, serait en lui-même trop diversifié et trop complexe pour qu’un seul groupe de scientifiques puisse l’investiguer dans sa totalité. Dans une certaine mesure, ce n’est sûrement pas faux. Cela dit, les rapports entre les différents domaines de spécialisation académique ne revêtent pas exactement les caractéristiques qu’on serait en droit d’attendre si leur seul et unique principe de détermination résidait bien dans l’existence fondamentale d’une division du travail. Si tel était le cas, les efforts en direction d’une coopération interdisciplinaire seraient plus facilement couronnés de succès : les travaux spécifiques mis en œuvre dans chaque branche du savoir seraient comme autant de pièces d’un puzzle qu’on rassemble naturellement les unes aux autres » (Elias, 2016 : 159-160)
[19] Le vivant et ses agencements supposent des niveaux d’intégration variés : gênes, cellules, organes, organismes, individus, groupes, espèces, sociétés, cultures. Le passage d’un niveau à un autre admet l’émergence de propriétés nouvelles qui peuvent par ailleurs faire retour sur les niveaux « inférieurs » (Odum, 1975, in Debourdeau, 2013 : 108).
[20] Pour Bernard Lahire (2023 : 35 et seq.), les quatre points de connexion entre biologie et sciences sociales sont en lien avec le fait que : 1) une partie de la biologie est une sociologie qui s’ignore dans la mesure où elle étudie des sociétés animales ; 2) la culture prend sens dans une longue histoire évolutive et a donc une origine biologique ; 3) le culturel contribue à transformer le biologique ; 4) le biologique contribue à structurer le social.
[21] « Dans la démarche énactive, la réalité n’est pas un donné : elle dépend du sujet percevant, non pas parce qu’il la ‘‘construit’’ à son gré, mais parce que ce qui compte à titre de monde pertinent est inséparable de ce qui forme la structure du sujet percevant » (Varela, 2004 : 30-31). L’existence de quelque chose est toujours relative à un cadre de connaissance qui permet de le repérer : « Un être situé, avec son corps particulier, ses désirs et sa perspective, ne pose pas seulement sur le monde un regard particulier, il compose autour de lui un monde qui lui est propre. […] les qualités sensibles constituent dans un même mouvement les choses elles-mêmes et le sujet qui les perçoit » (respectivement Pignocchi et Descola, in Descola, Pignocchi, 2022 : 156 et 157).
[22] « Nous entendons pas ‘‘écologie’’ la science des relations des organismes avec le monde environnant, auquel nous pouvons rattacher toutes les ‘‘conditions d’existence’’ au sens large. Ces dernières sont de nature organique ou inorganique et jouent toutes […] un rôle prépondérant dans la conformation des organismes, car elles les contraignent à s’adapter à elles » (Haeckel, 1866, in Debourdeau, 2013 : 53).