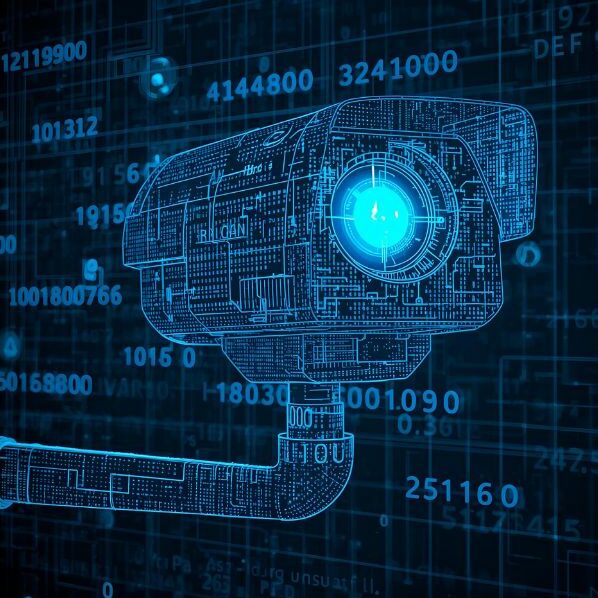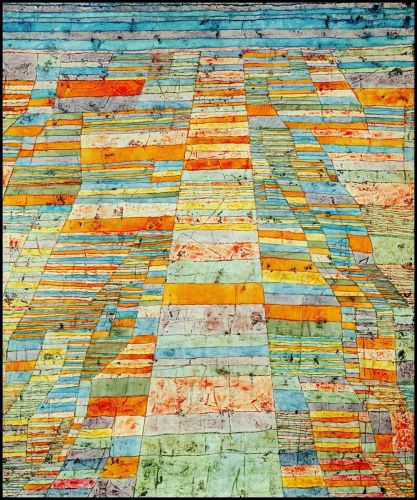Article – Savoirs nomologiques vs. connaissances critiques. En écho au « Manifeste pour la science sociale » de Bernard Lahire – Savoir/Agir
Le 2 septembre 2021, Bernard Lahire publie au sein de la revue en ligne Analyse Opinion Critique (AOC) un « Manifeste pour la science sociale » auquel fait suite une série de courts articles de Jean-Louis Fabiani (« Une science sociale ? En réponse amicale à Bernard Lahire » – 9 septembre 2021), de Jean-Pierre Olivier de Sardan (« Du régime scientifique des sciences sociales » – 24 septembre 2021) et de Charles Macdonald (« Les sciences sociales sont-elles scientifiques ? » – 9 décembre 2021), articles qui indiquent leurs (dés)accords sur l’utilité de faire des sciences sociales une science nomologique, comme l’avance Lahire. Après avoir présenté et commenté la prise de position de ce dernier, nous prendrons prétexte de ces échanges pour rappeler que l’effort de totalisation peut faire intégralement partie du logiciel épistémopolitique des sciences sociales critiques, mais qu’il ne recouvre pas, dans ce cadre, les mêmes attendus que ceux du rationalisme de l’unité promu par Lahire.
Un Manifeste pour la science sociale
Le « Manifeste pour la science sociale » de Lahire part d’un quadruple constat : 1) les sciences sociales sont « l’objet de querelles stériles, mi-scientifiques mi-politiques » qui troublent la recherche et la détournentvolens nolensde ses missions premières ; 2) elles sont l’objet d’une hyperspécialisation qui entravent les dialogues entre pairs et le rapprochement de points de vue souvent jugés irréconciliables ; 3) elles sont soumises à une division sociale du travail académique – corporatismes disciplinaire et pratique – qui standardise et disperse les connaissances (Fabiani parle à cet égard de « travaux répétitifs sans imagination »), empêchant leur articulation et l’émergence de nouvelles heuristiques ; 4) la production scientifique s’inscrit dans un régime de plus en plus concurrentiel, hiérarchisé et routinisé conduisant à un inflationnisme/relativisme théorique, ainsi qu’à une surabondance d’enquêtes empiriques. « Perspectivisme épistémologique » et « fétichisme de l’enquête de terrain » contribueraient, ensemble, à une perte du sens des totalités sociales : « Comment pouvoir dessiner une vue d’ensemble du monde social lorsque tout pousse chaque catégorie de chercheurs à garder le nez collé sur le fonctionnement de petites parcelles de ce monde ? Comment conserver une conception complexe des individus en société lorsque les découpages disciplinaires d’abord, les spécialisations internes ensuite, contraignent les chercheurs à travailler sur des dimensions à chaque fois spécifiques des pratiques individuelles ? Comment maintenir un haut niveau de créativité scientifique lorsqu’une conception étroite du professionnalisme conduit insensiblement vers une spécialisation poussée et une normalisation des recherches et des chercheurs ?[1] ». Lahire estime que la solution à ses différents maux tient à la nécessité de « dégager des lois, des invariants, des principes, des fondamentaux » afin de redonner quelque unité à une science en voie de balkanisation. Aussi s’agit-il d’élaborer « un programme de travail collectif et interdisciplinaire » et d’établir « un cadre intégrateur et unificateur, au-delà des disciplines » sur le modèle des sciences du vivant. Telles qu’elles se sont institutionnalisées et sont aujourd’hui pratiquées, les sciences sociales, estime Lahire, peinent réellement à être des « sciences comme les autres[2] » et se montrent encore trop peu « capables de produire de la cumulativité scientifique et d’énoncer des lois générales du fonctionnement des sociétés ». Si Lahire rappelle la nécessité de l’historicisation et de la comparaison, il insiste surtout sur l’obligation d’avoir à « poser des questions de sociologie générale traversant toutes les sociétés humaines », qui doivent nourrir une unique science de l’homme.
C’est, selon lui, par un effort « d’appropriation critique et de synthèse créatrice des recherches issues de nombreuses disciplines, à l’intérieur comme à l’extérieur du domaine des sciences sociales » que peut venir le salut. La connaissance propre à cette science sociale du vivant que Lahire appelle de ses vœux cherche à éclairer ce qui « constitue le propre de l’espèce humaine, sur le plan social, mental et comportemental ». Elle renoue en cela avec les premiers temps de l’émergence d’un régime conceptuel propres aux sciences humaines et sociales, imposant notamment « de distingueret d’articuler trois dimensions structurantes de l’existence humaine – les dimensions ‘‘biologique’’, ‘‘psychologique’’ et ‘‘sociologique’’[3] ». Dépendante « d’un travail collectif de grande ampleur » qui emprunterait donc autant aux sciences sociales qu’aux sciences du vivant (cognitives, biologiques, éthologiques, etc. – dans sa réponse, Macdonald estime que les sciences sociales ne sont qu’« un canton de la biologie »), elle se doit de faire fond sur un programme scientifique général qui, tout en se maintenant à distance de la philosophie sociale spéculative et du théoricisme sans données, doit néanmoins inscrire ses activités sous les auspices de « synthèses créatrices » qui n’hésiteront pas à prendre appui sur des travaux empiriques antérieurs (n’est-ce pas là une autre forme de division sociale du travail académique à la manière de l’emboîtement ethnographie-ethnologie-anthropologie ?). Cette exigence de compilation des enquêtes existantes est censée faciliter la montée en généralité (« construction de cadres généraux, synthétiques, intégrateurs et unificateurs ») et empêcher que chaque discipline – voire chaque chercheur – réinvente la poudre. L’opération doit éviter que l’imagination sociologique visant la mise au jour de structures, de propriétés et de faits sociaux « réels et persistants » se confonde avec le chic nominaliste qui fait de l’invention catégorielle – très courue par les idéalismes transcendantaux et les herméneutismes postmodernes de certaines Studies– le nec plus ultra de la créativité scientifique. Par cet effort, la science sociale se donnerait alors les moyens de la cumulativité scientifique et de la mise en lumière de lois sociales générales en nombre limité. Lahire propose ainsi de revenir aux attendus de la « révolution sociologique » qui édictait que « c’était à la sociologie […] de prendre la mesure de cette ‘‘totalité’’ et de fournir, ce faisant, un nouveau modèle de base de l’humanité[4] ».
Des objectivités plurielles
C’est là un « retour aux sources » du projet d’intégration comparative de la sociologie, mais aussi une conversion épistémologique d’importance que propose Lahire. Il défend, là, une vision nomothétique des sciences sociales postulant, d’une part, qu’il existe des relations historico-sociales constantes entre certains phénomènes (mais il faut alors préciser lesquels) et, d’autre part, que « la réalité elle-même impose un certain nombre de lignes de force ». Or si les théories s’efforcent de rendre compte de ces lignes de force, de leur matérialité et de leur ancrage dans les choses, les corps et les esprits, c’est également à partir du prisme des théories que la réalité est questionnée. Connaissances et outils de connaissance, elles sont à la fois le produit rationnel du réel (« un concret-pensé », comme dit Marx) et ce par quoi il faut passer pour produire des résultats scientifiques. De ce fait, la variété des cadres conceptuels et des régimes d’objectivité attenants – les uns et les autres étant eux aussi les produits de logiques sociales-historiques – constitue la force heuristique des sciences sociales. Si Alain Testart[5]– dont se réclame à plusieurs reprises Lahire – se plaisait à se faire nomothète, il rappelait également que ce n’est pas la nature variée des faits étudiés qui suscite des objectivités différentes, mais celle des théories (en tant que systèmes articulés de concepts) à partir desquelles ces faits sont appréhendés et le monde mis en perspective. Cette diversité peut être perçue comme une faiblesse, mais c’est aussi une force quand elle n’est pas érigée en dogme et en une valorisation excessive des réalités et des théories minoritaires. C’est cette vigueur fondée sur un répertoire théorique étendu qui permet d’éclairer – complémentairement et parfois contradictoirement – la variété des aspects des phénomènes. À vouloir absolument trouver des dénominateurs communs, le risque encouru – inverse de celui, bien réel, de la dispersion – est celui de la généralisation vide[6]. Les propos deMacdonald avançant que le capitalisme industriel n’est « qu’une modalité particulière de la forme hiérarchique qui s’est imposée à la quasi-totalité de la population humaine à partir du néolithique » et qu’« il n’a rien inventé de radicalement nouveau » nous semblent par exemple relever de ce travers de simplification excessive.
Par ailleurs, si la réalité à enquêter réduit toujours le choix des théories mobilisables susceptibles d’en rendre compte, le cadrage qu’elle opère ne saurait dicter une forme de one best wayscientifique. À moins de convoler à un mariage avec une causalité positiviste naïve, ce qui n’est évidemment pas le cas de Bernard Lahire, le vecteur épistémologique va bien du rationnel au réel. Pour cette raison, Fabiani estime que la sociologie ne peut « produire quelque chose comme un paradigme unifié, au sens que donnait Thomas Kuhn à ce terme » (i.e.la régulation du fonctionnement d’une science sociale « normale »). Mais il considère également que cette difficulté n’est peut-être pas regrettable, même si elle conduit à la « fragmentation des savoirs sur le social ». Cette difficulté tient, selon lui, au moins dans certains cas, à ce que « les sociologues ne [sont] pas autre chose que des militants ou des activistes » (commitment without scolarship), posant alors une équivalence parodique entre révolutions dans l’ordre des mots et dans l’ordre des choses[7]. En fait, cette impasse nous semble surtout tenir, comme le note Lahire, aux règles d’un champ académique traversé par la distinction, la hiérarchie, la concurrence et le carriérisme, travers encouragés par les politiques nationales et européennes qui n’ont de cesse d’évaluer, d’individualiser et de précariser aux motifs de l’innovation et de l’excellence.
Un rationalisme critique de la totalité
Pour les sciences sociales critiques (SSC), la connaissance scientifique s’efforce, à partir d’un respect strict de ses propres règles de production (« C’est l’enquête seule […] qui garantit que nos propositions et nos interprétations sont plus que des suppositions, des vues de l’esprit, des produits idéologiques ou de pures abstractions » rappelle Jean-Pierre Olivier de Sardan),de se coupler à des logiques émancipatrices (scolarship with commitment). Ce couplage critique invite à des tactiques dont la constitution d’intellectuels collectifs autonomes est une des réponses possibles (la recherche-action coopérative en est une autre), lesquels peuvent d’ailleurs prendre des allures diverses (Savoir/Agir n’est pas la Fondation Copernic qui n’est pas Attac, etc.). Il invite également à un effort d’unité. Il tient, d’une part à la gageure de rassembler des individus (chercheurs-citoyens et citoyens-chercheurs) aux (dis)positions et prises de position diversifiées qui visent à produire des pratiques d’analyse etde transformation sociale (une praxis unitaire qui décrit un mode particulier d’adéquation de la théorie au réel : rendre compte et porter à conséquence). Il tient, d’autre part, non pas comme le suggère Lahire, à une unification « de la description empirique du monde historique[8]», mais, plus modestement, à « l’explication complète[9] » des faits dans les termes de chacune des problématiques mobilisées qui produisent des « intelligibilités partielles ». Et celles-ci sont soumises au « fait épistémologique princeps [posant] l’impossibilité de stabiliser, fût-ce provisoirement, une théorie, c’est-à-dire une langue protocolaire de description et d’interprétation d’un tel monde[10] ».
Les SSC portent donc bien un projet de totalisation, mais ce n’est pas celui d’une science sociale du vivant productrice de résultats cumulatifs et conduisant à l’énoncé de lois universelles. Elles entendent plutôt rendre compte de la complexité sociale au regard d’un triple attendu. Elles considèrent, d’une part, que toute « chose sociale » est le produit d’une histoire et se trouve insérée au sein de multiples relations sociales. Elles s’efforcent, d’autre part, de tirer les conséquences scientifiques et politiques des dynamiques d’investigation portées par la théorie à la rencontre de pratiques et de savoirs venant du terrain. Alain Testart propose d’appeler généralité spécifiable, la manière dont chaque cas singulier est affecté par une loi générale. Pour la critique, il y a un équivalent homologique (et non nomologique) de ces généralités spécifiables : il peut se résumer dans l’exigence de produire une analyse historique et sociologique la plus fine et complète possible – depuis des théories de la domination/émancipation – de la manière dont les réalités sociales (sujets, collectifs, événements, institutions, etc.) sont soumises aux dynamiques d’un monde travaillé par des ordres sociaux qui en sont la structure signifiante (Jean-Claude Passeron rappelait qu’il n’y a de sociologie que des rapports inégaux) : « l’objet de la critique doit être la société dans son ensemble : les sources profondes et structurelles de la domination sociale, les tendances à la crise ou les contradictions de la société, les formes de conflit social qui la caractérisent et le potentiel d’émancipation propre à chaque période de son histoire. Seule une conception aussi ambitieuse peut espérer mettre au jour les liens entre ‘‘des problèmes sociaux’’ apparemment distincts, révéler les causes structurelles profondes de ces problèmes et discerner dans quelle mesure ils se produisent de manière accidentelle ou nécessaire, et sont alors la conséquence de propriétés de la société en tant que système[11] ». Pour les SSC, l’effort de totalisation répond à la nécessité de se donner les moyens de situer les phénomènes étudiés dans un environnement plus large que celui de leur déploiement pratique, qui en conditionne l’existence. Il s’agit ainsi dereconstituer l’unité des diverses dimensions de la vie sociale en ce qu’elles sont la conséquence d’ensembles structurés de domination qui entretiennent des relations entre eux. C’est ce système que les SSC tentent de constituer, par la pensée, en une totalité cohérente, qui n’a que peu de points communs avec l’idée d’un tout conçu comme la somme exhaustive des faits et/ou des différents domaines particuliers du savoir, à commencer par ceux de l’histoire et de la sociologie. L’objectif est plutôt de promouvoir une pratique de production scientifique rendant compte des faits humains de domination-émancipation, leur donnant du sens en faisant tenir dans une totalité ce que la facticité empiriste et positiviste ou la construction institutionnelle de disciplines universitaires distinctes tendent à déli(t)er. Comme le note Norbert Elias, « l’investigation de structures provisoirement isolées n’a […] d’intérêt que dans la mesure où ces résultats sont constamment rapportés à un modèle de la configuration d’ordre supérieur. Les traits distinctifs des unités partielles ne peuvent pas être ici saisis de manière adéquate sans la règle procurée par un modèle théorique de l’unité d’ensemble[12] ».
Les SSC travaillent, comme toutes les sciences sociales, sur des configurations singulières(selon les termes de Max Weber). Mais en s’appuyant sur des objectivités synthétiques et des dispositions totalisantes elles se donnent, de surcroît, les moyens de saisir celles-ci comme porteuses de la structure d’un tout. Il y a donc là une autre manière d’envisager une forme de rationalisme de la totalité qui, si elle reste attachée à l’idée de sciences et de théories plurielles, s’attache aussi à saisir un pan spécifique de la réalité humaine (les phénomènes de domination-émancipation) : celui qui décrit des ensembles structurés, cohérents (des ordres sociaux) et évolutifs. L’appréhension des faits sociaux particuliers est évidemment déterminée par la conception générale de la réalité sociale. C’est le point de vue d’ensemble de ce qu’est la réalité sociale (point de vue qui ne saurait être unique) qui, en l’espèce, procure une unité à l’analyse (totalité analytique). C’est lui qui ordonne et articule les faits, non pas depuis un travail spéculatif (totalité abstraite), mais depuis un travail d’enquête (totalité concrète) qui doit rendre compte de la tendance historique et sociale des faits observés et non dégager une tendance extérieure à ces derniers. L’effort de totalisation que porte les SSC doit rester attentif aux détails et aux contradictions que l’enquête ne manquera pas de mettre au jour. Leur analyse impose un retour réflexif sur le principe d’intégration théorique qui – comme la réalité sociale – ne peut être considéré comme un tout achevé et formalisé, donnant des réponses avant même d’avoir su poser des questions en rapport avec les phénomènes à étudier. Cet aspect se révèle particulièrement important pour les SSC qui entendent intervenir dans le champ politique depuis un rationalisme critique qui est donc aussi un rationalisme de la totalité dans la mesure où la couplage scientifico-politique invite (non sans peine) à un mouvement de la réalité dans la pensée et de la pensée dans la réalité. La critique portée par les SSC tournées vers une praxis émancipatrice, n’est ni l’application de thèses invariables, ni le repérage de lois universelles. Elle est l’examen minutieux et réflexif de segments d’une réalité sociale métastable, contradictoire, toujours en mouvement bien que travaillée par des régularités, capable d’ajuster tant ses cadres analytiques que ses débouchés praxiques. C’est à ce prix que, comme Marx l’écrivait dans une lettre à Arnold Ruge (1843), il devient possible de réaliser « la critique radicale de tout l’ordre existant, radicale en ce sens qu’elle n’a pas peur de ses propres résultats, pas plus que des conflits avec les puissances établies[13] ».
[1]Bernard Lahire, Monde pluriel. Penser l’unité des sciences humaines et sociales, Paris, Seuil, 2012, p. 11.
[2]Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Le métier de sociologue. Préalables épistémologiques, Paris, Mouton, 1972.
[3]Marc Joly, La révolution sociologique de la naissance d’un régime de pensée scientifique à la crise de la philosophie (XIXe-XXesiècle). Paris, La Découverte, 2017, p. 511.
[4]Ibid., p. 513.
[5]Alain Testart,Essai d’épistémologie pour les sciences sociales, Paris, CNRS éditions, 2021.
[6]Ibid.
[7]Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris Seuil, 1997, p. 10.
[8]Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, 1991, p. 363
[9]Alain Testart, op. cit, p. 108.
[10]Jean-Claude Passeron, op. cit., p. 59.
[11]Nancy Fraser inLuc Boltanski, Nancy Fraser, Philippe Corcuff, Domination et émancipation. Pour un renouveau de la critique sociale, Lyon, PUL, 2014, p. 70.
[12]Norbert Elias, Qu’est-ce que la sociologie ?, Paris, Pocket, 1993, p. 43.
[13]Karl Marx, « Lettre à Arnold Ruge, septembre 1843 », in Karl Marx, Friedrich Engels, Correspondances, tome 1, Paris, Éditions sociales, 1971, p. 298.